Expert médical de l'article
Nouvelles publications
Pharyngomycose
Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.
Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.
Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.
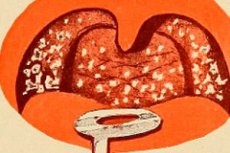
La pharyngomycose (amygdalite, mycose buccale, pharyngite fongique, amygdalite fongique, mycose du pharynx, muguet) est une pharyngite (amygdalite) causée par des champignons. La pharyngite est une inflammation de la muqueuse de l'oropharynx. L'amygdalite est une inflammation d'une ou plusieurs formations lymphoïdes du côlon pharyngé, le plus souvent des amygdales palatines. Dans la plupart des cas, la maladie est causée par des champignons de type levure, plus rarement par des moisissures.
Épidémiologie
L'incidence de la pharyngomycose a fortement augmenté au cours des dix dernières années et représente 30 à 45 % des lésions infectieuses du pharynx et des amygdales. L'augmentation du nombre de patients atteints de cette pathologie est due à une augmentation significative du nombre de facteurs de risque, parmi lesquels figurent en tête les déficits immunitaires iatrogènes résultant d'une antibiothérapie massive, de l'utilisation prolongée de glucocorticoïdes et d'immunosuppresseurs dans les maladies oncologiques, les maladies du sang, l'infection par le VIH et les endocrinopathies. Dans de telles situations, tous les facteurs favorisant le développement de la pharyngomycose sont réunis, les agents responsables de la maladie étant des champignons opportunistes qui se développent sur la muqueuse de l'oropharynx et dans l'environnement.
Le problème de la pharyngomycose prend une importance sociale majeure, non seulement en raison de sa prévalence croissante, mais aussi parce que l'infection fongique de l'oropharynx est plus grave que les autres processus inflammatoires de cette localisation. L'infection fongique de l'oropharynx peut devenir le foyer principal d'une mycose viscérale disséminée ou la cause d'une septicémie fongique.
Durant l'enfance, l'incidence de la pharyngomycose est élevée. La candidose de la muqueuse buccale est particulièrement fréquente chez le nouveau-né (muguet). L'apparition de la candidose est associée à une formation incomplète de la protection immunitaire du nouveau-né contre les effets d'une infection mycosique. Les enfants plus âgés souffrent souvent de pharyngomycose. Chez beaucoup d'entre eux, l'apparition de la maladie est associée à une infection fongique précoce et à une élimination incomplète de l'agent pathogène de la source d'infection.
Dans la population adulte, la mycose du pharynx est diagnostiquée avec la même fréquence entre 16 et 70 ans, et dans certains cas à un âge plus avancé.
Causes pharyngomycose
Français Les principaux agents responsables de la pharyngomycose sont considérés comme étant diverses espèces de champignons de type levure du genre Candida (dans 93 % des cas): C. albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. glabrata, C. parapsillosis, C. stellatoidea, C. intermedia, C. brumpti, C. sake, etc. Le principal agent responsable est considéré comme étant C. albicans (dans 50 % des cas), en deuxième position en termes de fréquence d'apparition se trouve C. stellatoidea. Cette espèce est proche de C. albicans dans ses propriétés morphologiques et biochimiques, et de nombreux auteurs les identifient.
Dans 5 % des cas, les infections fongiques de l'oropharynx sont causées par des moisissures des genres Geotrichum, Aspergillus, Penicillium, etc.
Facteurs de risque
Pathogénèse
Français Les principaux agents responsables de la pharyngomycose sont considérés comme étant diverses espèces de champignons de type levure du genre Candida (dans 93 % des cas): C. albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. glabrata, C. parapsillosis, C. stellatoidea, C. intermedia, C. brumpti, C. sake, etc. Le principal agent responsable est considéré comme étant C. albicans (dans 50 % des cas), en deuxième position en termes de fréquence d'apparition se trouve C. stellatoidea. Cette espèce est proche de C. albicans dans ses propriétés morphologiques et biochimiques, et de nombreux auteurs les identifient.
Dans 5 % des cas, les infections fongiques de l'oropharynx sont causées par des moisissures des genres Geotrichum, Aspergillus, Penicillium, etc.
Symptômes pharyngomycose
En cas de pharyngomycose, les patients se plaignent d'une gêne au niveau de la gorge, d'une sensation de brûlure, d'une sécheresse, d'une douleur et d'une irritation, plus prononcées qu'en cas d'infection pharyngée bactérienne. La douleur est d'intensité modérée et s'intensifie à la déglutition et à la consommation d'aliments irritants. Les patients ressentent une douleur irradiant vers la région sous-maxillaire, la face antérieure du cou et l'oreille. Les signes spécifiques de la pharyngomycose comprennent la présence de plaque, un gonflement de la muqueuse et une intoxication prononcée. La pharyngomycose se caractérise également par des exacerbations fréquentes (2 à 10 fois par an) et une évolution de la maladie à tout âge.
L'évolution clinique de la pharyngomycose peut être aiguë ou chronique. Elle est principalement localisée sur les amygdales palatines, les arcades palatines et la paroi postérieure du pharynx. Les patients ressentent une sensation de grattage, de brûlure et d'inconfort dans la gorge, un malaise, des maux de tête et une fièvre modérée. Dans la pharyngomycose causée par des champignons de type levure, des plaques blanchâtres de tailles variables sont observées dans la gorge. Elles sont faciles à retirer, exposant des zones hyperémiques de la muqueuse et, plus rarement, des ulcères hémorragiques. La pharyngomycose causée par des moisissures se caractérise par la couleur jaunâtre des plaques et leur difficulté à les retirer, ce qui peut évoquer une diphtérie pharyngée. Les champignons peuvent se propager au larynx, à l'œsophage et former des abcès para-amygdaliens.
Qu'est ce qui te tracasse?
Formes
Selon la localisation de la lésion mycotique, on distingue:
- chéilite;
- glossite;
- stomatite;
- gingivite;
- amygdalite;
- pharyngite.
Selon l'évolution clinique, on distingue les formes suivantes de pharyngomycose:
- aigu:
- chronique.
Dans de nombreux cas, le processus aigu devient chronique en raison d’un diagnostic erroné et d’un traitement irrationnel.
Variantes cliniques et morphologiques de la pharyngomycose:
- Pseudomembraneuse. Elle se caractérise par des dépôts blancs et caséeux qui se détachent pour révéler une base rouge vif, parfois saignante en surface.
- érythémateux (catarrhal). Caractérisé par un érythème à surface lisse et « vernie », les patients ressentent des douleurs, des brûlures et une sécheresse buccale;
- hyperplasique. Des taches et des plaques blanches sont présentes dans la cavité buccale, difficiles à séparer de l'épithélium sous-jacent;
- érosive-ulcéreuse.
Diagnostics pharyngomycose
Les données suivantes doivent être prises en compte lors de l'examen: le moment d'apparition de la maladie et les caractéristiques de son évolution. Il est nécessaire de déterminer si le patient a déjà souffert de para-amygdalite et d'abcès para-amygdaliens, ainsi que la fréquence, la durée et la nature des exacerbations de l'amygdalite. Le traitement antérieur (local ou général) et son efficacité sont pris en compte. Il est également nécessaire de déterminer si le patient a été traité par antibiotiques, glucocorticoïdes, cytostatiques (durée et intensité du traitement), les caractéristiques des conditions professionnelles et domestiques, les antécédents médicaux et les antécédents allergiques. Il convient de garder à l'esprit que les patients atteints de pharyngomycose présentent des exacerbations fréquentes, et que les traitements standard n'ont aucun effet, voire aucun, sur l'état de santé du patient.
Examen physique
L'examen révèle les modifications morphologiques suivantes: infiltration de la muqueuse, dilatation et injection des vaisseaux sanguins, et desquamation de l'épithélium. Une hyperémie irrégulière et une infiltration de la muqueuse de la paroi postérieure du pharynx constituent un signe clinique caractéristique de la pharyngite chronique d'origine fongique. Dans le contexte d'une subatrophie, on observe une augmentation des crêtes latérales. Souvent, dans le contexte des modifications pathologiques décrites, on observe des plaques blanchâtres, cassantes et facilement éliminables, sous lesquelles se trouvent des zones d'érosion de la muqueuse. Dans la forme ulcéreuse-nécrotique de l'amygdalite fongique, les plaques s'étendent au-delà des amygdales palatines jusqu'aux arcades palatines et au palais mou, et parfois au palais dur. La présence de plaques et de lésions unilatérales est considérée comme un signe diagnostique pathognomonique de pharyngomycose.
En cas d'amygdalite chronique, un examen est effectué en dehors de la période d'exacerbation. Il est nécessaire d'être attentif à la couleur de la muqueuse de l'oropharynx, des amygdales, à la nature de la plaque (couleur, prévalence), à la taille des amygdales, au degré de gonflement, à la consistance (dense ou lâche), à l'adhérence aux arcades amygdaliennes et à la présence de contenu purulent dans les lacunes. Il est également nécessaire d'examiner l'amygdale linguale (couleur, taille, présence de plaque) et les ganglions lymphatiques.
 [ 17 ]
[ 17 ]
Recherche en laboratoire
Une infection fongique du pharynx peut être suspectée sur la base des données d'un examen endoscopique, mais les méthodes d'analyse mycologique en laboratoire sont cruciales pour établir un diagnostic correct. Cependant, un seul résultat négatif n'indique pas l'absence de maladie fongique; dans ce cas, il est donc nécessaire de réaliser des analyses répétées de l'écoulement pathologique. Par ailleurs, la présence d'un seul champignon en culture n'indique pas toujours une infection fongique.
L'examen mycologique comprend un examen microscopique puis l'ensemencement des sécrétions pathologiques sur un milieu nutritif. Pour un diagnostic précis, il est important de prélever correctement le matériel pathologique à examiner. Les plaques à la surface des amygdales sont généralement faciles à retirer. Les plaques volumineuses et denses sont prélevées sur une lame à l'aide d'une pince auriculaire et, sans frottis, recouvertes d'une autre lame. Les plaques peu abondantes sont retirées à l'aide d'une cuillère de Volkmam, en prenant soin de ne pas blesser les tissus.
Dans la candidose amygdalienne, l'examen microscopique des échantillons natifs et colorés est important. La coloration de Romanovsky-Giemsa révèle des spores de champignons levuriens du genre Candida. Les cellules fongiques sont rondes ou allongées, le bourgeonnement est clairement visible, ainsi que les filaments de pseudomycélium. Le mycélium des champignons levuriens du genre Candida est constitué de faisceaux de cellules allongées reliées en chaînes qui ressemblent au vrai mycélium. Le vrai mycélium est un long tube divisé par des cloisons transversales et une membrane unique. Le pseudomycélium n'a pas de membrane commune. Les caractéristiques morphologiques du pseudomycélium du champignon du genre Candida sont considérées comme l'un des critères fiables qui le distinguent des autres champignons.
Au stade initial de la maladie, l'examen microscopique de la plaque révèle des amas de blastospores fongiques et des filaments de pseudomycélium isolés ou absents. Au plus fort de la maladie, des amas de cellules fongiques bourgeonnantes et de nombreux filaments de pseudomycélium sont visibles sur le frottis. Ainsi, un diagnostic précis peut être établi sur la base des données de l'examen microscopique.
Les cultures sont considérées comme l'une des méthodes les plus importantes pour diagnostiquer la candidose. Elles permettent non seulement de confirmer le diagnostic de la maladie fongique, mais aussi de déterminer le type d'agent pathogène et d'évaluer l'efficacité du traitement.
Lors de l'ensemencement sur milieu électif chez des patients atteints de pharyngomycose, des champignons de type levure du genre Candida sont le plus souvent isolés. Lors de l'ensemencement sur milieu solide de Sabouraud, une croissance uniforme de champignons de type levure du genre Candida est observée à chaque point d'ensemencement (pour éviter les erreurs, l'ensemencement est réalisé dans 2 à 4 tubes à essai).
En cas d'amygdalite chronique, en l'absence de plaque, l'ensemencement se déroule comme suit. Le matériel d'ensemencement est prélevé des deux amygdales et de la paroi postérieure du pharynx à l'aide d'un coton-tige stérile. Les écouvillons sont placés dans des tubes à essai stériles contenant du milieu Sabouraud liquide, puis placés dans un thermostat pendant 24 heures à une température ambiante de 27-28 °C. Le matériel est ensuite réensemencé simultanément sur du milieu Sabouraud solide dans trois tubes à essai. Après réensemencement, les tubes sont à nouveau placés dans le thermostat pendant 8 à 10 jours. Dès le 4e ou le 5e jour, les champignons Candida produisent une croissance caractéristique de colonies rondes, blanches ou gris-blanchâtre, à la surface convexe, lisse et brillante, et à la consistance caséeuse.
Si des champignons sont détectés dans les dépôts amygdaliens lors d'un examen microscopique, ils peuvent également être isolés par ensemencement en culture pure. En règle générale, on observe une croissance continue (30 000 à 45 000 colonies dans 1 ml).
De plus, des analyses sanguines cliniques (notamment pour l’infection par le VIH, les marqueurs de l’hépatite, la syphilis), des analyses d’urine, la détermination du taux de glycémie et des indicateurs d’immunogramme sont nécessaires.
Ainsi, le diagnostic d’infection fongique du pharynx est posé sur la base de:
- données cliniques;
- détection de champignons par microscopie de frottis de la muqueuse;
- résultats positifs lorsqu'ils sont cultivés sur des milieux nutritifs électifs.
 [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ]
[ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ]
Dépistage
La méthode de dépistage pour détecter la pharyngomycose est la microscopie d'une préparation de frottis natif et coloré de la muqueuse du pharynx et de la surface des amygdales.
Qu'est-ce qu'il faut examiner?
Comment examiner?
Quels tests sont nécessaires?
Diagnostic différentiel
Un diagnostic différentiel doit être effectué en cas de pharyngite et d'amygdalite bactériennes aiguës, de scarlatine, de diphtérie, de tuberculose, de syphilis, de forme angineuse de mononucléose infectieuse, d'angine de Simanovsky-Plaut-Vincent et de néoplasmes malins.
Indications de consultation avec d'autres spécialistes
Une consultation avec un immunologiste est nécessaire pour identifier et corriger les états d'immunodéficience; un endocrinologue - pour identifier la pathologie endocrinienne, corriger les endocrinopathies; un oncologue - pour exclure les néoplasmes de la cavité buccale et du pharynx; un spécialiste des maladies infectieuses - pour exclure la diphtérie et la mononucléose.
Qui contacter?
Traitement pharyngomycose
Le traitement vise à éliminer le champignon responsable et à corriger l’état d’immunodéficience.
Indications d'hospitalisation
Formes compliquées de pharyngomycose.
 [ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ]
[ 25 ], [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ]
Traitement médicamenteux de la pharyngomycose
Principes généraux de la pharmacothérapie des infections fongiques de l'oropharynx:
- L’utilisation de médicaments antifongiques systémiques doit être associée à une action locale sur la source de l’infection;
- Le traitement médicamenteux antifongique doit être basé sur les résultats des tests de laboratoire sur la sensibilité du champignon au médicament utilisé.
Le traitement de la pharyngomycose consiste à prescrire les médicaments suivants: nystatine en comprimés, à croquer et à appliquer la masse obtenue sur la surface du pharynx par des mouvements de la langue et de la déglutition. En cas d'inefficacité, lévorine et dékamin. Les lésions sont lubrifiées avec une solution à 1 % de violet de gentiane, une solution à 10 % de tétraborate de sodium dans la glycérine et une solution de Lugol.
Si le traitement par des doses standard de fluconazole est inefficace, l'itraconazole est prescrit à raison de 100 mg par jour ou de 200 mg par jour de kétoconazole pendant un mois. L'itraconazole agit non seulement sur les levures du genre Candida, mais aussi sur les moisissures.
En cas de pharyngomycose résistante aux autres antimycosiques, l'amphotéricine B est administrée par voie intraveineuse à raison de 0,3 mg/kg par jour pendant 3 à 7 jours. Le traitement de la pharyngomycose par l'amphotéricine B et le kétoconazole est réalisé sous surveillance des paramètres biochimiques hépatiques et rénaux, car ces médicaments, en particulier l'amphotéricine B, ont un effet néphrotoxique et hépatotoxique prononcé.
Dans le traitement systémique de la pharyngomycose, des médicaments des groupes d'antimycosiques suivants sont utilisés:
- polyènes: amphotéricine B, nystatine, lévorine, natamycine:
- azoles: fluconazole, itraconazole, kétoconazole;
- allylamines: terbinafine.
Le médicament le plus efficace contre la pharyngomycose est le fluconazole, prescrit une fois par jour à la dose de 50 ou 100 mg, et dans les cas graves à 200 mg. La durée du traitement est de 7 à 14 jours.
Les schémas thérapeutiques alternatifs pour la pharyngomycose, d'une durée également de 7 à 14 jours, sont considérés comme les suivants:
- Suspension de lévorine (20 000 U/ml), 10 à 20 ml 3 à 4 fois par jour; Suspension de natamycine (2,5 %), 1 ml 4 à 6 fois par jour;
- Suspension de nystatine (100 000 U/ml), 5 à 10 ml 4 fois par jour.
Si le traitement par des doses standard de fluconazole est inefficace, l'itraconazole est prescrit à raison de 100 mg par jour ou de 200 mg par jour de kétoconazole pendant un mois. L'itraconazole agit non seulement sur les levures du genre Candida, mais aussi sur les moisissures.
En cas de pharyngomycose résistante aux autres antifongiques, l'amphotéricine B est administrée par voie intraveineuse à raison de 0,3 mg/kg par jour pendant 3 à 7 jours. Le traitement par amphotéricine B et kétoconazole est réalisé sous surveillance des paramètres biochimiques hépatiques et rénaux, car ces médicaments, en particulier l'amphotéricine B, ont un effet néphrotoxique et hépatotoxique prononcé.
Pour les mycoses causées par les moisissures, l'itraconazole et la terbinafine sont considérés comme les plus efficaces. Le traitement par l'itraconazole dure 14 jours à raison de 100 mg une fois par jour, et par la terbinafine, 8 à 16 jours à raison de 250 mg une fois par jour.
Pour le traitement local, des antiseptiques et des antimycosiques (miramistine, oxyquinoléine, clotrimazole, borax dans la glycérine, suspension de natamycine) sont utilisés pour la lubrification, le rinçage, l'irrigation et le lavage des lacunes des amygdales.
Les médicaments antifongiques sont utilisés dans le contexte de l'élimination des facteurs de risque, tels que la neutropénie, le traitement soigneux des prothèses dentaires, etc.
Gestion ultérieure
En cas d'exacerbation de la pharyngomycose, des azolés sont prescrits par voie orale ou locale pendant 7 à 14 jours, en tenant compte de la sensibilité de l'agent pathogène au médicament. Il est nécessaire d'éliminer les facteurs de risque. Après rémission, un traitement anti-rechute est mis en place par des antimycosiques systémiques ou des antifongiques à usage local.
Plus d'informations sur le traitement
Médicaments
La prévention
Les principales mesures de prévention de la pharyngomycose doivent viser à éliminer les facteurs qui contribuent à l'activation de la flore fongique, à savoir l'abolition des antibiotiques, des glucocorticoïdes, la correction du profil glycémique et la thérapie de renforcement général.
Prévoir
Avec un traitement rapide et un traitement antifongique adéquat, le pronostic est favorable. La durée approximative d'incapacité de travail lors d'une exacerbation de pharyngomycose est de 7 à 14 jours.

