Expert médical de l'article
Nouvelles publications
Odeur d'acétone dans l'haleine
Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.
Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.
Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.
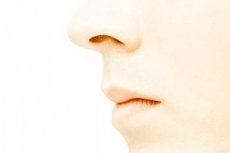
Il existe un grand nombre de maladies et de pathologies des organes internes qui peuvent provoquer une halitose acétonique chez les adultes et les enfants.
Une odeur intense d'acétone indique des processus pathologiques agressifs dans l'organisme. La cause en est une augmentation significative du taux de corps cétoniques dans le sang systémique, qui survient en réponse à une situation stressante pour l'organisme (facteurs alimentaires, augmentation de la température corporelle à des valeurs élevées), lorsque le processus de dégradation complète des protéines, des lipides et des glucides est perturbé. Les cétones ou composés cétoniques sont des produits intermédiaires du métabolisme des lipides, des protéines et des glucides, constitués d'une combinaison d'acétone (propanone), d'acide acétoacétique (acétoacétate) et d'acide bêta-hydroxybutyrique (bêta-hydroxybutyrate). Une fois dégradées, elles constituent une source d'énergie supplémentaire. Elles se forment lors des transformations oxydatives dans le foie et les tissus lipidiques.
La présence de cétones dans la circulation sanguine est considérée comme normale pour l'organisme. Des niveaux sûrs de cétones ne provoquent pas d'odeur acétonique pathologique dans la bouche ni de perturbation du bien-être général.
Une alimentation déséquilibrée, principalement composée de lipides et de protéines, favorise l'accumulation excessive de cétones. Cela entraîne une intoxication de l'organisme par des produits métaboliques non digérés et provoque un déséquilibre acido-basique vers une acidité accrue, se manifestant par un syndrome acétonémique et une acidose. Ces affections sont dues à une carence enzymatique et à l'incapacité du tube digestif à dégrader les lipides au niveau requis. Il en résulte une croissance pathologique des cétones. Une fois les niveaux critiques atteints, l'acétone et ses dérivés ont un effet négatif sur l'organisme.
Causes odeur de l'haleine d'acétone
Les principales causes de l’halitose acétonique sont:
- conditions stressantes;
- diabète;
- intoxication alimentaire et toxique;
- manque de glucides suffisants dans l’alimentation;
- jeûne prolongé;
- insuffisance rénale;
- déficit congénital des enzymes digestives.
- augmentation significative de la température corporelle dans les maladies infectieuses et inflammatoires.
Facteurs de risque
Les facteurs suivants sont considérés comme provoquant l’apparition d’une odeur d’acétone dans la bouche:
- infections bactériennes (en particulier purulentes-inflammatoires) avec élévation de la température corporelle à des chiffres élevés,
- maladies cardiovasculaires (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral),
- inflammation du pancréas,
- pathologies rénales,
- problèmes de glande thyroïde,
- abus d'alcool,
- déséquilibre enzymatique et nutritionnel.
 [ 1 ]
[ 1 ]
Symptômes odeur de l'haleine d'acétone
Les symptômes dépendent du taux d'acétone accumulé dans l'organisme. Dans les formes légères, on observe une faiblesse, de l'anxiété et des nausées. L'analyse d'urine confirme la cétonurie.
Les symptômes d'une affection modérée comprennent les suivants: langue sèche et chargée, soif accrue, halitose acétonique sévère, respiration superficielle fréquente, douleurs abdominales sans localisation précise, peau sèche, frissons, nausées et confusion. La concentration de cétones dans les urines est plus élevée.
L'état sévère de crise acétonémique est identique au coma diabétique, dans lequel les symptômes sont les mêmes que dans un état modéré avec la possibilité d'une chute du patient dans un état d'inconscience.
Le diagnostic d'acidocétose repose sur les symptômes cliniques et les analyses de laboratoire. Les analyses sériques révèlent une hypercétonémie (jusqu'à 16-20 mmol/l, avec une norme de 0,03-0,2 mmol/l) et la présence d'un taux élevé d'acétone dans les urines.
Odeur d'acétone provenant de la bouche d'un adulte
Les causes de l'haleine acétonique chez l'enfant et l'adulte sont identiques. Les facteurs déclenchants sont les mêmes. L'halitose acétonique chez l'adulte est principalement observée en cas de diabète de type 1 et de type 2. Une haleine acétonique prononcée chez l'adulte est souvent associée à des troubles neurologiques, à l'anorexie, à des pathologies thyroïdiennes et parathyroïdiennes, à une croissance tumorale et à certains régimes alimentaires (notamment ceux associés à un jeûne thérapeutique prolongé).
Un adulte a la capacité de s'adapter à des conditions de vie défavorables. L'accumulation prolongée et le maintien d'un taux élevé de composés cétoniques dans la circulation sanguine entraînent l'épuisement des capacités compensatoires et la manifestation active des symptômes d'une maladie latente, accompagnés d'une odeur d'acétone dans la bouche.
Odeur d'acétone dans la bouche après avoir bu de l'alcool
La consommation prolongée et fréquente de boissons alcoolisées peut entraîner l'apparition d'une odeur d'acétone. En effet, lorsque l'alcool est décomposé par les enzymes hépatiques, l'acétaldéhyde, une toxine alcoolique, est libérée par les poumons, ce qui se traduit par une odeur d'acétone dans la bouche.
Elle indique un changement brutal de l'équilibre acido-basique vers le côté acide (acidose). Une diminution de la résistance du foie à l'alcool provoque l'apparition d'une odeur d'acétone dans la bouche due à la consommation de boissons alcoolisées.
L'odeur d'acétone et d'urine de la bouche
En cas de néphropathie et d'insuffisance rénale, l'odeur d'acétone s'accompagne d'une odeur d'ammoniac dans la bouche. Les reins éliminent les toxines et les déchets de l'organisme. Lorsque la fonction de filtration rénale est altérée, l'efficacité du processus d'élimination des substances nocives diminue et celles-ci s'accumulent. L'un des signes est une odeur d'ammoniac, similaire à celle de l'acétone. Ces deux odeurs sont souvent confondues. Pour diagnostiquer une pathologie rénale en cas d'halitose ammoniacale ou acétonique, il est conseillé de consulter un urologue ou un néphrologue.
Odeur d'acétone dans la bouche comme symptôme de la maladie
L'odeur d'acétone peut être le symptôme d'une maladie grave
Le diabète sucré est la maladie la plus courante qui provoque l’odeur d’acétone.
Le diabète de type I est causé par des pathologies liées au fonctionnement du pancréas. Il se produit une diminution brutale, voire un arrêt, de la synthèse d'insuline, responsable de l'apport de glucose (principale source d'énergie) aux cellules de l'organisme. L'insuline a la capacité de transporter les sucres décomposés à travers les membranes cellulaires, assurant ainsi le maintien d'une glycémie stable dans le sang. Dans le diabète de type II, l'hormone insuline est produite en totalité, mais les cellules ne perçoivent pas le glucose délivré. De ce fait, un excès de glucose et une grande quantité d'insuline s'accumulent dans le sang. En présence d'un excès d'hormone, des récepteurs informent le cerveau du besoin de manger. Un faux besoin de nourriture apparaît, entraînant l'obésité. Une glycémie excessive, atteignant des valeurs critiques, conduit au coma hyperglycémique.
L'acidose et la cétonémie sont typiques du diabète, surtout chez l'enfant. La concentration normale de corps cétoniques dans le sang est estimée à 5-12 mg %. Chez le patient diabétique, ce pourcentage atteint 50-80 mg %, provoquant une odeur d'acétone dans la bouche. Une forte concentration de corps cétoniques est retrouvée dans les urines.
En cas de coma hyperglycémique, une odeur d'acétone apparaît. L'état général du patient s'aggrave progressivement. Au début de la crise, on observe une tachycardie, une constriction des pupilles, une peau pâle et sèche, et une possible gastralgie.
L'apparition des symptômes du coma diabétique et leur aggravation sont une raison d'appeler une ambulance, puis un traitement en milieu hospitalier.
L'air expiré sentira l'acétone si le patient a des problèmes rénaux, car les produits de dégradation des substances alimentaires ne sont pas excrétés dans l'urine.
L'odeur d'acétone est le premier signe de néphrose ou de dystrophie rénale causée par une destruction des tubules rénaux et une perturbation des fonctions de filtration et d'excrétion. Ces maladies se caractérisent par des pathologies métaboliques liées à un trouble de l'excrétion des métabolites lipidiques, entraînant une accumulation de cétones dans le sang. La néphrose peut accompagner des infections chroniques (tuberculose, rhumatismes).
L'hyperthyroïdie est une autre maladie contribuant au développement de l'halitose acétonique. Il s'agit d'une pathologie de la glande thyroïde, accompagnée d'une augmentation persistante de la synthèse des hormones thyroïdiennes et entraînant une accélération des processus métaboliques, avec pour conséquences la formation et l'accumulation de composés cétoniques.
Une augmentation des composés contenant de l'acétone se produit lors d'une longue période de jeûne thérapeutique, d'une alimentation irrationnelle (monotone et déséquilibrée).
L'haleine acétonique peut survenir chez les personnes suivant un régime strict et pratiquant fréquemment des périodes de jeûne. Les régimes qui réduisent l'apport calorique en renonçant aux glucides et aux lipides peuvent provoquer des troubles métaboliques et, s'ils sont appliqués de manière incontrôlée, entraîner des conséquences négatives et irréversibles. Il est inutile d'utiliser des rafraîchisseurs d'haleine ou des chewing-gums pour se débarrasser de l'odeur d'acétone. Il est d'abord nécessaire d'identifier et d'éliminer la cause de son apparition.
L'haleine d'acétone dans le diabète de type 2
Le diabète de type II mérite une attention particulière. Il survient en cas d'obésité rapide (80 à 90 % des patients). Les parois cellulaires s'épaississent considérablement et la perméabilité membranaire aux produits de dégradation du sucre est altérée en raison de la perte de sensibilité à l'insuline, principal conducteur du glucose dans les cellules de l'organisme. Une odeur d'acétone apparaît alors. Il est possible de stabiliser et de freiner la progression de la maladie grâce à un régime thérapeutique spécifique permettant de perdre efficacement le poids. L'ajout d'aliments pauvres en glucides facilement digestibles à l'alimentation contribue à réduire les niveaux critiques d'acétone dans l'organisme.
L'odeur d'acétone dans la bouche pendant un coma
Le diagnostic différentiel des états comateux est difficile si les événements précédant le coma sont inconnus ou si le patient a des antécédents de diagnostic avec une possible complication comateuse. Presque tous les cas impliquent une odeur d'acétone dans la bouche et/ou sa présence dans les urines.
Coma alcoolique. Il survient en cas de consommation fréquente et incontrôlée de boissons alcoolisées. De faibles doses d'alcool peuvent également provoquer un coma en cas d'intolérance absolue à l'alcool éthylique. Une surdose d'alcool et un coma peuvent être mortels si une cure de désintoxication n'est pas commencée à temps. Objectivement, un coma alcoolique profond se caractérise par une perte de conscience, une atténuation des réflexes, un pouls filiforme et une chute de la tension artérielle à des valeurs critiques. La peau du visage prend une teinte bleutée pâle, le corps est couvert d'une sueur froide et collante. Une forte odeur d'alcool et d'acétone se dégage de la bouche, et ces substances sont détectées dans le sang et les urines. Le coma alcoolique peut également survenir suite à la consommation d'alcool méthylique (technique). La fréquence des décès est beaucoup plus élevée qu'avec l'alcool éthylique. Les mesures thérapeutiques de désintoxication sont réalisées dans des services spécialisés.
Coma urémique. Le coma urémique chronique est une affection considérée comme le stade terminal de l'insuffisance rénale chronique, qui survient dans un contexte de glomérulonéphrite, de pyélonéphrite et de rétrécissement artérioscléreux du rein. Les manifestations et la gravité s'aggravent avec le temps. Léthargie, faiblesse, soif augmentent progressivement, une forte odeur d'ammoniaque et d'acétone s'échappe de la bouche, un enrouement, des nausées, des vomissements et une léthargie apparaissent. Suite à l'intoxication, le centre respiratoire est affecté et une respiration pathologique de type Cheyne-Stokes ou Kussmaul apparaît.
Les analyses sanguines révèlent une augmentation des taux de créatinine, d'urée et d'azote résiduel, ainsi qu'une acidose progressive. L'inhibition laisse place à la confusion, puis les patients perdent connaissance et décèdent.
Les analyses sanguines confirment un degré élevé d’acidose métabolique, une augmentation progressive de la créatinine, de l’acide urique et de l’azote résiduel.
L’un des éléments de la thérapie complexe de l’urémie est le recours à l’hémodialyse.
Le coma hépatique est un complexe symptomatique d'atteinte hépatique grave. Il progresse avec une suppression des fonctions du système nerveux central et se complique d'un état comateux. Le coma peut se développer progressivement ou rapidement. Il survient en cas d'atteinte hépatique dystrophique toxique aiguë, après des processus nécrotiques étendus ou suite à des modifications cirrhotiques du foie en cas d'hépatite virale. Il s'accompagne d'une inhibition croissante, d'une désorientation, d'une somnolence, d'une confusion, d'une odeur caractéristique de foie dans la bouche et d'un jaunissement de la peau. En cas de détérioration, une perte de connaissance, l'apparition de réflexes pathologiques et le décès du patient surviennent.
Les analyses de sang montrent de faibles niveaux de protéines totales et d’albumine, des niveaux élevés d’acides biliaires, une augmentation de la bilirubine, une augmentation de l’activité d’enzymes hépatiques spécifiques et une diminution de la coagulation sanguine et des niveaux de cholestérol.
Odeur d'acétone provenant de la bouche à une température
Une réaction thermique se produit lorsque la production de chaleur excède le transfert de chaleur sous l'influence de pyrogènes. Cette augmentation est due à l'accélération des processus métaboliques, lorsque des réactions chimiques dégageant de la chaleur se produisent dans l'organisme. La quasi-totalité du potentiel du glucose et un pourcentage important de graisse brune participent à ces réactions. L'augmentation des transformations des composés gras entraîne une sous-oxydation des lipides avec formation de corps cétoniques. Un excès de composés acétoniques peut provoquer des nausées et des vomissements. Les cétones, que les reins ne peuvent éliminer, commencent à être excrétées par les poumons, ce qui entraîne l'apparition d'une odeur d'acétone. En cas de fièvre, les médecins recommandent de boire beaucoup. Après une infection virale respiratoire aiguë ou une autre infection, ou après la fin de l'hyperthermie, l'odeur d'acétone disparaît. Si une halitose est perceptible malgré le régime alimentaire, c'est un facteur alarmant et une raison de consulter un médecin.
Odeur d'acétone dans la bouche pendant la migraine
En cas de crise acétonémique et de migraine, des symptômes similaires sont observés: vertiges, nausées, vomissements, transpiration abondante. L'odeur d'acétone dans la bouche est généralement absente en cas de migraine. Le dosage des corps cétoniques dans les urines sera également négatif. Si la migraine est un symptôme concomitant d'une maladie provoquant une halitose acétonique, un traitement de la pathologie sous-jacente est nécessaire. Il est nécessaire de réaliser certains types d'examens: analyse sanguine biochimique, dosage des corps cétoniques dans les urines, échographie abdominale. D'autres examens sont possibles, déterminés par le médecin. À domicile, il est possible de doser les composés acétoniques dans les urines à l'aide de bandelettes réactives.
Odeur d'acétone dans la bouche pendant le jeûne
Parmi les facteurs provoquant une halitose acétonique, il convient de noter les monodiètes et le jeûne thérapeutique. En l'absence de nourriture, le cerveau transmet des impulsions qui activent une augmentation de la glycémie systémique grâce aux réserves de glycogène organique du foie. L'organisme parvient à maintenir la glycémie à un niveau physiologique pendant un certain temps. Les réserves de glycogène, un glucide complexe, sont limitées. L'organisme doit alors recourir activement à d'autres sources de nutrition et d'énergie, qui constituent le tissu adipeux. Lorsque les composés organiques lipidiques se décomposent, les cellules utilisent l'énergie libérée et les combinaisons de nutriments. Une transformation active des graisses se produit avec formation de composés contenant de l'acétone. L'augmentation des taux de métabolites lipidiques a un effet toxique sur l'organisme. Leur accumulation entraîne l'apparition d'une mauvaise odeur buccale et constitue une tentative de l'organisme d'éliminer les toxines par les poumons. Un jeûne prolongé aggrave l'halitose. Une alimentation inconsidérée peut entraîner des conséquences négatives imprévisibles.
Odeur d'acétone dans la bouche d'un enfant
L'imperfection et la formation de nombreux organes et systèmes entraînent de fréquentes défaillances dans les réactions de transformation des nutriments et les processus métaboliques. Une tendance à la manifestation des symptômes d'une crise acétonémique est observée chez les enfants de moins de cinq ans. Il existe des formes primaires et secondaires d'acétonémie.
Le premier type de crise acétonémique est causé par des erreurs alimentaires, un déséquilibre nutritionnel et des périodes de faim. Le second type est causé par une maladie somatique, une pathologie infectieuse, un trouble endocrinien ou un processus tumoral. Dans l'organisme de l'enfant, les composés cétoniques s'accumulent plus rapidement et ont un effet toxique prononcé. Les symptômes des crises des premier et deuxième types sont identiques: halitose acétonique, manque d'appétit, nausées, vomissements, maux de tête, augmentation du taux de corps cétoniques dans le sang et présence d'acétone dans les urines. L'enfant peut avoir une prédisposition génétique à l'acétonémie.
Les facteurs suivants peuvent déclencher les manifestations d’une crise d’acétone chez un enfant: surmenage physique, choc nerveux grave, surexcitation mentale et changement des conditions climatiques.
Un traitement adéquat est prescrit par un médecin après un examen médical, un diagnostic de laboratoire et un diagnostic précis.
Odeur d'acétone dans la bouche d'un nouveau-né
Un nouveau-né est considéré comme un enfant de sa naissance jusqu'à son 28e jour de vie. La présence d'une odeur d'acétone indique un trouble du métabolisme glucidique (énergétique). En cas d'odeur persistante d'acétone et d'anxiété constante du bébé, l'aide d'un pédiatre est nécessaire. À domicile, vous pouvez rechercher vous-même des composés cétoniques dans l'urine du nouveau-né à l'aide de bandelettes réactives. Cette méthode est difficile en raison du recueil problématique du matériel d'analyse, surtout chez les filles, mais elle est possible.
L'odeur d'acétone qui apparaît après une maladie accompagnée de forte fièvre indique un épuisement des réserves de glucose, qui participe aux réactions pyrogènes. Les enfants ont beaucoup moins de glycogène dans le foie que les adultes, et celui-ci s'épuise plus rapidement.
L'odeur d'acétone peut apparaître si l'enfant est nourri au biberon en raison d'imperfections du système digestif et d'une carence enzymatique.
En cas de problèmes rénaux cachés, l'acétone apparaît en raison d'une élimination insuffisante des produits métaboliques. Le non-respect du régime alimentaire ou la surchauffe du nouveau-né peuvent également entraîner une odeur d'acétone. En cas de vomissements et d'augmentation de l'odeur d'acétone, une consultation médicale urgente est nécessaire.
Vomissements chez un enfant et odeur d'acétone dans la bouche
L'accumulation excessive de cétones, leur effet toxique sur tous les systèmes et l'irritation du centre du vomissement dans le système nerveux central entraînent des vomissements acétonémiques persistants. Une diminution de la glycémie (hypoglycémie) est enregistrée dans le sang.
Le tableau clinique typique des vomissements acétonémiques est celui de crises répétées de vomissements entraînant une faiblesse importante, une décompensation métabolique et une déshydratation aiguë. Ce phénomène est fréquent chez les enfants de 18 mois à 5 ans. Les vomissements sont précédés d'une augmentation significative du taux d'acétonémie et de l'apparition d'une acétonurie. Lorsque les composés cétoniques atteignent des niveaux critiques dans le sang, une odeur caractéristique d'acétone se dégage de la bouche et des vomissements incontrôlables surviennent. Les facteurs les plus fréquents provoquant des vomissements acétonémiques sont:
- Infections - virales et bactériennes, accompagnées de l'ingestion de petites quantités de liquide pendant la fièvre;
- Pauses trop longues entre les repas;
- Un régime alimentaire déséquilibré en termes de composition en protéines, en lipides et en glucides;
- Troubles psychosomatiques.
Cette affection nécessite un traitement hospitalier immédiat, car elle peut entraîner des troubles métaboliques persistants, des modifications de l'équilibre acido-basique et hydro-électrolytique, entraînant des conséquences dangereuses pour la santé et la vie de l'enfant.
Odeur d'acétone dans la bouche d'un adolescent
À l'adolescence, la formation fonctionnelle de nombreux organes et systèmes est presque achevée. Par conséquent, une odeur d'acétone dans la bouche d'un adolescent peut être le signe de troubles métaboliques pathologiques. L'halitose acétonique peut être le signe de problèmes de santé importants. La présence d'une odeur d'acétone dans la bouche peut indiquer:
- le stade initial du diabète sucré, qui n’a pas atteint de manifestations cliniques évidentes;
- erreurs de régime alimentaire;
- pathologies du tractus gastro-intestinal, maladies des reins, de la thyroïde, des parathyroïdes et du pancréas;
- dysfonctionnements au travail, maladies hépatiques aiguës et chroniques;
- maladies infectieuses et inflammatoires aiguës et chroniques.
Diagnostics odeur de l'haleine d'acétone
Pour un diagnostic précis de l'halitose acétonémique, il est important que le médecin recueille une anamnèse précise. Des analyses de laboratoire et une échographie sont prescrites. La nécessité et la liste des examens diagnostiques sont déterminées par le médecin. Une fois ces examens réalisés, le spécialiste sera en mesure de déterminer la cause de l'odeur d'acétone dans la bouche.
 [ 2 ]
[ 2 ]
Tests
En cas d'odeur d'acétone provenant de la bouche, les procédures de diagnostic en laboratoire suivantes sont généralement prescrites:
- analyse sanguine biochimique détaillée (protéines totales, fractions protéiques, maltase, amylase pancréatique, lipase, cholestérol total, urée, créatinine, ALT, AST, etc.);
- numération globulaire complète;
- déterminer la glycémie;
- si nécessaire, les niveaux d’hormones sont diagnostiqués;
- analyse générale d'urine (microscopie des corps cétoniques, du glucose, des protéines et des sédiments);
- coprogramme (pour déterminer l'activité enzymatique du pancréas et du foie).
En fonction des manifestations cliniques, des tests de laboratoire supplémentaires peuvent être recommandés par un spécialiste.
Diagnostic instrumental
En plus des tests de laboratoire, des examens échographiques des organes abdominaux, des reins et de la glande thyroïde sont prescrits.
Diagnostic différentiel
L'odeur d'acétone dans la bouche ne constitue pas une unité nosologique distincte, mais fait partie intégrante du complexe symptomatique de nombreuses maladies. Elle peut apparaître aussi bien lors de maladies graves associées à un dysfonctionnement métabolique que lors d'erreurs alimentaires banales. Un spécialiste doit étudier attentivement l'anamnèse et les résultats des recherches afin d'établir un diagnostic précis et de prescrire un traitement adapté. Dans chaque cas, il est nécessaire de différencier les affections à l'aide de méthodes de laboratoire et de recherche instrumentale. La stratégie et la réussite du traitement dépendent de l'exactitude du diagnostic.
Traitement odeur de l'haleine d'acétone
L'halitose acétonique n'est pas une maladie indépendante. Le traitement consiste à corriger la pathologie sous-jacente à l'origine de l'odeur d'acétone dans la bouche. Diabète insulinodépendant: l'administration d'insuline à vie est prescrite à une dose strictement définie. Diabète de type 2: prise de médicaments réduisant la glycémie.
Le syndrome acétonémique chez l'enfant est une situation particulière. Il débute par des crises de nausées et de vomissements, entraînant de graves troubles de l'équilibre hydro-électrolytique et une chute brutale de la glycémie. Le traitement consiste à combler les besoins en glucose de l'enfant et à rétablir l'équilibre hydro-électrolytique. Il est recommandé de boire du thé sucré ou une infusion de fruits secs. Des solutions aqueuses de médicaments favorisant le rétablissement de l'équilibre hydro-électrolytique sont recommandées: Rehydron, Humana-Electrolyte.
Regidron. Le sachet est dilué dans 1 litre d'eau tiède et pris à raison de 5 à 10 ml/1 kg de poids corporel du patient pendant 1 heure ou après chaque vomissement. Aucun effet secondaire n'est observé à dose thérapeutique.
Il existe une certaine règle qui peut être suivie pour reconstituer le volume de liquide et d'électrolytes dans le corps d'un enfant en cas de nausées et de vomissements: vous devez boire par petites portions (5 à 15 ml), mais toutes les 10 à 15 minutes.
Si les vomissements de l'enfant sont devenus incontrôlables, l'état de santé général s'est aggravé (léthargie, faiblesse, apathie se sont aggravées), des douleurs abdominales sans localisation claire peuvent apparaître, une consultation spécialisée est alors nécessaire sur la question d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier et d'une thérapie par perfusion.
Pour reconstituer le volume de liquide dans le corps, des solutions pour perfusions goutte à goutte sont utilisées: réosorbilact, sorbilact, trisol, disol, solution de Ringer, néohémodes.
Trisol. La solution est administrée goutte à goutte à raison de 40 à 120 gouttes par minute, préchauffée à une température de 36 à 38 °C. La quantité de solution autorisée par heure est de 7 à 10 % du poids corporel du patient. Pendant la perfusion, il est nécessaire de surveiller la composition électrolytique du sang afin d'éviter une hyperkaliémie, susceptible d'avoir un effet délétère sur le cœur.
Solution de Ringer. Ce médicament est idéal pour la compensation parentérale des déficits volémiques. La posologie autorisée chez l'adulte est de 1 à 2 litres de solution par jour. Le traitement par la solution de Ringer doit être interrompu lorsque les paramètres hémodynamiques sont revenus à la normale. Avant et pendant l'utilisation de la solution, il est nécessaire de surveiller le taux d'électrolytes dans le sang. Peut provoquer une hyperkaliémie et une hypernatrémie. À utiliser avec prudence chez les patients âgés et en période postopératoire.
En milieu hospitalier, on prescrit des médicaments qui agissent sur le centre du vomissement du cerveau: métoclopramide, cérucal, osétron, ondansétron, etc. Les antiémétiques sont prescrits principalement sous forme de solutions pour administration intramusculaire ou intraveineuse.
Cérucal ou métoclopramide. Ce médicament est destiné à une administration parentérale pour soulager les vomissements. Dans le traitement des vomissements acétonémiques, il n'est pas prescrit sur une longue durée, ce qui minimise le risque d'effets secondaires. L'hypersensibilité aux composants constitue une exception. Posologies thérapeutiques: adultes et adolescents (plus de 14 ans): 10 mg de métoclopramide (1 ampoule) 3 à 4 fois par jour; enfants (de 3 à 14 ans): 0,1 mg de métoclopramide/kg de poids corporel.
Utiliser avec une extrême prudence chez les patients présentant une insuffisance rénale.
Osétron. Utilisé pour soulager les vomissements. Solution pour injections intramusculaires, intraveineuses et perfusions intraveineuses. Osétron peut être dilué avec une solution de glucose à 5 %, une solution de Ringer ou une solution physiologique de chlorure de sodium. Des solutions en ampoules de 4 mg et 8 mg sont généralement utilisées. La posologie et la fréquence d'utilisation du médicament sont déterminées par le médecin. Déconseillé aux patients présentant une hypersensibilité aux composants, aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 2 ans.
Dans les familles où un membre souffre de cétonurie ou de crises acétonémiques, des bandelettes de test spéciales pour déterminer le taux de corps acétoniques dans les urines sont nécessaires. Ces tests sont vendus en pharmacie.
Après une crise acétonémique, un corps affaibli a besoin de complexes vitaminiques: askorutin, revit, undevit.
Traitement de physiothérapie
Les experts recommandent de boire des eaux minérales alcalines spéciales (Borjomi, Luzhanskaya), mais vous devez d'abord vous débarrasser des gaz.
Le médecin traitant peut décider de la nécessité d'une cure de lavements alcalins chauds (jusqu'à 41 °C) (solution de soude à 3 % ou 5 %) pour éliminer l'acidose. Avant d'administrer un lavement à la soude, il est nécessaire de nettoyer le côlon.
Remèdes populaires
En médecine traditionnelle, il existe des recettes qui aident à améliorer la digestion et à réduire l'odeur d'acétone dans la bouche. Il ne faut cependant pas oublier qu'il s'agit d'une mesure temporaire, car il est nécessaire d'éliminer la cause de l'halitose acétonique.
Vous pouvez préparer des compotes ou des jus de canneberges, d'argousier, ainsi que des décoctions et des infusions de cynorhodons. Ces baies ont un effet bénéfique sur l'organisme: elles renforcent le système immunitaire, améliorent le métabolisme et normalisent le tractus gastro-intestinal.
Traitement à base de plantes
En médecine traditionnelle, les mûres sont utilisées contre le diabète, la gastrite, les ulcères d'estomac, l'entérite chronique, les intoxications alimentaires, la dysenterie, les maladies du foie, la diarrhée, les inflammations des reins et de la vessie, les maladies des gencives et les aphtes de la muqueuse buccale. Ses fruits contiennent du glucose, du fructose, du saccharose, de l'acide ascorbique, du carotène, de la vitamine E et des acides organiques. Ses feuilles contiennent une grande quantité d'acide ascorbique.
La centaurée est largement utilisée. Elle est utilisée contre la gastrite avec augmentation de la sécrétion gastrique, l'indigestion, la fièvre, les vomissements, les maladies du foie, le diabète, ainsi que comme agent cholérétique et vermifuge. La centaurée contient des alcaloïdes, divers glycosides, des acides ascorbique et oléique, et de l'huile essentielle.
Infusion chaude: verser 1 à 2 cuillères à café de matière première dans un verre d’eau bouillante et laisser infuser 5 minutes. L’infusion se prend tout au long de la journée.
Homéopathie
Arsenicum album est un médicament à base d'arsenic. Il est utilisé en cas de syndrome acétonémique, de maladies d'origine infectieuse, accompagnées d'acidose et de faiblesse générale prononcée. L'utilisation d'une dose d'Arsenicum album CH30 peut réduire significativement la gravité du syndrome acétonémique, soulageant ainsi les symptômes de la maladie sous-jacente. Dissoudre 5 à 20 granules dans un demi-verre d'eau bouillante. Boire une gorgée (une cuillère à café) toutes les 5 à 20 minutes.
Vertigoheel est un médicament antiémétique homéopathique.
Il a un effet tonique sur le système nerveux et un effet vasodilatateur. Il est utilisé pour soulager les vomissements survenant lors de vertiges d'origine neurogène et vasculaire, ainsi que dans les formes légères de traumatismes crâniens. Le médicament se prend à raison d'un comprimé trois fois par jour. En cas de crises intenses de vertiges et de nausées, commencer par 10 gouttes ou 1 comprimé toutes les 15 minutes pendant 1 à 2 heures.
Nux Vomica Homaccord est un médicament homéopathique antiémétique.
A un effet antispasmodique et antiphlogistique sur les intestins. Utilisé pour soulager les maux de tête, a un effet bénéfique sur le foie et les troubles digestifs. Prendre 10 gouttes 3 fois par jour.
Régime pour l'haleine acétonique
Pendant la période aiguë de la maladie, avec l'apparition d'une forte odeur d'acétone dans la bouche, un régime alimentaire est suivi, avec une consommation abondante de boissons obligatoire (s'il n'y a pas de restriction sur la quantité de liquide consommée). Les aliments gras et protéinés, les produits carnés, les viennoiseries fraîches, les fruits et légumes frais, ainsi que le lait entier sont exclus. L'alimentation doit être facile à digérer et principalement riche en glucides: bouillie légère à l'eau, pommes au four, crackers, thé. Après une semaine, les produits laitiers fermentés sont introduits dans l'alimentation. Après deux semaines, la viande maigre bouillie et les bananes sont autorisées. La gamme des produits autorisés s'élargit progressivement, à l'exception du lait (dont la consommation doit être abandonnée pendant 1 à 2 mois).
La prévention
Les mesures préventives sont les suivantes:
- respect de la routine quotidienne;
- dormir (au moins 8 heures par jour);
- rester à l'extérieur;
- cours d'éducation physique avec des exercices mesurés et réguliers sans intensité excessive;
- apport quotidien de traitements de l'eau.
Il faut éviter la surchauffe au soleil et la surcharge du système nerveux, il faut maintenir une alimentation adéquate.
En période d'intercrise, le médecin traitant peut recommander des médicaments qui normalisent le métabolisme lipidique, des agents hépatoprotecteurs, des sédatifs (principalement des préparations à base de plantes: valériane, agripaume, persen, novo-passit, sedasena forte, etc.); des stimulants de l'appétit (suc gastrique, abomin, vitamines B1, B6); des médicaments de thérapie de remplacement enzymatique.
Si le syndrome acétonémique réapparaît, des cycles réguliers (au moins deux fois par an) de traitement préventif anti-rechute pour la maladie sous-jacente sont nécessaires.
Prévoir
Le pronostic du syndrome acétonémique est favorable. Avec l'âge, les crises acétonémiques cessent de se produire. Un accès rapide à un médecin et un traitement adapté à la maladie sous-jacente permettent de stopper l'acidocétose.
L'odeur d'acétone dans la bouche est un signal envoyé par l'organisme indiquant un dysfonctionnement. Il est impératif de réagir à ce message. N'hésitez pas à consulter un médecin. Un spécialiste qualifié pourra examiner votre état de santé et déterminer quel système corporel est à l'origine de l'apparition de composés acétoniques. En connaissant la cause, il sera plus facile de se débarrasser de l'odeur d'acétone.
 [ 11 ]
[ 11 ]

