Expert médical de l'article
Nouvelles publications
Maladie de Huntington
Dernière revue: 05.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.
Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.
Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.
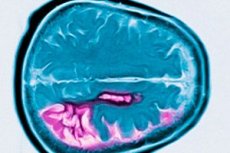
La maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative autosomique dominante caractérisée par un déclin cognitif progressif, des mouvements involontaires et une altération de la coordination motrice débutant à l'âge mûr. Le diagnostic est confirmé par des tests génétiques. Le traitement est principalement symptomatique. Un test génétique peut être recommandé pour les parents consanguins. George Huntington a décrit la maladie pour la première fois en 1872, après avoir étudié un cas familial chez des habitants de Long Island.
La prévalence de la maladie de Huntington est d'environ 10 cas pour 100 000 habitants. Compte tenu de son apparition tardive, environ 30 personnes sur 100 000 ont un risque de 50 % de la développer au cours de leur vie. Bien que la maladie se déclare le plus souvent entre 35 et 40 ans, la fourchette d'âge d'apparition est assez large, le plus précoce se manifestant à 3 ans et le plus tard à 90 ans. Si l'on pensait initialement que la maladie avait une pénétrance de 100 %, on estime aujourd'hui que ce n'est pas toujours le cas. Chez les personnes ayant hérité du gène responsable de la maladie de leur père, la maladie se manifeste en moyenne 3 ans plus tôt que chez celles ayant hérité du gène pathologique de leur mère. Chez environ 80 % des patients ayant hérité du gène pathologique de leur père, la maladie se manifeste avant 20 ans. Ce phénomène de manifestation précoce d'une anomalie génétique chez la descendance est appelé anticipation.
 [ 1 ]
[ 1 ]
Quelles sont les causes de la maladie de Huntington?
La maladie de Huntington ne présente aucune distinction de sexe. On observe une atrophie du noyau caudé, où les petits neurones dégénèrent et où le taux de neurotransmetteurs – acide gamma-aminobutyrique (GABA) et substance P – chute.
Un gène mutant présentant un nombre accru (« expansion ») de séquences d'ADN CAG (cystéine-alanine-glycine) codant pour l'acide aminé glutamine est responsable du développement de la maladie de Huntington. Le produit de ce gène, la grande protéine huntingtine, contient une quantité excessive de résidus de polyglutamine, ce qui entraîne la maladie par un mécanisme inconnu. Plus le nombre de répétitions CAG est élevé, plus la maladie apparaît précocement et plus son évolution est grave. De génération en génération, le nombre de répétitions peut augmenter, ce qui, avec le temps, entraîne une aggravation du phénotype familial.
Malgré un intérêt considérable pour les modifications génétiques et biochimiques de la maladie de Parkinson, la recherche d'un gène responsable de la maladie resta infructueuse jusqu'à la fin des années 1970. À cette époque, Nancy Wexler et Allan Tobin organisèrent un atelier parrainé par la Fondation des maladies héréditaires afin de discuter d'une stratégie pour trouver un gène responsable de la maladie de Huntington. David Housman, David Botstein et Ray White, présents à la réunion, suggérèrent que les techniques d'ADN recombinant récemment développées pourraient contribuer à atteindre cet objectif. L'une des tâches principales du projet consistait à identifier une grande famille présentant plusieurs générations de personnes atteintes de la maladie de Huntington afin d'obtenir des échantillons d'ADN. En 1979, un projet conjoint de scientifiques vénézuéliens et américains fut lancé pour examiner une grande famille atteinte de la maladie de Huntington vivant sur les rives du lac Maracheibo (Venezuela). En 1983, le gène de la maladie de Huntington a été localisé à l'extrémité du bras court du chromosome 4 (Gusella et al., 1983), et une décennie plus tard, il a été révélé que la mutation de ce gène consistait en une augmentation du nombre de répétitions du trinucléotide cytosine-adénine-guanine (CAG) (Huntington's Disease Collaborative Research Group, 1993). La méthodologie développée par ce groupe scientifique est actuellement considérée comme la norme pour le clonage positionnel de nouveaux gènes.
Alors que le gène sauvage présente une séquence de 10 à 28 répétitions CAG, la forme mutante du gène responsable de la maladie de Huntington présente une séquence accrue, passant de 39 à plus de 100 répétitions CAG. La découverte de l'expansion des répétitions de trinucléotides a contribué à expliquer de nombreuses caractéristiques cliniques de la maladie. En particulier, une corrélation inverse a été établie entre l'âge d'apparition et la longueur de la région comportant des trinucléotides répétés. L'anticipation d'une transmission paternelle peut s'expliquer par le fait qu'une augmentation du nombre de répétitions se produit souvent chez l'homme pendant la spermatogenèse. L'analyse des nouvelles mutations a montré qu'elles surviennent généralement lorsque l'un des parents, généralement le père, présentait un nombre de répétitions CAG supérieur à 28; dans ce cas, le nombre de ces répétitions augmentait à la génération suivante. Il est désormais établi que si le nombre de répétitions ne dépasse pas 28, la transmission de la maladie se fait de manière stable de génération en génération. Si le nombre de répétitions est compris entre 29 et 35, les symptômes de la maladie de Huntington n'apparaissent pas, mais la transmission à la descendance peut entraîner une augmentation de la longueur de cette région. Si le nombre de répétitions est compris entre 36 et 39, la maladie peut, dans certains cas (mais pas toujours), se manifester cliniquement (pénétrance incomplète) et, lors de la transmission à la descendance, une augmentation du nombre de répétitions de trinucléotides est possible. Si le nombre de répétitions dépasse 40, la maladie survient dans la quasi-totalité des cas et, lors de la transmission à la descendance, une expansion supplémentaire des répétitions est possible. Les raisons de cette augmentation du nombre de répétitions restent inconnues.
Pathomorphologie de la maladie de Huntington
La maladie de Huntington se caractérise par une perte neuronale principalement au niveau du noyau caudé et du putamen, et dans une certaine mesure également au niveau du cortex et d'autres structures cérébrales. Dans la maladie de Huntington, le poids cérébral total est réduit non seulement par une diminution du nombre de neurones, mais aussi par une perte de substance blanche. Dans le cortex cérébral, les cellules des couches V et VI sont les plus touchées. La gravité des modifications dégénératives micro- et macroscopiques (ajustées selon l'âge au décès) est corrélée au nombre de répétitions CAG. Une analyse pathologique détaillée des modifications observées dans plusieurs centaines de cas de maladie de Huntington a montré que la dégénérescence du striatum débute dans la partie dorsomédiale du noyau caudé et la partie dorsolatérale du putamen, puis se propage ventralement. Différents groupes de neurones du noyau caudé et du putamen sont affectés à des degrés divers. Les interneurones du striatum restent relativement intacts, mais certains neurones de projection sont affectés de manière sélective. Dans la forme juvénile de la maladie de Huntington, les modifications pathomorphologiques du striatum sont plus prononcées et plus étendues, impliquant le cortex cérébral, le cervelet, le thalamus et le globus pallidus.
Modifications neurochimiques dans la maladie de Huntington
GABA. Des études neurochimiques cérébrales chez des patients atteints de la maladie de Huntington ont révélé une diminution significative de la concentration de GABA dans le striatum. Des études ultérieures ont confirmé que la maladie de Huntington est associée à une diminution du nombre de neurones GABAergiques et ont montré que les concentrations de GABA sont réduites non seulement dans le striatum, mais aussi dans ses zones de projection: les segments externe et interne du globus pallidus et la substance noire. Dans le cerveau des patients atteints de la maladie de Huntington, des modifications des récepteurs GABA ont également été détectées grâce à des études de liaison aux récepteurs et à l'hybridation in situ de l'ARNm. Le nombre de récepteurs GABA était modérément réduit dans le noyau caudé et le putamen, mais augmentait dans la partie réticulaire de la substance noire et le segment externe du globus pallidus, ce qui est probablement dû à une hypersensibilité à la dénervation.
Acétylcholine. L'acétylcholine est utilisée comme neurotransmetteur par les gros interneurones non épineux du striatum. Des études post-mortem précoces chez des patients atteints de la maladie de Huntington ont montré une diminution de l'activité de la choline acétyltransférase (ChAT) dans le striatum, suggérant une perte de neurones cholinergiques. Cependant, comparés à la réduction significative des neurones GABAergiques, les interneurones cholinergiques sont relativement épargnés. Par conséquent, la densité des neurones acétylcholinestérase-positifs et l'activité de la ChAT dans le striatum sont en réalité relativement élevées par rapport aux témoins du même âge.
Substance P. La substance P est présente dans de nombreux neurones épineux moyens du striatum, qui se projettent principalement vers le segment interne du globus pallidus et la substance noire et contiennent généralement aussi de la dynorphine et du GABA. Les taux de substance P dans le striatum et la pars reticularis de la substance noire sont réduits dans la maladie de Huntington. Au stade terminal de la maladie, des études immunohistochimiques ont révélé une réduction significative du nombre de neurones contenant de la substance P. Aux stades plus précoces, les neurones contenant de la substance P et se projetant vers le segment interne du globus pallidus sont relativement épargnés, comparativement à ceux se projetant vers la pars reticularis de la substance noire.
Peptides opioïdes. L'enképhaline est présente dans les neurones GABAergiques à projection épineuse moyenne de la voie indirecte, qui se projettent vers le segment externe du globus pallidus et portent les récepteurs D2. Des études immunohistochimiques ont montré que les neurones contenant de l'enképhaline se projetant vers le segment externe du globus pallidus disparaissent précocement dans la maladie de Huntington. Ces cellules meurent apparemment plus tôt que les cellules contenant de la substance P se projetant vers le segment interne du globus pallidus.
Catécholamines. Les neurones contenant des amines biogènes (dopamine, sérotonine) et projetant vers le striatum sont situés dans la partie compacte de la substance noire, du tegmentum ventral et des noyaux du raphé. Alors que les projections noradrénergiques vers le striatum humain sont minimes, les taux de sérotonine et de dopamine (par gramme de tissu) dans le striatum sont élevés, indiquant la préservation de ces projections afférentes malgré la perte marquée des neurones du striatum. Les neurones dopaminergiques de la substance noire restent intacts dans les formes classique et juvénile de la maladie de Huntington.
Somatostatine/neuropeptide Y et monoxyde d'azote synthétase. La mesure des taux de somatostatine et de neuropeptide Y dans le striatum chez les patients atteints de la maladie de Huntington a révélé une augmentation de 4 à 5 fois par rapport aux tissus normaux. Les études immunohistochimiques ont montré une préservation absolue des interneurones striataux contenant le neuropeptide Y, la somatostatine et la monoxyde d'azote synthétase. Ces neurones sont donc résistants au processus pathologique.
Acides aminés excitateurs. Il a été suggéré que la mort cellulaire sélective dans la maladie de Huntington soit due à un effet neurotoxique induit par le glutamate. Les taux de glutamate et d'acide quinolinique (une neurotoxine endogène, sous-produit du métabolisme de la sérotonine et agoniste des récepteurs du glutamate) dans le striatum de la maladie de Huntington sont légèrement modifiés, mais une étude récente utilisant la spectroscopie par résonance magnétique (IRM) a révélé une augmentation des taux de glutamate in vivo. Le taux de l'enzyme gliale responsable de la synthèse de l'acide quinolinique dans le striatum de la maladie de Huntington est environ cinq fois supérieur à la normale, tandis que l'activité de l'enzyme assurant la dégradation de l'acide quinolinique n'est augmentée que de 20 à 50 % dans la maladie de Huntington. Ainsi, la synthèse de l'acide quinolinique pourrait être augmentée dans la maladie de Huntington.
Des études sur les récepteurs des acides aminés excitateurs (EAA) dans la maladie de Huntington ont révélé une réduction significative du nombre de récepteurs NMDA, AMPA, kaïnate et glutamate métabotropique dans le striatum, ainsi que de récepteurs AMPA et kaïnate dans le cortex cérébral. Au stade avancé de la maladie de Huntington, les récepteurs NMDA étaient quasiment absents, tandis qu'aux stades préclinique et précoce, une réduction significative de leur nombre a été constatée.
Sensibilité sélective. Dans la maladie de Huntington, certains types de cellules striatales sont sélectivement perdus. Les neurones épineux moyens, qui se projettent vers le segment externe du globus pallidus et contiennent du GABA et de l'enképhaline, meurent très tôt dans la maladie, tout comme les neurones contenant du GABA et de la substance P et se projetant vers la partie réticulaire de la substance noire. La perte de neurones contenant du GABA et de l'enképhaline et se projetant vers le segment externe du globus pallidus désinhibe cette structure, ce qui entraîne une inhibition active du noyau sous-thalamique. La diminution de l'activité du noyau sous-thalamique pourrait expliquer les mouvements choréiformes observés dans la maladie de Huntington. On sait depuis longtemps que des lésions focales du noyau sous-thalamique peuvent provoquer une chorée. La perte de neurones à GABA et à substance P se projetant vers la partie réticulaire de la substance noire est probablement responsable des troubles oculomoteurs observés dans la maladie de Huntington. Cette voie inhibe normalement les neurones de la substance noire réticulée se projetant vers le colliculus supérieur, lesquels régulent à leur tour les saccades. Dans la maladie de Huntington juvénile, les voies mentionnées ci-dessus sont plus sévèrement affectées et, de plus, les projections striatales vers le segment interne du globus pallidus sont perdues précocement.
La protéine huntingtine, codée par le gène dont la mutation est responsable de la maladie de Huntington, est présente dans diverses structures du cerveau et d'autres tissus. Normalement, la huntingtine est principalement présente dans le cytoplasme des neurones. Cette protéine est présente dans la plupart des neurones cérébraux, mais des données récentes montrent que sa teneur est plus élevée dans les neurones matriciels que dans les neurones striosomiques, et plus élevée dans les neurones de projection que dans les interneurones. Ainsi, la sensibilité sélective des neurones est corrélée à leur teneur en huntingtine, normalement présente dans certaines populations neuronales.
Comme dans le cerveau des patients atteints de la maladie de Huntington, chez les souris transgéniques pour le fragment N-terminal du gène de la maladie de Huntington présentant un nombre accru de répétitions, la huntingtine forme des agrégats denses dans le noyau des neurones. Ces inclusions intranucléaires se forment dans les neurones de projection striatale (mais pas dans les interneurones). Chez les souris transgéniques, les inclusions se forment plusieurs semaines avant l'apparition des symptômes. Ces données suggèrent que la protéine huntingtine, contenant un nombre accru de résidus de glutamine dont les inclusions codent pour des répétitions trinucléotidiques, ou un fragment de celle-ci, s'accumule dans le noyau et peut par conséquent altérer son contrôle des fonctions cellulaires.
Symptômes de la maladie de Huntington
L'âge d'apparition des premiers symptômes chez les patients atteints de la maladie de Huntington est difficile à déterminer avec précision, car la maladie se manifeste progressivement. Des changements de personnalité et de comportement, ainsi que des troubles légers de la coordination, peuvent survenir de nombreuses années avant l'apparition de symptômes plus évidents. Au moment du diagnostic, la plupart des patients présentent des mouvements choréiques, une altération de la coordination des mouvements fins et un ralentissement des saccades volontaires. À mesure que la maladie progresse, la capacité à organiser ses activités s'altère, la mémoire diminue, l'élocution devient difficile, les troubles oculomoteurs et la coordination des mouvements s'aggravent. Bien qu'au stade précoce, la maladie ne présente aucune modification musculaire ni posturale, des postures dystoniques peuvent se développer, qui peuvent devenir un symptôme dominant. À un stade avancé, l'élocution devient pâteuse, la déglutition devient très difficile, et la marche devient impossible. La maladie de Huntington évolue généralement sur 15 à 20 ans. Au stade terminal, le patient est impuissant et nécessite des soins constants. L'issue fatale n'est pas directement liée à la maladie primaire, mais à ses complications, par exemple une pneumonie.
Démence dans la maladie de Huntington
Code CIM-10
P02.2. Démence dans la maladie de Huntington (G10).
La démence se développe comme l'une des manifestations d'un processus dégénératif-atrophique systémique, avec atteinte prédominante du système striatal cérébral et d'autres noyaux sous-cœcaux. Elle se transmet selon le mode autosomique dominant.
En règle générale, la maladie se manifeste au cours de la troisième ou de la quatrième décennie de la vie par une hyperkinésie choréoforme (en particulier au niveau du visage, des bras, des épaules, de la démarche), des changements de personnalité (anomalies de personnalité de type excitable, hystérique et schizoïde), des troubles psychotiques (dépression particulière avec morosité, maussaderie, dysphorie; humeur paranoïaque).
La combinaison de l'hyperkinésie choréoforme, de la démence et du fardeau héréditaire est particulièrement importante pour le diagnostic. Les caractéristiques suivantes sont spécifiques à cette démence:
- progression lente (en moyenne 10-15 ans): dissociation entre la capacité restante à prendre soin de soi et une incompétence intellectuelle évidente dans des situations nécessitant un travail mental productif (pensée conceptuelle, apprentissage de nouvelles choses);
- irrégularité prononcée des performances mentales, qui est basée sur des troubles importants de l'attention et une inconstance des attitudes du patient (pensée « saccadée », semblable à l'hyperkinésie);
- atypicité des violations évidentes des fonctions corticales supérieures;
- relation inverse entre l’augmentation de la démence et la gravité des troubles psychotiques.
Compte tenu de la forte proportion de troubles psychotiques (délires paranoïaques de jalousie, de persécution) et dysphoriques dans le tableau clinique de la maladie, le traitement est effectué à l'aide de divers neuroleptiques qui bloquent les récepteurs dopaminergiques (dérivés de phénothiazine et de butyrophénone) ou réduisent le taux de dopamine dans les tissus (réserpine).
On utilise l'halopéridol (2 à 20 mg/jour), le tiapride (100 à 600 mg/jour) pendant trois mois maximum, la thioridazine (jusqu'à 100 mg/jour), la réserpine (0,25 à 2 mg/jour) et l'anticonvulsivant clonazépam (1,5 à 6 mg/jour). Ces médicaments aident à réduire l'hyperkinésie, à apaiser les tensions affectives et à compenser les troubles de la personnalité.
Le traitement hospitalier des troubles mentaux est effectué en tenant compte du syndrome principal, de l'âge et de l'état général du patient. En ambulatoire, les principes thérapeutiques sont identiques (traitement d'entretien continu des troubles du mouvement, changement périodique de médicament). Des doses plus faibles de neuroleptiques sont utilisées en ambulatoire.
Les mesures de réadaptation pour les démences légères et modérées comprennent l'ergothérapie, la psychothérapie et l'entraînement cognitif. Il est nécessaire de collaborer avec les proches et d'apporter un soutien psychologique aux personnes qui s'occupent du patient. La principale méthode de prévention de la maladie est le conseil médical et génétique des proches du patient, avec une orientation vers une analyse ADN lors de la décision de procréer.
Le pronostic est généralement défavorable. L'évolution de la maladie est lente et progressive, et elle entraîne généralement le décès après 10 à 15 ans.
 [ 18 ]
[ 18 ]
Qu'est ce qui te tracasse?
Diagnostic de la maladie de Huntington
Le diagnostic repose sur les symptômes typiques, les antécédents familiaux et les tests génétiques. En raison de l'atrophie de la tête du noyau caudé, l'IRM et le CG révèlent une dilatation des ventricules cérébraux au stade avancé de la maladie.
Traitement de la maladie de Huntington
Le traitement de la maladie de Huntington est symptomatique. La chorée et l'agitation peuvent être partiellement soulagées par des neuroleptiques (par exemple, chlorpromazine 25 à 300 mg par voie orale 3 fois par jour, halopéridol 5 à 45 mg par voie orale 2 fois par jour) ou par la réserpine 0,1 mg par voie orale une fois par jour. Les doses sont augmentées jusqu'au maximum toléré (avant l'apparition d'effets secondaires tels que somnolence, syndrome parkinsonien; pour la réserpine, hypotension). L'objectif du traitement empirique est de réduire la transmission glutamatergique via les récepteurs Nméthyl-O-aspartate et de maintenir la production d'énergie dans les mitochondries. Les traitements visant à augmenter le GABA dans le cerveau sont inefficaces.
Les tests et le conseil génétiques sont importants, car les symptômes de la maladie apparaissent après la période de procréation. Les personnes ayant des antécédents familiaux positifs et celles souhaitant se faire dépister sont orientées vers des centres spécialisés, en tenant compte de toutes les implications éthiques et psychologiques.
Traitement symptomatique de la maladie de Huntington
Il n'existe aucun traitement efficace permettant d'arrêter la progression de la maladie de Huntington. Plusieurs essais cliniques portant sur divers médicaments ont été menés, mais aucun effet significatif n'a été observé. Les neuroleptiques et autres antagonistes des récepteurs de la dopamine sont largement utilisés pour corriger les troubles mentaux et les mouvements involontaires chez les patients atteints de la maladie de Huntington. Ces mouvements reflètent un déséquilibre entre les systèmes dopaminergique et GABAergique. Par conséquent, les neuroleptiques sont utilisés pour réduire l'excès d'activité dopaminergique. Cependant, ces médicaments peuvent eux-mêmes entraîner des effets secondaires cognitifs et extrapyramidaux importants. De plus, sauf en cas de psychose ou d'agitation, leur efficacité n'a pas été démontrée. Les neuroleptiques provoquent ou aggravent souvent la dysphagie ou d'autres troubles du mouvement. Les neuroleptiques de nouvelle génération, tels que la rispéridone, la clozapine et l'olanzapine, pourraient être particulièrement utiles dans le traitement de la maladie de Huntington, car ils entraînent moins d'effets secondaires extrapyramidaux, mais peuvent réduire les symptômes paranoïaques ou l'irritabilité accrue.
La tétrabénazine et la réserpine réduisent également l'activité du système dopaminergique et peuvent atténuer la gravité des mouvements involontaires aux premiers stades de la maladie. Cependant, ces médicaments peuvent provoquer une dépression. La maladie elle-même étant souvent dépressive, cet effet secondaire limite considérablement l'utilisation de la réserpine et de la tétrabénazine. Aux stades avancés de la maladie, les cellules porteuses des récepteurs de la dopamine meurent, ce qui affaiblit, voire supprime, l'efficacité des antagonistes des récepteurs de la dopamine.
Les neuroleptiques, les antidépresseurs et les anxiolytiques sont utilisés pour traiter la psychose, la dépression et l'irritabilité chez les patients atteints de la maladie de Huntington, mais ils ne doivent être prescrits que tant que le patient présente ces symptômes. Des médicaments utiles à un stade donné de la maladie peuvent devenir inefficaces, voire nocifs, à mesure que la maladie progresse.
Les agonistes des récepteurs GABA ont été testés chez des patients atteints de la maladie de Huntington, car il a été démontré que cette maladie entraîne une diminution significative des taux de GABA dans le striatum, ainsi qu'une hypersensibilité des récepteurs GABA dans ses zones de projection. Les benzodiazépines se sont avérées efficaces dans les cas où les mouvements involontaires et les troubles cognitifs sont aggravés par le stress et l'anxiété. Il est recommandé de prescrire de faibles doses de ces médicaments afin d'éviter les effets sédatifs indésirables. Chez la plupart des patients atteints de la maladie de Huntington, aucun de ces médicaments n'entraîne d'amélioration significative de la qualité de vie.
Dans la maladie de Huntington à début précoce avec symptômes parkinsoniens, des agents dopaminergiques peuvent être essayés, mais leur efficacité est limitée. De plus, la lévodopa peut provoquer ou aggraver les myoclonies chez ces patients. Parallèlement, le baclofène peut réduire la rigidité chez certains patients atteints de la maladie de Huntington.
 [ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ]
[ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ]
Traitement préventif (neuroprotecteur) de la maladie de Huntington
Bien que le défaut génétique de la maladie de Huntington soit connu, son mécanisme de dégénérescence neuronale sélective reste flou. On suppose que les traitements préventifs visant à réduire le stress oxydatif et l'excitotoxicité pourraient potentiellement ralentir, voire stopper, la progression de la maladie. La situation pourrait être similaire à celle de la dégénérescence hépatolenticulaire, dont le défaut génétique est resté inconnu pendant de nombreuses années, mais dont les traitements préventifs ciblant l'effet secondaire, l'accumulation de cuivre, ont été « guéris ». À cet égard, l'hypothèse selon laquelle la maladie de Huntington serait associée à un trouble du métabolisme énergétique et à la mort cellulaire due à l'excitotoxicité a particulièrement retenu l'attention. La maladie elle-même pourrait entraîner la mort cellulaire par agrégation intranucléaire de fragments N-terminaux de l'huntingtine, ce qui perturbe les fonctions cellulaires et métaboliques. Ce processus pourrait affecter certains groupes de neurones plus que d'autres en raison de leur plus grande sensibilité aux lésions excitotoxiques. Dans ce cas, un traitement préventif par antagonistes des récepteurs des acides aminés excitateurs ou agents prévenant les dommages causés par les radicaux libres permettra de prévenir ou de retarder l'apparition et la progression de la maladie. Dans des modèles de laboratoire de sclérose latérale amyotrophique, il a été démontré que les agents antioxydants et les antagonistes des récepteurs (AAR) peuvent ralentir la progression de la maladie. Des approches similaires pourraient être efficaces dans la maladie de Huntington. Des essais cliniques portant sur des antagonistes des récepteurs du glutamate et des agents améliorant la fonction du complexe II de la chaîne de transport d'électrons mitochondriale sont actuellement en cours.
 [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ]
[ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ]

