Expert médical de l'article
Nouvelles publications
Système nerveux autonome
Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.
Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.
Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.
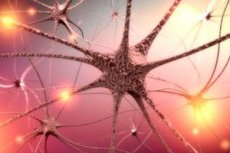
Le système nerveux autonome (systema nervosum autonomicum) est une partie du système nerveux qui contrôle les fonctions des organes internes, des glandes et des vaisseaux sanguins, et exerce un effet adaptatif et trophique sur tous les organes humains. Il maintient la constance de l'environnement interne de l'organisme (homéostasie). Son fonctionnement n'est pas contrôlé par la conscience humaine, mais dépend de la moelle épinière, du cervelet, de l'hypothalamus, des noyaux basaux du cerveau terminal, du système limbique, de la formation réticulaire et du cortex cérébral.
La distinction entre le système nerveux végétatif (autonome) et le système nerveux autonome repose sur certaines de ses caractéristiques structurelles. Parmi ces caractéristiques, on peut citer:
- localisation focale des noyaux végétatifs dans le système nerveux central;
- accumulation de corps de neurones effecteurs sous forme de nœuds (ganglions) faisant partie des plexus autonomes périphériques;
- nature bineuronale de la voie nerveuse allant des noyaux du système nerveux central à l'organe innervé;
- préservation de caractéristiques reflétant une évolution plus lente du système nerveux autonome (en comparaison avec le système nerveux animal): calibre plus petit des fibres nerveuses, vitesse de conduction de l'excitation plus faible, absence de gaine de myéline dans de nombreux conducteurs nerveux.
Le système nerveux autonome est divisé en sections centrales et périphériques.
Le département central comprend:
- noyaux parasympathiques des paires III, VII, IX et X de nerfs crâniens situés dans le tronc cérébral (mésencéphale, pont, bulbe rachidien);
- noyaux sacrés parasympathiques situés dans la matière grise des trois segments sacrés de la moelle épinière (SII-SIV);
- noyau végétatif (sympathique) situé dans la colonne intermédiaire latérale [matière grise intermédiaire latérale] du VIIIe segment cervical, de tous les segments thoraciques et des deux segments lombaires supérieurs de la moelle épinière (CVIII-ThI-LII).
La partie périphérique du système nerveux autonome comprend:
- nerfs végétatifs (autonomes), branches et fibres nerveuses émergeant du cerveau et de la moelle épinière;
- plexus viscéraux végétatifs (autonomes);
- nœuds des plexus végétatifs (autonomes, viscéraux);
- tronc sympathique (droit et gauche) avec ses nœuds, ses branches internodales et de connexion et ses nerfs sympathiques;
- nœuds de la partie parasympathique du système nerveux autonome;
- fibres végétatives (parasympathiques et sympathiques) qui vont vers la périphérie (vers les organes, les tissus) à partir des nœuds végétatifs qui font partie des plexus et situés dans l'épaisseur des organes internes;
- terminaisons nerveuses impliquées dans les réactions autonomes.
Les neurones des noyaux de la partie centrale du système nerveux autonome sont les premiers neurones efférents sur les voies reliant le SNC (moelle épinière et cerveau) à l'organe innervé. Les fibres formées par les prolongements de ces neurones sont appelées fibres nerveuses préganglionnaires, car elles rejoignent les nœuds de la partie périphérique du système nerveux autonome et se terminent par des synapses sur les cellules de ces nœuds.
Les nœuds végétatifs font partie des troncs sympathiques, des grands plexus végétatifs de la cavité abdominale et du bassin, et sont également situés dans l'épaisseur ou à proximité des organes des systèmes digestif, respiratoire et génito-urinaire, qui sont innervés par le système nerveux autonome.
La taille des nœuds végétatifs est déterminée par le nombre de cellules qu'ils contiennent, qui varie de 3 000 à 5 000, voire plusieurs milliers. Chaque nœud est enfermé dans une capsule de tissu conjonctif dont les fibres, pénétrant profondément dans le nœud, le divisent en lobes (secteurs). Entre la capsule et le corps du neurone se trouvent des cellules satellites, des cellules gliales.
Les cellules gliales (cellules de Schwann) comprennent les neurolemmocytes, qui forment les gaines des nerfs périphériques. Les neurones des ganglions autonomes se divisent en deux types principaux: les cellules de Dogel de type I et de type II. Les cellules de Dogel de type I sont efférentes et se terminent par des prolongements préganglionnaires. Ces cellules se caractérisent par un axone long, fin et non ramifié, et de nombreuses dendrites (de 5 à plusieurs dizaines) se ramifiant près du corps du neurone. Ces cellules possèdent plusieurs prolongements légèrement ramifiés, parmi lesquels se trouve un axone. Elles sont plus grandes que les neurones de Dogel de type I. Leurs axones établissent une connexion synaptique avec les neurones efférents de Dogel de type I.
Les fibres préganglionnaires possèdent une gaine de myéline, ce qui explique leur couleur blanchâtre. Elles quittent le cerveau en formant les racines des nerfs crâniens et spinaux correspondants. Les nœuds périphériques du système nerveux autonome contiennent les corps des seconds neurones efférents (effecteurs) situés sur les voies d'accès aux organes innervés. Les prolongements de ces seconds neurones, qui transmettent l'influx nerveux des nœuds autonomes aux organes actifs (muscles lisses, glandes, vaisseaux, tissus), sont des fibres nerveuses postganglionnaires. Dépourvues de gaine de myéline, elles sont grises.
La vitesse de conduction des impulsions le long des fibres préganglionnaires sympathiques est de 1,5 à 4 m/s, et celle des fibres parasympathiques de 10 à 20 m/s. La vitesse de conduction des impulsions le long des fibres postganglionnaires (non myélinisées) ne dépasse pas 1 m/s.
Les corps des fibres nerveuses afférentes du système nerveux autonome sont situés dans les nœuds spinaux (intervertébraux), ainsi que dans les nœuds sensoriels des nerfs crâniens; dans les nœuds sensoriels propres du système nerveux autonome (cellules de Dogel de type II).
La structure de l'arc réflexe autonome diffère de celle de l'arc réflexe de la partie somatique du système nerveux. L'arc réflexe du système nerveux autonome possède une liaison efférente composée de deux neurones au lieu d'un seul. En général, un arc réflexe autonome simple est représenté par trois neurones. Le premier maillon de l'arc réflexe est un neurone sensoriel, dont le corps est situé dans les ganglions spinaux ou les ganglions des nerfs crâniens. Le prolongement périphérique de ce neurone, doté d'une terminaison sensitive (un récepteur), prend naissance dans les organes et les tissus. Le prolongement central, intégré aux racines postérieures des nerfs spinaux ou aux racines sensitives des nerfs crâniens, est dirigé vers les noyaux végétatifs correspondants de la moelle épinière ou du cerveau. La voie efférente (sortante) de l'arc réflexe autonome est représentée par deux neurones. Le corps du premier de ces neurones, le second dans un arc réflexe autonome simple, est situé dans les noyaux autonomes du système nerveux central. Ce neurone peut être qualifié d'intercalaire, car il est situé entre la liaison sensitive (afférente, afférente) de l'arc réflexe et le troisième neurone (efférent, efférent) de la voie efférente. Le neurone effecteur est le troisième neurone de l'arc réflexe autonome. Les corps des neurones effecteurs sont situés dans les nœuds périphériques du système nerveux autonome (tronc sympathique, nœuds autonomes des nerfs crâniens, nœuds des plexus autonomes extra- et intra-organiques). Les prolongements de ces neurones sont dirigés vers les organes et les tissus dans le cadre des nerfs autonomes organiques ou mixtes. Les fibres nerveuses postganglionnaires se terminent dans les muscles lisses, les glandes, dans les parois des vaisseaux sanguins et dans d'autres tissus avec les appareils nerveux terminaux correspondants.
Sur la base de la topographie des noyaux et des nœuds autonomes, des différences de longueur des premier et deuxième neurones de la voie efférente, ainsi que des caractéristiques des fonctions, le système nerveux autonome est divisé en deux parties: sympathique et parasympathique.
Physiologie du système nerveux autonome
Le système nerveux autonome contrôle la pression artérielle (PA), la fréquence cardiaque (FC), la température et le poids corporels, la digestion, le métabolisme, l'équilibre hydrique et électrolytique, la transpiration, la miction, la défécation, la sexualité et d'autres processus. De nombreux organes sont principalement contrôlés par le système sympathique ou parasympathique, bien qu'ils puissent recevoir des informations des deux parties du système nerveux autonome. Le plus souvent, l'action des systèmes sympathique et parasympathique sur un même organe est directement opposée: par exemple, la stimulation sympathique augmente la fréquence cardiaque, tandis que la stimulation parasympathique la diminue.
Le système nerveux sympathique favorise l'activité intense de l'organisme (processus cataboliques) et assure hormonalement la phase de « combat ou fuite » de la réponse au stress. Ainsi, les signaux efférents sympathiques augmentent la fréquence cardiaque et la contractilité myocardique, provoquent une bronchodilatation, activent la glycogénolyse hépatique et la libération de glucose, augmentent le métabolisme de base et la force musculaire; et stimulent également la transpiration palmaire. Les fonctions vitales moins importantes en situation de stress (digestion, filtration rénale) sont réduites sous l'influence du système nerveux autonome sympathique. En revanche, le processus d'éjaculation est entièrement sous le contrôle de la division sympathique du système nerveux autonome.
Le système nerveux parasympathique contribue à restaurer les ressources de l'organisme, c'est-à-dire à assurer les processus anaboliques. Le système nerveux autonome parasympathique stimule la sécrétion des glandes digestives et la motilité du tube digestif (y compris l'évacuation), réduit le rythme cardiaque et la tension artérielle, et assure l'érection.
Les fonctions du système nerveux autonome sont assurées par deux neurotransmetteurs principaux: l'acétylcholine et la noradrénaline. Selon la nature chimique du médiateur, les fibres nerveuses sécrétant l'acétylcholine sont dites cholinergiques; ce sont toutes des fibres parasympathiques préganglionnaires et postganglionnaires. Les fibres sécrétant la noradrénaline sont dites adrénergiques; ce sont la plupart des fibres sympathiques postganglionnaires, à l'exception de celles innervant les vaisseaux sanguins, les glandes sudoripares et les muscles arectores pilorum, qui sont cholinergiques. Les glandes sudoripares palmaires et plantaires répondent partiellement à la stimulation adrénergique. On distingue des sous-types de récepteurs adrénergiques et cholinergiques selon leur localisation.
Évaluation du système nerveux autonome
Un dysfonctionnement autonome peut être suspecté en présence de symptômes tels qu'une hypotension orthostatique, une intolérance aux températures élevées et une perte du contrôle intestinal et vésical. La dysfonction érectile est l'un des premiers symptômes du dysfonctionnement autonome. La xérophtalmie et la xérostomie ne sont pas des symptômes spécifiques du dysfonctionnement autonome.
 [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]
[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]
Examen physique
Une diminution prolongée de la pression artérielle systolique de plus de 20 mm Hg ou diastolique de plus de 10 mm Hg après la mise en position verticale (en l'absence de déshydratation) suggère la présence d'un dysfonctionnement autonome. Il convient d'être attentif aux variations de la fréquence cardiaque (FC) pendant la respiration et lors des changements de position. L'absence d'arythmie respiratoire et une augmentation insuffisante de la FC après la mise en position verticale indiquent un dysfonctionnement autonome.
Un myosis et un ptosis modéré (syndrome de Horner) indiquent des lésions de la division sympathique du système nerveux autonome, et une pupille dilatée qui ne réagit pas à la lumière (pupille d'Adie) indique des lésions du système nerveux autonome parasympathique.
Des réflexes urogénitaux et rectaux anormaux peuvent également être des symptômes d'insuffisance du système nerveux autonome. L'examen comprend l'évaluation du réflexe crémastérien (normalement, le frottement de la peau de la cuisse entraîne une élévation des testicules), du réflexe anal (normalement, le frottement de la peau périanale entraîne une contraction du sphincter anal) et du réflexe bulbocaverneux (normalement, la compression du gland ou du clitoris entraîne une contraction du sphincter anal).
Recherche en laboratoire
En présence de symptômes de dysfonctionnement autonome, afin de déterminer la gravité du processus pathologique et une évaluation quantitative objective de la régulation autonome du système cardiovasculaire, un test cardiovagal, des tests de sensibilité des récepteurs α-drénergiques périphériques et une évaluation quantitative de la transpiration sont effectués.
Le test quantitatif du réflexe axonal sudomoteur permet de vérifier la fonction des neurones postganglionnaires. La sudation locale est stimulée par iontophorèse à l'acétylcholine. Des électrodes sont placées sur les tibias et les poignets. L'intensité de la sudation est enregistrée par un sudomètre spécial qui transmet les informations sous forme analogique à un ordinateur. Le test peut se traduire par une diminution, une absence ou une persistance de la sudation après l'arrêt de la stimulation. Le test de thermorégulation permet d'évaluer l'état des voies de conduction préganglionnaires et postganglionnaires. Les tests au colorant sont beaucoup moins utilisés pour évaluer la fonction sudorale. Après application du colorant sur la peau, le patient est placé dans une pièce fermée chauffée jusqu'à obtention d'une sudation maximale; la transpiration entraîne un changement de couleur du colorant, révélant des zones d'anhidrose et d'hypohidrose et permettant leur analyse quantitative. L'absence de sudation indique une lésion de la partie efférente de l'arc réflexe.
Les tests cardio-vagaux évaluent la réponse de la fréquence cardiaque (enregistrement et analyse de l'ECG) à la respiration profonde et à la manœuvre de Valsalva. Si le système nerveux autonome est intact, l'augmentation maximale de la fréquence cardiaque est observée après le 15e battement et une diminution après le 30e. Le rapport entre les intervalles RR du 15e au 30e battement (c'est-à-dire de l'intervalle le plus long au plus court) – le rapport 30:15 – est normalement de 1,4 (rapport de Valsalva).
Les tests de sensibilité des adrénorécepteurs périphériques comprennent la mesure de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle lors du test d'inclinaison (test orthostatique passif) et du test de Valsalva. Lors du test orthostatique passif, le volume sanguin est redistribué aux parties sous-jacentes du corps, provoquant des réponses hémodynamiques réflexes. Le test de Valsalva évalue les variations de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque résultant d'une augmentation de la pression intrathoracique (et d'une diminution du flux veineux), provoquant des variations caractéristiques de la pression artérielle et une vasoconstriction réflexe. Normalement, les modifications des paramètres hémodynamiques se produisent sur une période de 1,5 à 2 minutes et comportent 4 phases, au cours desquelles la pression artérielle augmente (phases 1 et 4) ou diminue après une récupération rapide (phases 2 et 3). La fréquence cardiaque augmente dans les 10 premières secondes. Si le système sympathique est affecté, un blocage de la réponse se produit lors de la 2e phase.

