Expert médical de l'article
Nouvelles publications
Intoxication aiguë à l'atropine: signes, traitement
Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.
Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.
Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.
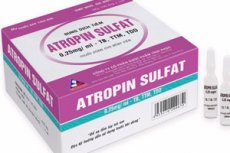
L'atropine est largement utilisée en médecine seule sous forme de sulfate et entre dans la composition de nombreux médicaments complexes: antiasthmatiques (Solutan, Franol), antispasmodiques (Besalol, Spazmoveralgin) et autres. Elle est utilisée en ophtalmologie et en psychiatrie. L'intoxication à l'atropine survient suite à un surdosage accidentel ou intentionnel. L'effet des doses toxiques s'explique par la capacité de cette substance à provoquer un délire atropinique – un état similaire à celui des narcotiques, avec altération de la conscience (hallucinations et délire), pouvant aller jusqu'à la mort par paralysie respiratoire.
L'atropine est isolée chimiquement à partir de matières végétales. Son prédécesseur, l'hyoscyamine, un alcaloïde naturel encore plus actif, est présent dans de nombreuses plantes toxiques de la famille des solanacées. Dans notre région, il s'agit de la belladone, du datura et de la jusquiame. Suppositoires, gouttes, comprimés et teintures sont fabriqués directement à partir de l'extrait de feuilles et de racines de ces plantes. Ces médicaments ne sont pas rares; beaucoup sont vendus sans ordonnance, considérés comme naturels et inoffensifs, et se trouvent dans presque toutes les pharmacies. En réalité, les médicaments contenant des alcaloïdes sont des agents puissants, nécessitant un respect strict de la posologie et une conservation prudente.
 [ 1 ]
[ 1 ]
Causes empoisonnement à l'atropine
L'intoxication par cette substance se produit accidentellement lorsque les médicaments qui la contiennent sont mal dosés, lorsque les fruits de plantes vénéneuses sont consommés ou intentionnellement lorsqu'elle est utilisée comme médicament.
Les principaux facteurs de risque d'intoxication sont, avant tout, la négligence ou le manque de connaissances de base. Ainsi, les jeunes enfants, livrés à eux-mêmes, peuvent goûter aux fruits d'une plante vénéneuse par curiosité et par désir de tout « à la dent ». Il suffit de peu pour les intoxiquer: 2 à 3 baies de belladone ou 15 à 20 graines de datura.
Les adultes qui n'ont pas bien étudié la notice du médicament, qui s'automédicamentent ou qui ignorent les avertissements du médecin concernant la posologie peuvent s'empoisonner ou, pire encore, nuire à leur enfant. On peut même s'empoisonner en prenant une surdose de gouttes ophtalmiques ou en inhalant les vapeurs d'un bouquet de fleurs sauvages contenant du datura, bien que l'ingestion d'une substance toxique soit bien sûr plus dangereuse.
La cause de l’empoisonnement peut être le désir d’obtenir un effet psychotrope.
La pathogénèse de l'intoxication repose sur la capacité de l'atropine à se lier principalement aux récepteurs cholinergiques muscariniques. De plus, bien que dans une moindre mesure, l'atropine peut également se lier aux récepteurs cholinergiques nicotiniques, les rendant ainsi insensibles au neurotransmetteur acétylcholine. Cela entraîne une augmentation de sa concentration dans la synapse, ralentissant ainsi la transmission de l'influx nerveux dans différentes parties du cerveau. Le dysfonctionnement du métabolisme de l'acétylcholine provoque un trouble de l'activité nerveuse supérieure et de l'innervation parasympathique (cholinergique).
Certaines doses d'atropine et de son précurseur (la dose quotidienne maximale prescrite pour les adultes ne dépasse pas 2 mg par voie orale, pour les enfants: 0,1 à 1 mg), agissant principalement sur le cortex cérébral, provoquent une réaction psychotique aiguë, accompagnée d'une excitation motrice. L'expression bien connue « avoir mangé trop de jusquiame » n'est pas sans fondement: une personne sous l'influence de cet hallucinogène devient inadaptée.
En l'absence d'aide, une surexcitation prolongée des systèmes cholinergiques entraîne leur épuisement, une suppression des réflexes (paralysie respiratoire, amnésie, perte de connaissance). Le coma et la mort sont possibles.
Les alcaloïdes atropiniques sont absorbés assez rapidement au contact des muqueuses oculaires et digestives. Cette vitesse dépend de la dose et du degré de satiété. Si les alcaloïdes atropiniques sont pris à jeun, les premiers symptômes d'intoxication apparaissent après quelques minutes, et le tableau clinique complet se développe en une heure ou deux. Les formes injectables agissent encore plus intensément. Les substances toxiques sont décomposées par le foie et excrétées dans l'urine et la sueur. L'organisme est excrété de la moitié de la dose prise en 24 heures, mais il faut encore survivre à ces 24 heures.
Les statistiques montrent que l'intoxication aux inhibiteurs des récepteurs muscariniques représente environ 12 à 15 % de toutes les intoxications chimiques. La plupart des victimes sont des enfants ayant consommé une plante toxique ou essayé des médicaments contenant de l'atropine conservés dans un endroit accessible.
Symptômes empoisonnement à l'atropine
Les premiers signes d'atropine dans l'organisme se manifestent extérieurement par une dilatation des pupilles, qui cessent de réagir aux variations de luminosité. Cela s'accompagne d'une augmentation de la pression intraoculaire, de l'apparition d'un voile devant les yeux et, après une heure ou deux, d'une paralysie de l'accommodation et d'une photophobie.
Parallèlement, une gêne apparaît au niveau des muqueuses de la bouche et du nasopharynx. On observe une sécheresse notable pouvant aller jusqu'à une sensation de brûlure, ainsi qu'une forte soif, associée à une diminution de la production de salive et des sécrétions bronchiques. Le patient a des difficultés à avaler, sa voix devient rauque ou disparaît complètement.
Ses bras et ses jambes commencent à trembler et des spasmes musculaires douloureux peuvent survenir.
La sécrétion des sucs gastriques et pancréatiques diminue. Des envies fréquentes et douloureuses d'aller à la selle (ténesme) peuvent apparaître.
L'intoxication aux alcaloïdes du groupe de l'atropine se manifeste par une rougeur et une sécheresse cutanées, ainsi que par une éruption cutanée de type scarlatine (plus fréquente chez l'enfant). Le pouls du patient s'accélère (il peut atteindre 160 à 190 battements/min). Chez les jeunes enfants, en raison du faible tonus du nerf vague, la tachycardie peut être absente.
Les intoxications graves s'accompagnent d'hyperthermie avec pyréthémie, causée par une sudation altérée. Le patient présente une logorrhée, une agitation motrice, des troubles de la coordination, des céphalées, une dyspnée, des hallucinations et un délire secondaire pouvant aller jusqu'à un état violent et une perte totale d'orientation. Des convulsions et des crises d'épilepsie peuvent survenir. Le patient présente un comportement inapproprié et des signes de psychose.
L'état d'excitation dure plusieurs heures. Il peut être remplacé par une dépression du système nerveux central. Dans ce cas, la mobilité est limitée et les muscles se relâchent. Le patient peut perdre connaissance. La dyspnée cède périodiquement la place à des mouvements respiratoires superficiels et rares, qui s'accélèrent et deviennent fréquents et profonds, puis ralentissent à nouveau (respiration de Cheyne-Stokes). Le visage devient pâle et bleuté. Le pouls du patient est rapide, faible et irrégulier. On observe une baisse de la tension artérielle.
L'intoxication aiguë à l'atropine peut être mortelle. Le patient décède par asphyxie due à une paralysie du centre respiratoire. Cependant, la plupart des cas d'intoxication aiguë se terminent par une guérison. Celle-ci prend de deux à quatre jours, la mydriase pouvant parfois durer jusqu'à deux semaines.
Les phases de l'intoxication à l'atropine: excitation et dépression, peuvent s'exprimer à des degrés divers selon la dose prise, le poids corporel, l'âge du patient et la réaction individuelle.
Une intoxication légère se manifeste par une mydriase, une cycloplégie, une sécheresse et une hyperémie des muqueuses et de la peau, une accélération du rythme cardiaque, un affaiblissement du péristaltisme intestinal, une rétention urinaire, de l'anxiété et des troubles de l'élocution, ainsi que des tremblements des membres. Progressivement, cet état évolue vers le sommeil.
En médecine, pour traiter certaines maladies accompagnées d'une faiblesse musculaire sévère, on utilise des médicaments qui renforcent l'action de l'acétylcholine en inhibant l'activité de l'enzyme qui catalyse sa dégradation, la cholinestérase. Ils ont un effet réversible et irréversible sur l'enzyme. Dans le premier cas, lorsque leur action cesse, l'activité enzymatique est restaurée, dans le second, elle ne l'est pas. En cas de surdosage, ces médicaments provoquent une intoxication.
Les engrais organophosphorés et les insecticides ont des effets anticholinestérasiques irréversibles lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme. Ces substances peuvent provoquer une intoxication grave, même en cas de contact cutané, car elles sont facilement absorbées.
L'intoxication par des anticholinestérasiques irréversibles se manifeste par des effets directement opposés à ceux de l'atropine: hypersalivation, hyperhidrose, constriction pupillaire, spasme de l'accommodation. Le péristaltisme gastro-intestinal augmente, entraînant des douleurs abdominales, des vomissements et des envies fréquentes de déféquer. Une contraction anormalement active des muscles bronchiques entraîne une respiration sifflante difficile et une dyspnée due aux spasmes. On observe également un ralentissement du pouls et des tremblements musculaires.
Les symptômes neurologiques sont cependant similaires à ceux d’une intoxication à l’atropine: l’agitation psychomotrice se transforme en dépression des réflexes.
Une intoxication grave entraîne des convulsions, une hypotension et un collapsus. La cause du décès est une paralysie respiratoire.
Les agents anticholinestérasiques et les bloqueurs des récepteurs cholinergiques muscariniques produisent des effets opposés: ils excitent ou inhibent l'innervation parasympathique et sont donc des antidotes aux intoxications aiguës correspondantes.
Une intoxication chronique à l'atropine survient en cas d'utilisation prolongée et de faibles surdoses. On observe: dilatation des pupilles, troubles de l'accommodation, sécheresse des muqueuses et de la peau, vertiges, légère accélération du pouls, tremblements des extrémités, retard de la vidange vésicale et constipation.
Complications et conséquences
La pire conséquence d'une intoxication à l'atropine est la mort par paralysie respiratoire. Cependant, il y a une consolation: cela arrive extrêmement rarement. La plupart du temps, la personne est soignée à temps et survit.
Cependant, une intoxication grave et un coma prolongé peuvent se compliquer de troubles graves de la mémoire et d'un retard mental, d'une polynévrite toxique ou d'une inflammation des méninges. La substance, pénétrée dans l'organisme à dose toxique, affecte la couche musculaire et les tissus de tous les organes et perturbe le fonctionnement des glandes. Les complications d'une intoxication peuvent inclure une pneumonie, une atélectasie pulmonaire, des pathologies digestives, un glaucome et un décollement de la rétine.
Diagnostics empoisonnement à l'atropine
L'intoxication à l'atropine est diagnostiquée sur la base des symptômes cliniques et des informations sur son utilisation. Aucun test ni outil diagnostique ne permet de confirmer ou d'infirmer une intoxication à l'atropine. Le seul test consiste à verser une goutte d'urine du patient dans l'œil d'un lapin ou d'un chat. La dilatation des pupilles confirme la présence d'atropine dans l'organisme.
Diagnostic différentiel
Un diagnostic différentiel est réalisé en cas d'intoxication par des substances pouvant provoquer un délire (acricine, alcool, acide borique, stupéfiants), ainsi qu'en cas de psychose schizophrénique. En cas d'éruption cutanée et de forte fièvre, il s'agit d'une maladie infectieuse.
Qui contacter?
Traitement empoisonnement à l'atropine
Les premiers secours en cas d'intoxication à l'atropine ou aux plantes toxiques (ingérées par voie orale) consistent en un lavage gastrique. On fait boire au patient 2 à 3 litres d'eau tiède additionnée de comprimés de charbon actif écrasés ou la même quantité d'une solution rose faible de permanganate de potassium. Une ambulance est immédiatement appelée. Le patient inconscient est couché sur le côté pour éviter la suffocation lorsque la langue s'enfonce.
Le patient est hospitalisé. Selon son état, des mesures de stabilisation sont prises. Un lavage gastrique peut être réalisé à l'aide d'une sonde dont l'extrémité doit être lubrifiée à la vaseline afin de ne pas endommager l'œsophage trop sec.
Si l'état du patient ne permet pas un lavage gastrique, une injection sous-cutanée d'apomorphine (émétique) est administrée pour éliminer rapidement la substance toxique restante. De plus, un lavement siphon avec une solution de tanin (0,5 %) est prescrit.
En cas de dysfonctionnement respiratoire, une ventilation artificielle ou une intubation trachéale peuvent être prescrites aux patients.
Pour éliminer le poison absorbé, une diurèse forcée avec alcalinisation du sang et hémosorption détoxifiante sont réalisées.
Il est nécessaire d'administrer au patient un antidote contre l'intoxication à l'atropine - à ce titre, des agents anticholinestérasiques réversibles sont utilisés pour éliminer le blocage des récepteurs cholinergiques, qui ont la capacité d'avoir un effet directement opposé: restaurer le tonus des muscles des bronches, du tractus gastro-intestinal, du système musculo-squelettique, le fonctionnement des glandes et réduire la pression intraoculaire.
Par exemple, la prozérine est administrée par voie sous-cutanée ou en perfusion en cas d'intoxication à l'atropine, diluée dans une solution saline. L'administration est répétée. On administre d'abord 3 ml d'une solution à 0,05 % du médicament, puis, si l'effet est insuffisant, on répète l'administration. On peut administrer jusqu'à 12 ml de solution de prozérine en 20 à 30 minutes. Le médicament restaure principalement l'innervation parasympathique, car il franchit difficilement la barrière hémato-encéphalique et son effet central est faible.
La physostigmine est utilisée en cas d'intoxication à l'atropine chez les patients présentant des convulsions, une fièvre et une insuffisance vasculaire aiguë. Elle est administrée par voie intraveineuse. Chez les jeunes enfants, la dose est d'environ 0,5 mg et chez les adolescents, de 1 mg. Les injections sont administrées toutes les 5 à 20 minutes jusqu'à disparition des effets anticholinergiques de l'atropine.
Les antidotes sont utilisés avec prudence, en veillant à obtenir un équilibre satisfaisant entre leurs effets. La dose est choisie de manière empirique, et les doses suivantes sont imprévisibles. Elles sont généralement inférieures à la dose initiale, car une partie du médicament est excrétée par l'organisme. L'utilisation de la physostigmine est déconseillée en cas de basses températures, d'hallucinations non dangereuses ou de délire.
D'autres médicaments sont prescrits à titre symptomatique. L'agitation psychomotrice est soulagée par des antipsychotiques, les convulsions par des barbituriques, l'hyperthermie par un refroidissement externe (packs de glace, compresses humides) et des antipyrétiques, et l'accélération du pouls est normalisée par des bêtabloquants. Le traitement vise à restaurer et à maintenir les fonctions vitales de l'organisme.
Après la sortie de l'hôpital, pendant la période de rééducation, une attention particulière doit être portée à la routine quotidienne et à l'alimentation du patient. L'alimentation doit être dominée par des aliments nutritifs riches en minéraux, protéines et vitamines. Les légumes verts, les fruits, la viande et le poisson maigres, ainsi que les produits laitiers fermentés, redonnent force et énergie et ont également un effet bénéfique sur le fonctionnement du système digestif.
Des promenades quotidiennes au grand air sont recommandées, dont la durée doit être progressivement augmentée; des exercices thérapeutiques seront utiles.
Une intoxication aiguë à l'atropine peut avoir des conséquences graves; il est donc déconseillé d'utiliser des remèdes populaires. Il est impératif d'appeler une ambulance et de ne pas refuser l'hospitalisation. Des traitements à base de plantes peuvent être pratiqués pendant la convalescence: tisanes vitaminées, infusions pour renforcer le système immunitaire.
L'homéopathie recommande également, en cas d'intoxication, d'éliminer d'abord le poison de l'organisme, c'est-à-dire de laver l'estomac, de provoquer des vomissements et de pratiquer un lavement. Il n'existe pas d'antidote spécifique en homéopathie; le traitement est symptomatique. Compte tenu du danger de cette intoxication, l'homéopathie ne peut être utilisée que dans ses formes les plus légères ou pendant la période de convalescence.
 [ 18 ]
[ 18 ]
La prévention
Lors d'un traitement par des médicaments contenant de l'atropine, il est nécessaire de suivre scrupuleusement les recommandations et la posologie du médecin. Si les premiers symptômes de surdosage apparaissent (muqueuses sèches, soif, léthargie, anxiété, somnolence), il est impératif d'en informer le médecin.
Gardez les médicaments contenant de l’atropine hors de portée des enfants.
Ne laissez pas les jeunes enfants sans surveillance. Étudiez vous-même l'apparence des plantes vénéneuses et parlez-en aux enfants plus âgés. En général, apprenez-leur à ne pas manger de baies inconnues, à ne pas cueillir de bouquets de plantes sauvages inconnues et expliquez-leur pourquoi il ne faut pas le faire.

