Expert médical de l'article
Nouvelles publications
Épilepsie généralisée et focale idiopathique
Dernière revue: 12.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.
Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.
Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.
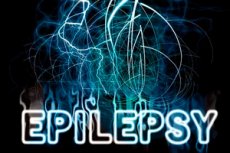
Maladie convulsive, épilepsie, sacrée, lunaire: les noms sont multiples pour cette maladie qui se manifeste par des crises périodiques effrayantes et inattendues, au cours desquelles les patients s'effondrent soudainement au sol, pris de convulsions. Nous parlerons ici de l'épilepsie, que la médecine moderne considère comme une maladie neurologique chronique et progressive, dont le symptôme spécifique est la survenue de crises non provoquées et récurrentes, convulsives ou non. Cette maladie peut entraîner des changements de personnalité spécifiques, conduisant à la démence et à un détachement complet de la vie. Déjà le médecin romain Claude Galien distinguait deux types de maladie: l'épilepsie idiopathique, c'est-à-dire héréditaire, primaire, dont les symptômes apparaissent dès le plus jeune âge, et l'épilepsie secondaire (symptomatique), qui se développe plus tard, sous l'influence de certains facteurs. [ 1 ]
Dans la classification actualisée de la Ligue internationale contre l'épilepsie, l'une des six catégories étiologiques identifiées de la maladie est génétique – une maladie primaire indépendante impliquant une prédisposition héréditaire ou des mutations génétiques apparues de novo. Il s'agit essentiellement d'épilepsie idiopathique dans l'édition précédente. Dans ce cas, le patient ne présente aucune lésion organique des structures cérébrales susceptible de provoquer des crises épileptiques récurrentes, et aucun symptôme neurologique n'est observé en période intercritique. Parmi les formes connues d'épilepsie, l'épilepsie idiopathique présente le pronostic le plus favorable. [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ]
Épidémiologie
On estime que 50 millions de personnes dans le monde souffrent d'épilepsie, dont la plupart n'ont pas accès aux soins de santé. [ 5 ], [ 6 ] Une revue systématique et une méta-analyse d'études menées à l'échelle mondiale ont révélé que la prévalence ponctuelle de l'épilepsie active était de 6,38 pour 1 000 personnes et que la prévalence à vie était de 7,6 pour 1 000 personnes. La prévalence de l'épilepsie ne différait pas selon le sexe ou l'âge. Les types les plus courants sont les crises généralisées et l'épilepsie d'étiologie inconnue. [ 7 ], [ 8 ]
En moyenne, 0,4 à 1 % de la population mondiale nécessite un traitement antiépileptique. Les statistiques sur l'incidence de l'épilepsie dans les pays développés font état chaque année de 30 à 50 nouveaux cas de syndromes épileptiques pour 100 000 habitants. On estime que dans les pays à faible niveau de développement, ce chiffre est deux fois plus élevé. Parmi toutes les formes d'épilepsie, les cas d'épilepsie idiopathique représentent 25 à 29 %. [ 9 ]
Causes épilepsie idiopathique
La maladie se manifeste dans la grande majorité des cas chez les enfants et les adolescents. Les patients n'ont aucun antécédent de maladie ou de blessure ayant entraîné des lésions cérébrales. Les méthodes modernes de neuroimagerie ne permettent pas de détecter la présence de modifications morphologiques des structures cérébrales. L'épilepsie idiopathique est considérée comme une prédisposition génétique au développement de la maladie (épileptogénicité cérébrale), et non une hérédité directe; les cas de la maladie sont simplement plus fréquents parmi les proches du patient que dans la population générale. [ 10 ]
Les cas d'épilepsie idiopathique familiale sont rares. Une transmission autosomique dominante monogénique est actuellement observée pour cinq épisyndromes. Des gènes ont été identifiés, dont la mutation est à l'origine de crises néonatales et infantiles familiales bénignes, d'épilepsie généralisée avec convulsions fébriles, d'épilepsie focale-frontale avec convulsions nocturnes et de troubles auditifs. Dans d'autres épisyndromes, une tendance au développement d'un processus pathologique est vraisemblablement héréditaire. Par exemple, la synchronisation de l'activité des neurones dans toutes les gammes de fréquences est dite épileptique, c'est-à-dire présentant une différence de potentiel instable sur les faces interne et externe de sa membrane à l'état non excité. En état d'excitation, le potentiel d'action d'un neurone épileptique dépasse significativement la normale, ce qui conduit au développement d'une crise épileptique, dont la répétition provoque une atteinte progressive des membranes cellulaires des neurones et la formation d'échanges ioniques pathologiques à travers les membranes neuronales détruites. Il en résulte un cercle vicieux: les crises d’épilepsie résultant de décharges nerveuses hyperintensives répétées entraînent de profondes perturbations métaboliques dans les cellules du tissu cérébral, qui contribuent au développement de la crise suivante. [ 11 ]
Une caractéristique spécifique de toute épilepsie est l'agressivité des neurones épileptiques par rapport aux cellules encore inchangées du tissu cérébral, ce qui contribue à la propagation diffuse de l'épileptogénicité et à la généralisation du processus.
Dans l'épilepsie idiopathique, la plupart des patients présentent une activité épileptique généralisée, sans foyer épileptique spécifique. Plusieurs types d'épilepsies focales idiopathiques sont actuellement connus. [ 12 ]
Français Des études sur l'épilepsie myoclonique juvénile (CAE) ont identifié les chromosomes 20q, 8q24.3 et 1p (CAE a été plus tard rebaptisée épilepsie-absence juvénile). Des études sur l'épilepsie myoclonique juvénile ont montré que les polymorphismes de susceptibilité BRD2 sur le chromosome 6p21.3 et Cx-36 sur le chromosome 15q14 sont associés à une susceptibilité accrue à l'EMJ.[ 13 ],[ 14 ],[ 15 ] Malgré cela, la mutation génétique reste rare lorsqu'une personne reçoit un diagnostic d'épilepsie.
Facteurs de risque
Les facteurs de risque de développement de la maladie sont hypothétiques. Le principal est la présence de proches parents ayant souffert d'épilepsie. Dans ce cas, la probabilité de tomber malade immédiatement est multipliée par deux, voire par quatre. La pathogénèse de l'épilepsie idiopathique reste encore à élucider. [ 16 ]
On suppose également que le patient pourrait hériter d'une faiblesse des structures qui protègent le cerveau de la surexcitation. Il s'agit des segments du pont, du noyau cunéiforme ou du noyau caudé. De plus, le développement de la maladie chez une personne présentant une prédisposition héréditaire peut être provoqué par une pathologie métabolique systémique entraînant une augmentation de la concentration d'ions sodium ou d'acétylcholine dans les neurones cérébraux. Des crises d'épilepsie généralisées peuvent se développer dans le contexte d'une carence en vitamines B, notamment en vitamine B6. Les épileptiques ont une tendance à la neurogliose (selon les études pathologiques): prolifération excessive et diffuse d'éléments gliaux remplaçant les neurones morts. D'autres facteurs provoquant une excitabilité accrue et l'apparition de crises convulsives dans ce contexte sont régulièrement identifiés.
Le facteur de risque de développement de l'épilepsie génétique, comme on l'appellera désormais, est la présence de gènes mutants provoquant la pathologie. De plus, la mutation génétique n'est pas nécessairement héréditaire; elle peut apparaître pour la première fois chez un patient spécifique, et on estime que le nombre de cas de ce type est en augmentation.
Pathogénèse
Le mécanisme de développement de l'épilepsie idiopathique repose sur une réactivité paroxystique génétiquement déterminée, c'est-à-dire la présence d'une communauté de neurones présentant une électrogénèse altérée. Aucun effet dommageable externe n'a été détecté, ni aucun événement déclencheur des crises. Cependant, la maladie se manifeste à différents âges: dès la naissance chez certains, dès la petite enfance chez d'autres, et à l'adolescence et au début de la jeunesse chez d'autres. Par conséquent, certains aspects de la pathogénèse restent apparemment encore inconnus à ce stade.
Symptômes épilepsie idiopathique
Le principal signe diagnostique de la maladie est la présence de crises d'épilepsie, convulsives ou non. Sans elles, les autres symptômes, tels qu'un électroencéphalogramme caractéristique, l'anamnèse et les caractéristiques cognitives et psychologiques du patient, ne suffisent pas à établir le diagnostic d'épilepsie. La manifestation de la maladie est généralement associée à la première crise, ce qui constitue la définition la plus précise de l'épilepsie. Une crise est un terme plus général, désignant une détérioration brutale et inattendue de l'état de santé, quelle qu'en soit l'origine. Une crise d'épilepsie est un cas particulier de crise, causée par un dysfonctionnement transitoire du cerveau ou d'une partie de celui-ci.
Les épileptiques peuvent présenter divers troubles de l'activité neuropsychiatrique - crises majeures et mineures, troubles mentaux aigus et chroniques (dépression, dépersonnalisation, hallucinations, délires), transformations persistantes de la personnalité (inhibition, détachement).
Cependant, je le répète, les premiers signes permettant de diagnostiquer l'épilepsie sont les crises. La crise la plus impressionnante de l'épilepsie idiopathique, impossible à ignorer, est sa manifestation généralisée: une crise de grand mal. Je précise d'emblée que tous les éléments du complexe symptomatique décrit ci-dessous ne sont pas obligatoires, même pour la forme généralisée. Un patient donné peut ne présenter que certaines de ces manifestations.
De plus, généralement à la veille d'une crise, ses signes précurseurs apparaissent. Le patient commence à se sentir plus mal: son rythme cardiaque s'accélère, il a mal à la tête, une anxiété non motivée apparaît, il peut devenir colérique et irritable, agité ou déprimé, sombre et silencieux. À la veille d'une crise, certains patients passent la nuit sans dormir. Généralement, avec le temps, le patient peut déjà deviner l'approche d'une crise en fonction de son état.
La formation d'une crise d'épilepsie est divisée en plusieurs étapes: aura, crises tonico-cloniques et trouble de la conscience.
L'aura fait déjà référence au début d'une crise et peut se manifester par l'apparition de diverses sensations: picotements, douleurs, contacts chauds ou froids, légère brise dans différentes parties du corps (sensorielles); éclairs, éblouissements, éclairs, flammes devant les yeux (hallucinatoires); sueurs, frissons, bouffées de chaleur, vertiges, sécheresse buccale, migraine, toux, essoufflement, etc. (végétatives). L'aura peut se manifester par des automatismes moteurs (moteurs): le patient se met à courir quelque part, à tourner sur lui-même, à agiter les bras, à crier. Parfois, des mouvements unilatéraux sont effectués (avec la main gauche, la jambe, la moitié du corps). L'aura mentale peut se manifester par des crises d'angoisse, de déréalisation, plus complexes que dans les hallucinations auditives, sensorielles ou visuelles. L'aura peut être absente.
Puis survient immédiatement la deuxième phase: la crise elle-même. Le patient perd connaissance, ses muscles se relâchent complètement (atonie), et il tombe. La chute survient de manière inattendue pour son entourage (l'aura passe souvent inaperçue). Le plus souvent, la personne tombe en avant, plus rarement en arrière ou sur le côté. Après la chute, la phase de tension tonique commence: les muscles de tout ou partie du corps se tendent, se raidissent, le patient s'étire, sa tension artérielle augmente, son rythme cardiaque s'accélère, ses lèvres bleuissent. La phase de tonus musculaire dure environ une demi-minute, puis des contractions rythmiques continues commencent. La phase tonique est remplacée par la phase clonique: mouvements chaotiques intermittents et croissants des membres (flexions-extensions de plus en plus brusques), de la tête, des muscles du visage, parfois des yeux (rotation, nystagmus). Les spasmes de la mâchoire conduisent souvent à se mordre la langue pendant une crise, une manifestation classique de l'épilepsie, connue de presque tout le monde. L'hypersalivation se manifeste par une écume à la bouche, souvent tachée de sang lorsqu'on se mord la langue. Des spasmes cloniques des muscles du larynx entraînent des phénomènes sonores pendant la crise: meuglements, gémissements. Pendant la crise, les muscles sphincters de la vessie et de l'anus se relâchent souvent, ce qui entraîne des mictions et des selles involontaires. Les spasmes cloniques durent une à deux minutes. Pendant la crise, le patient n'a aucun réflexe cutanéo-tendineux. La phase tonico-clonique de la crise se termine par un relâchement musculaire progressif et une diminution de l'activité épileptique. Au début, le patient est dans un état de conscience trouble: désorientation, difficultés de communication (parle difficilement, oublie des mots). Il présente encore des tremblements, des contractions musculaires, mais progressivement, tout revient à la normale. Après la crise, le patient se sent complètement épuisé et s'endort généralement pendant plusieurs heures; au réveil, des symptômes asthéniques persistent: faiblesse, malaise, mauvaise humeur, troubles de la vision.
L'épilepsie idiopathique peut également se manifester par des crises mineures. Celles-ci incluent des absences, simples ou typiques. Les absences atypiques complexes ne sont pas caractéristiques de l'épilepsie idiopathique. Les crises typiques sont des crises généralisées de courte durée, au cours desquelles le patient se fige, le regard fixe. La durée d'une absence ne dépasse généralement pas une minute, période pendant laquelle le patient perd conscience; il ne tombe pas, mais laisse tomber tout ce qu'il tient dans ses mains. Il ne se souvient pas de la crise et poursuit souvent l'activité interrompue. Les absences simples surviennent sans aura et sans trouble de la conscience après la crise, généralement accompagnées de spasmes des muscles faciaux, touchant principalement les paupières et la bouche, et/ou d'automatismes oraux: claquements, mastication, léchage des lèvres. Parfois, il existe des absences non convulsives si brèves que le patient ne les remarque même pas. Il se plaint d'une vision soudainement obscurcie. Dans ce cas, l'objet qui lui est tombé des mains peut être le seul signe d'une crise d'épilepsie.
Les crises propulsives (hochements de tête, coups de bec, « salam » et autres mouvements de la tête ou du corps entier dirigés vers l'avant) sont causées par un affaiblissement du tonus postural des muscles. Les patients ne chutent pas. Elles surviennent principalement chez les enfants de moins de quatre ans, plus souvent chez les garçons. Elles sont caractéristiques des crises nocturnes. À un âge plus avancé, elles sont remplacées par des crises d'épilepsie majeures.
La myoclonie est une contraction musculaire réflexe et rapide qui se manifeste par des secousses. Les convulsions peuvent être observées dans tout le corps ou n'affecter qu'un groupe musculaire spécifique. Un électroencéphalogramme réalisé lors d'une crise myoclonique révèle la présence de décharges épileptiques.
Tonique – contractions prolongées de n’importe quel groupe de muscles ou de toute la musculature du corps, au cours desquelles une certaine position est maintenue pendant une longue période.
Atonique – perte partielle ou totale du tonus musculaire. Une atonie généralisée avec chute et perte de connaissance est parfois le seul symptôme d'une crise d'épilepsie.
Les crises sont souvent de nature mixte: les absences sont combinées à des crises tonico-cloniques généralisées, myocloniques à atoniques, etc. Des formes de crises non convulsives peuvent survenir: conscience crépusculaire avec hallucinations et délire, divers automatismes et transes.
Formes
La grande majorité des cas d'épilepsie idiopathique se manifestent durant l'enfance et l'adolescence. Ce groupe comprend des syndromes épileptiques généralement relativement bénins, c'est-à-dire qu'ils répondent bien au traitement, voire n'en nécessitent pas, et évoluent sans conséquence sur l'état neurologique, normal en dehors des crises. De plus, leur développement intellectuel n'est pas en retard par rapport à celui de leurs pairs en bonne santé. Leur rythme de base est préservé à l'électroencéphalogramme, et les méthodes modernes de neuroimagerie ne détectent pas d'anomalies structurelles cérébrales, ce qui ne signifie pas pour autant leur absence. Parfois, elles sont détectées plus tard, sans qu'on sache encore si elles ont été « méconnues » ou si elles ont provoqué les crises.
L'épilepsie idiopathique débute avec l'âge et, en général, son pronostic est favorable. Cependant, il arrive qu'une forme de la maladie évolue vers une autre, par exemple une épilepsie-absence infantile en myoclonie juvénile. La probabilité d'une telle évolution et de crises à un âge plus avancé augmente chez les enfants dont des proches ont également souffert de cette maladie, tant durant l'enfance qu'à l'âge adulte.
Les types d'épilepsie idiopathique ne sont pas clairement définis, il existe des divergences dans les classificateurs, certaines formes n'ont pas de critères diagnostiques stricts, comme l'épilepsie-absence de l'enfance.
Épilepsie généralisée idiopathique
La forme la plus précoce de la maladie – les crises néonatales/infantiles bénignes familiales et non familiales – est détectée chez les nouveau-nés à terme dès le deuxième ou le troisième jour suivant la naissance. De plus, les enfants naissent principalement de femmes ayant porté et donné naissance à leur enfant sans complications majeures. L'âge moyen de développement des formes familiales est de 6,5 mois, celui des formes non familiales de 9 mois. Actuellement, des gènes (bras long des chromosomes 8 et 20) ont été identifiés, dont la mutation est associée au développement de la forme familiale de la maladie. Les autres facteurs déclenchants, hormis l'existence de cas de crises dans les antécédents familiaux, sont absents. Chez un nourrisson atteint de cette forme de la maladie, on observe des crises très fréquentes (jusqu'à 30 par jour), brèves, d'une à deux minutes, généralisées, focales ou associées à des crises tonico-cloniques focales, accompagnées d'épisodes d'apnée. [ 17 ]
L'épilepsie myoclonique idiopathique de l'enfant se manifeste chez la plupart des patients entre quatre mois et trois ans. Elle se caractérise uniquement par une myoclonie avec préservation de la conscience, se manifestant par une série de propulsions: mouvements rapides de la tête avec abduction des globes oculaires. Dans certains cas, les convulsions se propagent aux muscles de la ceinture scapulaire. Si une crise propulsive débute pendant la marche, elle entraîne une chute fulgurante. Le début d'une crise peut être provoqué par un bruit aigu, un contact inattendu et désagréable, une interruption du sommeil ou un réveil, et, dans de rares cas, par une photostimulation rythmique (regarder la télévision, allumer/éteindre la lumière).
L'épilepsie infantile avec crises myocloniques-atoniques est une autre forme de maladie idiopathique généralisée (génétique). Elle se manifeste entre dix mois et cinq ans. La plupart des patients développent immédiatement des crises généralisées d'une durée de 30 à 120 secondes. Un symptôme spécifique est le « coup de genou », conséquence de myoclonies des membres, mouvements propulsifs de hochement de tête. La conscience est généralement préservée pendant la crise. Les myoclonies à composante atonique s'accompagnent souvent d'absences typiques, durant lesquelles la conscience est perdue. Ces absences sont observées le matin au réveil, sont fréquentes et parfois complétées par une composante myoclonique. De plus, environ un tiers des enfants atteints d'épilepsie myoclonique-atonique généralisée développent également des crises motrices partielles. Dans ce cas, le pronostic s'aggrave, surtout lorsqu'elles sont très fréquentes. Cela pourrait être un signe de développement d'un syndrome de Lennox-Gastaut.
L'épilepsie idiopathique généralisée chez l'enfant comprend également des formes d'absence de la maladie.
L'épilepsie-absence du nourrisson se manifeste au cours des quatre premières années de vie et est plus fréquente chez les garçons. Elle se manifeste principalement par des absences simples. Dans environ 2 cas sur 5, les absences sont associées à des composantes myocloniques et/ou astatiques. Dans 2 cas sur 3, la maladie débute par des crises tonico-cloniques généralisées. Les enfants peuvent présenter un retard de développement.
La pycnolepsie (épilepsie-absences infantile) apparaît le plus souvent chez les enfants de cinq à sept ans, les filles étant plus sensibles. Elle se caractérise par une perte de connaissance soudaine ou une confusion importante pendant deux à trente secondes, ainsi que par une fréquence très élevée des crises (une centaine par jour). Les manifestations motrices des crises sont minimes, voire absentes. Cependant, si les absences typiques sont précédées d'une aura et qu'un trouble de la conscience est observé après la crise, ces crises sont qualifiées de pseudo-absences.
La pycnolepsie peut provoquer des absences atypiques présentant diverses composantes: myoclonies, convulsions toniques, états atoniques, parfois automatismes. Différents événements peuvent stimuler une augmentation de la fréquence des crises: réveil brutal, respiration intense, changement brutal de luminosité. Chez un tiers des patients, des crises convulsives généralisées peuvent survenir au cours de la deuxième ou de la troisième année de la maladie.
L'épilepsie-absence juvénile se développe à l'adolescence et au jeune âge (de 9 à 21 ans). Elle débute par des absences dans environ la moitié des cas et peut débuter par des crises convulsives généralisées, qui surviennent souvent au moment de l'interruption du sommeil, du réveil ou du coucher. La fréquence des crises est d'une crise tous les deux ou trois jours. Le facteur favorisant l'apparition de l'épilepsie-absence est l'hyperventilation. Les états d'absence s'accompagnent de contractions des muscles faciaux ou d'automatismes pharyngés et oraux. Chez 15 % des patients, des proches souffraient également d'épilepsie-absence juvénile.
L'épilepsie avec absences myocloniques (syndrome de Tassinari) est une forme distincte. Elle se manifeste entre un et sept ans et se caractérise par des absences fréquentes, notamment matinales, associées à des contractions musculaires massives de la ceinture scapulaire et des membres supérieurs (myoclonies). La photosensibilité n'est pas typique de cette forme; l'hyperventilation est à l'origine de la crise. Chez la moitié des enfants malades, des troubles neurologiques sont observés sur fond d'hyperactivité et de diminution de l'intelligence.
L'épilepsie généralisée idiopathique de l'adulte représente environ 10 % de tous les cas d'épilepsie à l'âge adulte. Les experts estiment que de tels diagnostics chez les patients de plus de 20, voire 30 ans, résultent d'un diagnostic tardif, dû au fait que les patients et leurs proches ont ignoré les absences et les crises myocloniques survenues dans l'enfance, dont la récidive s'est produite sur une longue période (plus de 5 ans). On suppose également qu'une manifestation anormalement tardive de la maladie peut survenir très rarement.
En outre, les causes des manifestations tardives de la maladie sont citées comme un diagnostic erroné et le traitement inadéquat associé, la résistance au traitement adéquat des crises, les rechutes de l'épilepsie idiopathique après l'arrêt du traitement.
Épilepsie focale idiopathique
Dans ce cas, le principal symptôme, et souvent le seul, est la survenue de crises d'épilepsie partielles (localisées, focales). Dans certaines formes de cette maladie, des gènes associés à chacune d'elles ont été cartographiés. Il s'agit de l'épilepsie occipitale idiopathique, de l'épilepsie partielle avec crises affectives, de l' épilepsie temporale familiale et de l'épilepsie essentielle de la lecture.
Dans d'autres cas, on sait seulement que l'épilepsie idiopathique localisée résulte de mutations génétiques, mais les gènes responsables exacts n'ont pas été identifiés. Il s'agit de l'épilepsie frontale nocturne autosomique dominante et de l'épilepsie focale avec symptômes auditifs.
La maladie localisée la plus fréquente est l'épilepsie rolandique (15 % des cas d'épilepsie se manifestent avant l'âge de 15 ans). La maladie se manifeste chez les enfants de 3 à 14 ans, son pic étant observé entre 5 et 8 ans. Un signe diagnostique caractéristique est la présence de « pics rolandiques », complexes observés sur l'électroencéphalogramme en période intra-critique (intercritique). On les appelle également paroxysmes épileptiques bénins de l'enfant. Dans cette forme d'épilepsie, les foyers épileptiques se situent dans la région péri-rolandique du cerveau et ses parties inférieures. L'épilepsie rolandique se développe généralement chez des enfants présentant un état neurologique normal (idiopathique), mais des cas symptomatiques sont également possibles lorsque des lésions organiques du système nerveux central sont détectées.
Chez la grande majorité des patients (jusqu'à 80 %), la maladie se manifeste principalement par de rares crises focales simples (deux ou trois fois par mois) qui débutent pendant le sommeil. Au réveil ou lors d'une crise diurne, les patients constatent une aura somatosensorielle (paresthésies unilatérales touchant la cavité buccale (langue, gencives) ou le pharynx). Une crise focale se développe ensuite. Des contractions convulsives des muscles faciaux surviennent dans 37 % des cas, celles des muscles de la bouche et du pharynx dans 53 %, accompagnées d'une hypersalivation sévère. Pendant leur sommeil, les patients émettent des sons rauques et grondants. Chez un cinquième des patients, les muscles de l'épaule et du bras sont impliqués dans les contractions musculaires (crises brachiofasciales) et, deux fois plus rarement, elles peuvent se propager au membre inférieur (unilatérales). Avec le temps, la localisation des contractions musculaires peut changer et se déplacer vers l'autre côté du corps. Parfois, dans environ un quart des cas, et plus souvent chez les jeunes enfants, des crises généralisées secondaires se développent pendant le sommeil. Jusqu'à l'âge de 15 ans, 97 % des patients bénéficient d'une rémission thérapeutique complète.
L'épilepsie occipitale idiopathique à début tardif (type Gastaut) est beaucoup moins fréquente. Il s'agit d'une maladie distincte, qui se manifeste entre trois et quinze ans, avec un pic à huit ans. Les crises non convulsives sont fréquentes et se manifestent par des hallucinations visuelles élémentaires qui se développent rapidement et durent de quelques secondes à trois minutes, le plus souvent pendant la journée ou après le réveil. En moyenne, la fréquence des crises est d'une fois par semaine. Dans l'immense majorité des cas, le patient n'établit pas de contact à l'état paroxystique. Les crises peuvent progresser et s'accompagner de symptômes tels que clignements des yeux, illusions de douleur, cécité. Les vomissements sont rares. Ils peuvent s'accompagner de céphalées. Certains développent des hallucinations visuelles complexes, d'autres symptômes et une crise généralisée secondaire. À l'âge de 15 ans, 82 % des patients diagnostiqués avec un syndrome de Gastaut obtiennent une rémission thérapeutique.
Le syndrome de Panayiotopoulos est également une variante de la forme précédente. Il est dix fois plus fréquent que le syndrome de Gastaut classique. L'épilepsie occipitale idiopathique de ce type peut débuter précocement. Le pic de manifestation se situe entre 3 et 6 ans, mais le syndrome peut se développer chez un enfant d'un an et un enfant de huit ans. De plus, le risque de crises répétées est plus élevé avec un début précoce. On suppose que certains cas ne sont pas diagnostiqués, car les crises ont principalement des manifestations végétatives, le symptôme dominant étant une crise de vomissements. L'enfant n'est pas altéré par la conscience, il se plaint d'une mauvaise santé et de nausées sévères, qui disparaissent avec des vomissements importants et d'autres manifestations pouvant aller jusqu'à une confusion et des convulsions. Une autre forme de crises du syndrome de Panayiotopoulos est la syncope ou l'évanouissement. L'évanouissement survient avec des composantes toniques ou myocloniques, parfois avec une incontinence urinaire et fécale, et se termine par un état d'asthénie et de sommeil. Les crises sont longues, d'une demi-heure à sept heures, et débutent généralement la nuit. Leur fréquence est faible. Parfois, une seule crise survient pendant toute la durée de la maladie. Chez 92 % des patients, la rémission du syndrome de Panayopoulos est observée pendant une période allant jusqu'à neuf ans.
On suppose que l'épilepsie infantile bénigne avec crises affectives (syndrome de Dall-Bernardine) est également une variante de l'épilepsie occipitale ou rolandique. Le début est observé entre deux et neuf ans. Les crises se manifestent par des accès de terreur, des pleurs, des cris, accompagnés de pâleur, d'une hypersudation, d'une salivation excessive, de douleurs abdominales, d'automatismes et de confusion. Les crises se développent souvent pendant le sommeil, immédiatement après l'endormissement, mais peuvent également survenir pendant la journée. Elles surviennent spontanément, lors d'une conversation ou d'une activité sans stimulation visible. Dans la plupart des cas, la rémission survient avant l'âge de 18 ans.
Les formes d'épilepsie partielle idiopathique décrites ci-dessus ne se manifestent que pendant l'enfance. Les autres peuvent survenir à tout moment.
L'épilepsie idiopathique localisée photosensible se caractérise par des manifestations occipitales. Les crises sont identiques aux crises spontanées, peuvent être complétées par des symptômes végétatifs et parfois évoluer vers des crises tonico-cloniques généralisées secondaires. Leur apparition est déclenchée par des flashs lumineux fréquents, notamment lors de jeux vidéo ou devant la télévision. Elles se manifestent entre 15 mois et 19 ans.
L'épilepsie partielle idiopathique avec symptômes auditifs (temporaux latéraux, familiaux) débute par l'apparition d'une aura accompagnée de phénomènes sonores. Le patient entend des coups, des bruissements, des sifflements, des sonneries, d'autres sons intrusifs, ainsi que des hallucinations auditives complexes (musique, chant), susceptibles de provoquer une crise secondairement généralisée. Elle se manifeste entre 3 et 51 ans. Cette forme se caractérise par des crises peu fréquentes et un pronostic favorable.
L'épilepsie partielle idiopathique avec crises pseudo-généralisées, qui se caractérisent par des absences atypiques, des crises atoniques et des myoclonies palpébrales associées à des crises motrices partielles, peut ressembler à une encéphalopathie épileptique à l'électroencéphalogramme. Cependant, chez l'enfant, il n'y a pas de déficit neurologique et les méthodes de neuroimagerie ne révèlent pas de défauts structurels.
Il existe également une épilepsie frontale familiale autosomique dominante, d'origine génétique, avec paroxysmes nocturnes. L'intervalle de survenue est très large: les crises peuvent se développer entre deux et 56 ans. Sa prévalence exacte est inconnue, mais le nombre de familles concernées est en augmentation dans le monde entier. Des crises hypermotrices surviennent presque chaque nuit. Leur durée varie d'une demi-heure à 50 minutes. Des convulsions cloniques surviennent souvent; les patients, reprenant connaissance, se retrouvent allongés au sol ou dans une position ou un endroit inhabituel. Au moment de la crise, le réveil est brutal, la conscience est préservée; après la crise, le patient se rendort. Le début d'une crise est toujours associé au sommeil, avant, pendant ou après. Les crises durent généralement toute la vie et deviennent moins fréquentes avec l'âge.
L'épilepsie de lecture (graphogène, induite par la parole) est une forme rare d'épilepsie idiopathique. Elle apparaît à la fin de l'adolescence (12-19 ans) et est beaucoup plus fréquente chez les adolescents. La crise débute peu après le début de la lecture, de l'écriture ou de la parole; le stimulus déclencheur est la parole, non seulement écrite, mais aussi orale. Une myoclonie courte se produit, impliquant les muscles de la bouche et du larynx. Si le patient continue de lire, la crise évolue souvent vers des crises tonico-cloniques généralisées. Dans de rares cas, des hallucinations visuelles peuvent s'y ajouter. Des crises longues avec troubles de la parole peuvent survenir. Si le comportement du patient est correctement structuré, les crises graves ne se développent pas. Forme au pronostic favorable.
Complications et conséquences
L'épilepsie idiopathique liée à l'âge est généralement traitable et, parfois, ne nécessite aucun traitement et disparaît sans séquelles. Cependant, il ne faut pas ignorer ses symptômes et espérer que la maladie s'arrête d'elle-même. L'activité épileptiforme, notamment durant l'enfance et l'adolescence, période de maturation cérébrale et de développement de la personnalité, est l'une des causes de certains déficits neurologiques, entraînant une détérioration des capacités cognitives et compliquant l'adaptation sociale ultérieure. De plus, chez certains patients, les crises se transforment et sont observées dès l'âge adulte, réduisant significativement leur qualité de vie. Ces cas sont associés à la fois à une prédisposition héréditaire et à l'arrêt prématuré ou à l'absence de traitement.
De plus, les encéphalopathies épileptiques peuvent également se manifester dès l'enfance, leurs symptômes ressemblant souvent à ceux des formes idiopathiques bénignes au stade initial. Il est donc urgent de procéder à un examen approfondi du patient et de mettre en place un traitement adapté.
Diagnostics épilepsie idiopathique
Le critère diagnostique de cette maladie est la présence de crises d'épilepsie. Dans ce cas, le patient doit bénéficier d'un examen complet. Outre un recueil approfondi des antécédents médicaux du patient et de sa famille, des analyses de laboratoire et des examens complémentaires sont effectués. Il est actuellement impossible d'établir un diagnostic d'épilepsie par des méthodes de laboratoire, mais des examens cliniques sont indispensables pour évaluer l'état de santé général du patient.
De plus, pour déterminer l'origine des crises, des diagnostics instrumentaux sont prescrits. La principale méthode matérielle est l'électroencéphalographie en période intercritique et, si possible, pendant les crises. Le décodage de l'électroencéphalogramme est réalisé selon les critères de l'ILAE (Ligue internationale contre les épileptiques).
La surveillance vidéo est également utilisée, permettant d'observer des crises courtes, dont le début est très difficile à prévoir ou à stimuler.
L'épilepsie idiopathique est diagnostiquée en l'absence de lésions organiques des structures cérébrales. Des méthodes modernes de neuroimagerie sont alors utilisées: imagerie par ordinateur et par résonance magnétique. L'électrocardiographie et l'échocardiographie sont prescrites pour évaluer la fonction cardiaque, souvent en dynamique et en charge. La tension artérielle est surveillée régulièrement. [ 18 ]
Le patient se voit également prescrire un examen neuropsychologique, otoneurologique et neuro-ophtalmologique; d'autres examens peuvent être prescrits selon les indications.
Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel de l'épilepsie idiopathique est assez complexe. Premièrement, dans ce cas, les transformations structurelles du cerveau ne sont pas détectées; deuxièmement, l'âge de la manifestation ne permet souvent pas d'interroger le patient; troisièmement, les crises d'épilepsie sont souvent masquées par des évanouissements, des crises psychogènes, des troubles du sommeil et d'autres symptômes causés par des maladies neurologiques et somatiques.
Les crises d'épilepsie se distinguent de plusieurs affections: crises végétatives et psychogènes, myodystonie, myoplégie paroxystique, syncope, crises épileptiformes lors d'accidents vasculaires cérébraux aigus, troubles du sommeil, etc. Il convient d'être attentif à la présence d'un facteur déclenchant une crise, comme la station debout, une alimentation excessive, un bain chaud, une congestion nasale; à une composante émotionnelle prononcée; à un tableau clinique et une durée atypiques; à l'absence de certains symptômes, par exemple une altération de la conscience et du sommeil après la crise, à l'absence de proches épileptiques et à d'autres anomalies. Compte tenu de la gravité de la maladie et de la toxicité des anticonvulsivants, non seulement le pronostic de guérison, mais aussi la survie du patient dépendent souvent d'un diagnostic correct. [ 19 ]
Qui contacter?
Traitement épilepsie idiopathique
Fondamentalement, diverses formes d'épilepsie idiopathique nécessitent un traitement médicamenteux au long cours pour obtenir une rémission durable et l'absence de rechutes, notamment en cas d'absences juvéniles et d'épilepsie myoclonique. Dans certains cas, un traitement médicamenteux à vie est nécessaire. Bien que, par exemple, les crises néonatales familiales bénignes soient dans la plupart des cas spontanément résolutives, le traitement anticonvulsivant n'est pas toujours considéré comme justifié. Néanmoins, un traitement médicamenteux est parfois prescrit en cures courtes. Dans tous les cas, la pertinence, le choix du médicament et la durée du traitement doivent être décidés individuellement par le médecin après un examen approfondi du patient.
Dans l'épilepsie généralisée idiopathique (diverses formes, dont les spasmes infantiles) et les crises focales, les valproates se sont avérés les plus efficaces. En monothérapie, l'effet thérapeutique est obtenu dans 75 % des cas. Il peut être utilisé en association avec d'autres anticonvulsivants. [ 20 ]
Les médicaments contenant le principe actif valproate de sodium (acide valproïque), tels que Dépakine ou Convulex, préviennent le développement des crises d'absence typiques, ainsi que des crises myocloniques, tonico-cloniques et atoniques. Ils suppriment la photostimulation et corrigent les anomalies comportementales et cognitives chez les patients épileptiques. L'effet anticonvulsivant des valproates s'exerce vraisemblablement de deux manières. La principale, dose-dépendante, consiste en une augmentation directe de la concentration du principe actif dans le sang et, par conséquent, dans le tissu cérébral, ce qui contribue à une augmentation de la teneur en acide γ-aminobutyrique, activant ainsi les processus d'inhibition. Le second mécanisme d'action, complémentaire, pourrait être hypothétiquement associé à l'accumulation de métabolites du valproate de sodium dans les tissus cérébraux ou à des modifications des neurotransmetteurs. Il est possible que le médicament ait un effet direct sur les membranes des neurones. Contre-indiqué en cas d'hypersensibilité aux dérivés de l'acide valproïque, chez les patients présentant une hépatite chronique, même avec antécédents familiaux, et une porphyrie hépatique, ainsi qu'un déficit en enzymes impliquées dans la dégradation des composants auxiliaires du médicament. Le développement d'un large éventail d'effets secondaires est également dose-dépendant. Des effets indésirables peuvent survenir au niveau de l'hématopoïèse, du système nerveux central, des organes digestifs et excréteurs, et du système immunitaire. L'acide valproïque a des propriétés tératogènes. L'association avec la lamotrigine est déconseillée en raison du risque élevé de dermatite allergique pouvant aller jusqu'au syndrome de Lyell. L'association de valproates avec des préparations à base de plantes contenant du millepertuis est contre-indiquée. Ces médicaments doivent être associés avec prudence aux neuropsychotropes; la dose doit être ajustée si nécessaire. [ 21 ]
Le clonazépam, qui renforce les effets inhibiteurs de l'acide γ-aminobutyrique, est un médicament efficace contre les crises généralisées de tous types. Il est utilisé en cures courtes et à faibles doses thérapeutiques efficaces. Les cures longues dans l'épilepsie idiopathique sont déconseillées; son utilisation est limitée par des effets secondaires (y compris paradoxaux: augmentation des crises et des convulsions), ainsi que par une dépendance assez rapide. Contre-indiqué chez les patients sujets à l'arrêt respiratoire pendant le sommeil, à la faiblesse musculaire et à la confusion. Déconseillé aux personnes allergiques et aux patients présentant une insuffisance hépatique ou rénale sévère. Possède des propriétés tératogènes.
La lamotrigine aide à contrôler les absences généralisées et les crises tonico-cloniques. Ce médicament n'est généralement pas prescrit pour contrôler les crises myocloniques en raison de son action imprévisible. Son principal effet anticonvulsivant est associé à sa capacité à bloquer le flux d'ions sodium à travers les canaux des membranes présynaptiques des neurones, ralentissant ainsi la libération excessive de neurotransmetteurs excitateurs, principalement l'acide glutamique, le plus fréquent et le plus important dans le développement des crises d'épilepsie. D'autres effets sont associés à un impact sur les canaux calciques, le GABA et les mécanismes sérotoninergiques.
La lamotrigine présente moins d'effets secondaires que les anticonvulsivants classiques. Son utilisation est autorisée, si nécessaire, même chez les patientes enceintes. Elle est considérée comme le médicament de choix pour l'épilepsie idiopathique généralisée et focale.
L'éthosuximide est le médicament de choix pour les absences simples (épilepsie-absences de l'enfant). Cependant, il est moins efficace contre les myoclonies et n'a pratiquement aucun effet sur les crises tonico-cloniques généralisées. Par conséquent, il n'est plus prescrit pour les absences épileptiques juvéniles présentant un risque élevé de développer des crises tonico-cloniques généralisées. Les effets secondaires les plus fréquents se limitent à des symptômes dyspeptiques, des éruptions cutanées et des céphalées. Cependant, des modifications de la formule sanguine et des tremblements des membres peuvent parfois être observés. Dans de rares cas, des effets paradoxaux se développent: crises d'épilepsie majeures.
Le nouvel anticonvulsivant, le topiramate, un dérivé du fructose, est également recommandé pour le contrôle des crises généralisées et locales de l'épilepsie idiopathique. Contrairement à la lamotrigine et aux anticonvulsivants classiques, il ne soulage pas les symptômes affectifs. Le médicament est encore à l'étude, mais son efficacité sur les crises d'épilepsie a déjà été démontrée. Son mécanisme d'action repose sur le blocage des canaux sodiques potentiel-dépendants, ce qui inhibe l'apparition de potentiels d'excitation répétés. Il favorise également l'activation du médiateur inhibiteur, l'acide γ-aminobutyrique. On ne dispose pas encore d'informations sur l'apparition d'une dépendance à la prise de topiramate. Il est contre-indiqué chez les enfants de moins de six ans, les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que chez les personnes hypersensibles à ses composants. Le topiramate présente de nombreux effets secondaires, comme d'autres médicaments à action anticonvulsivante centrale.
Le lévétiracétam est un autre nouveau médicament utilisé dans le traitement de l'épilepsie idiopathique. Son mécanisme d'action est mal compris, mais il ne bloque pas les canaux sodiques et T-calciques et n'améliore pas la transmission GABA-ergique. On suppose que son effet anticonvulsivant se produit lorsque le médicament se fixe à la protéine vésiculaire synaptique SV2A. Le lévétiracétam présente également des effets anxiolytiques et antimaniaques modérés.
Lors d'essais cliniques en cours, ce médicament s'est avéré efficace pour contrôler les crises partielles et comme traitement complémentaire dans le traitement complexe des crises myocloniques généralisées et tonico-cloniques. Cependant, les études sur l'effet antiépileptique du lévétiracétam se poursuivront.
Aujourd'hui, les médicaments de choix pour le traitement de l'épilepsie généralisée idiopathique avec absences épileptiques sont les monothérapies de première intention à base de valproates, d'éthosuximide, de lamotrigine ou d'une association de valproates et d'éthosuximide. Les monothérapies de deuxième intention sont le topiramate, le clonazépam et le lévétiracétam. Dans les cas résistants, une polythérapie est utilisée. [ 22 ]
Il est recommandé de traiter l’épilepsie généralisée idiopathique avec crises myocloniques comme suit: première ligne – valproate ou lévétiracétam; deuxième ligne – topiramate ou clonazépam; troisième ligne – piracétam ou polythérapie.
Les crises tonico-cloniques généralisées sont traitées par monothérapie avec valproates, topiramate, lamotrigine; les médicaments de deuxième intention sont les barbituriques, le clonazépam, la carbamazépine; polythérapie.
Dans l'épilepsie idiopathique généralisée, il est préférable d'éviter de prescrire des médicaments anticonvulsivants classiques - carbamazépine, hapabentine, phénytoïne et autres, qui peuvent augmenter la fréquence des crises jusqu'au développement d'un état de mal épileptique.
Il est toujours recommandé de contrôler les crises focales avec des médicaments classiques dont le principe actif est la carbamazépine, la phénytoïne ou les valproates. En cas d'épilepsie rolandique, une monothérapie est utilisée, tandis que des anticonvulsivants sont prescrits à la dose minimale efficace (valproates, carbamazépines, diphénine). Les traitements complexes et les barbituriques ne sont pas utilisés.
Dans les épilepsies partielles idiopathiques, les troubles intellectuels et mnésiques sont généralement absents; les spécialistes ne considèrent donc pas qu'une polythérapie antiépileptique agressive soit justifiée. Une monothérapie par anticonvulsivants classiques est alors utilisée.
La durée du traitement, la fréquence d'administration et les doses sont déterminées individuellement. Il est recommandé de prescrire un traitement médicamenteux uniquement après une crise répétée; deux ans après la dernière crise, la question du sevrage médicamenteux peut être envisagée.
Dans la pathogenèse des crises d'épilepsie, on observe souvent une carence en vitamines B, notamment B1 et B6, en sélénium et en magnésium. Chez les patients sous traitement anticonvulsivant, la teneur en vitamines et minéraux, comme la biotine (B7) ou la vitamine E, diminue également. La prise de valproates réduit l'activité des crises, notamment par la lévocarnitine. Une carence en vitamine D peut se développer, entraînant une malabsorption du calcium et une fragilité osseuse. Chez le nouveau-né, les crises peuvent être causées par une carence en acide folique; si la mère a pris des anticonvulsivants, une carence en vitamine K peut se développer, affectant la coagulation sanguine. Les vitamines et minéraux peuvent être nécessaires en cas d'épilepsie idiopathique, mais leur utilisation est déterminée par le médecin. Une utilisation non contrôlée peut entraîner des conséquences indésirables et aggraver l'évolution de la maladie. [ 23 ]
La kinésithérapie n'est pas utilisée pour les crises d'épilepsie en cours. La kinésithérapie, les exercices thérapeutiques et les massages sont prescrits six mois après le début de la rémission. Au début de la rééducation (de six mois à deux ans), divers types d'interventions physiques sont utilisés, à l'exception des interventions sur la tête, de l'hydromassage, de la fangothérapie, de la stimulation électrique cutanée des muscles et des projections nerveuses périphériques. En cas de rémission de plus de deux ans, les mesures de rééducation après le traitement de l'épilepsie idiopathique incluent l'ensemble des procédures de kinésithérapie. Dans certains cas, par exemple si l'électroencéphalogramme montre des signes d'activité épileptiforme, la possibilité d'une kinésithérapie est évaluée au cas par cas. Les procédures sont prescrites en fonction du symptôme pathologique principal.
Remèdes populaires
L'épilepsie est une maladie très grave, et la traiter avec des remèdes populaires de nos jours, grâce aux médicaments qui contrôlent les crises, est pour le moins déraisonnable. Vous pouvez utiliser des remèdes populaires, mais seulement après avoir été approuvés par votre médecin. Malheureusement, ils ne peuvent remplacer des médicaments soigneusement sélectionnés et peuvent même en réduire l'efficacité.
Il est probablement sans danger de prendre un bain avec une décoction de foin d'herbes poussant dans la forêt. C'est ainsi que l'on traitait autrefois les épileptiques.
Une autre méthode populaire peut être utilisée en été, notamment pour les citadins, à la datcha. Il est recommandé de sortir tôt le matin, avant que la rosée ne sèche, et d'étendre une grande serviette, un drap ou une couverture en tissu naturel (coton ou lin) sur l'herbe. Imbibez-la de rosée. Enveloppez ensuite le patient dans le tissu, allongez-le ou asseyez-le, et ne le retirez pas avant qu'il ne sèche (cette méthode peut entraîner des risques d'hypothermie et de rhume).
L'arôme de la résine de l'arbre à myrrhe (myrrhe) a un effet très bénéfique sur le système nerveux. On croyait qu'un patient épileptique devait inhaler l'arôme de la myrrhe 24 heures sur 24 pendant un mois. Pour ce faire, vous pouvez remplir une lampe aromatique d'huile essentielle de myrrhe (quelques gouttes) ou apporter des morceaux de résine de l'église et en disperser une suspension dans la chambre du patient. Gardez simplement à l'esprit que toute odeur peut provoquer une réaction allergique.
Boire des jus fraîchement pressés comblera le manque de vitamines et de micro-éléments pendant la période de prise de médicaments anticonvulsivants.
Il est recommandé de boire un tiers de verre de jus de cerise frais deux fois par jour. Cette boisson a des effets anti-inflammatoires et bactéricides, apaise, soulage les spasmes vasculaires et est anesthésiante. Elle est capable de lier les radicaux libres. Elle améliore la composition sanguine, prévient le développement de l'anémie et élimine les toxines. Le jus de cerise est l'un des plus sains: il contient des vitamines B, notamment de l'acide folique et de l'acide nicotinique, des vitamines A et E, de l'acide ascorbique, du fer, du magnésium, du potassium, du calcium, des sucres, des pectines et bien d'autres substances précieuses.
Vous pouvez également consommer du jus de pousses d'avoine vertes et de leurs épillets à maturité laiteuse, comme tonique général. Ce jus, comme les autres, se boit avant les repas, à raison d'un tiers de verre deux ou trois fois par jour. Les jeunes pousses d'avoine sont riches en vitamines A, B, C et E, en enzymes, en fer et en magnésium. Ce jus purifie et restaure le sang, renforce l'immunité et normalise le métabolisme.
À partir de plantes médicinales, on peut également préparer des décoctions, des infusions et des thés pour renforcer le système immunitaire, le système nerveux et l'organisme dans son ensemble. Les traitements à base de plantes ne peuvent remplacer les anticonvulsivants, mais peuvent compléter leur effet. On utilise des plantes aux propriétés calmantes: pivoine, agripaume, valériane. Le millepertuis, selon les guérisseurs traditionnels, peut réduire la fréquence des crises et apaiser l'anxiété. C'est un anxiolytique naturel, mais il est incompatible avec les valproates.
Une infusion de fleurs d'arnica des montagnes se prend en une seule prise, soit 2 à 3 cuillères à soupe avant les repas, trois à cinq fois par jour. Laissez infuser une cuillère à soupe de fleurs séchées, puis versez un verre d'eau bouillante pendant une heure ou deux. Filtrez ensuite.
Les rhizomes d'angélique sont séchés, broyés et consommés en infusion, à raison d'un demi-verre avant les repas, trois à quatre fois par jour. La dose quotidienne est infusée comme suit: 400 ml d'eau bouillante sont versés sur deux cuillères à soupe de matière végétale. Après deux à trois heures, l'infusion est filtrée et bue tiède, en la réchauffant légèrement à chaque fois.
Homéopathie
Le traitement homéopathique de l'épilepsie idiopathique doit être supervisé par un médecin homéopathe. Il existe de nombreux remèdes pour traiter cette maladie: la belladone.
La belladone est utilisée pour les crises atoniques, les convulsions et le médicament peut également être efficace pour l'épilepsie partielle avec symptômes auditifs.
Bufo rana est efficace pour stopper les crises nocturnes, que le patient se réveille ou non, et Cocculus indicus est efficace pour stopper les crises qui surviennent le matin au réveil.
Mercurius et Laurocerasus sont utilisés pour les crises à composante atonique et les convulsions tonico-cloniques.
De nombreux autres médicaments sont utilisés dans le traitement des syndromes épileptiques. Lors de la prescription de médicaments homéopathiques, on prend en compte non seulement les principaux symptômes de la maladie, mais aussi le type constitutionnel, les habitudes, les traits de caractère et les préférences du patient.
De plus, l’homéopathie peut aider à récupérer rapidement et efficacement après une cure d’anticonvulsivants.
Traitement chirurgical
La chirurgie est une méthode radicale de traitement de l'épilepsie. Elle est pratiquée en cas de résistance aux traitements médicamenteux, de crises focales fréquentes et sévères qui nuisent irrémédiablement à la santé des patients et compliquent considérablement leur vie en société. Dans l'épilepsie idiopathique, le traitement chirurgical est rarement pratiqué, car elle répond bien au traitement conservateur.
Les interventions chirurgicales sont très efficaces. Elles sont parfois pratiquées dès la petite enfance et permettent d'éviter des troubles cognitifs.
L'examen préopératoire est essentiel pour établir une véritable résistance aux médicaments. La localisation du foyer épileptogène et l'étendue de l'intervention chirurgicale sont ensuite déterminées avec la plus grande précision possible. En cas d'épilepsie focale, les zones épileptogènes du cortex cérébral sont retirées ou déconnectées par de multiples incisions. En cas d'épilepsie généralisée, une hémisphérotomie est recommandée: une intervention chirurgicale qui permet de stopper les impulsions pathologiques responsables des crises entre les hémisphères cérébraux.
Un stimulateur est également implanté dans la région de la clavicule, qui agit sur le nerf vague et aide à réduire l'activité pathologique du cerveau et la fréquence des crises. [ 24 ]
La prévention
Il est quasiment impossible de prévenir le développement de l'épilepsie idiopathique. Cependant, même les femmes épileptiques ont 97 % de chances de donner naissance à un enfant en bonne santé. Ces chances sont augmentées par un mode de vie sain des deux parents, une grossesse bien menée et un accouchement naturel.
Prévoir
La grande majorité des cas d'épilepsie idiopathique sont bénins et ont un pronostic favorable. Une rémission thérapeutique complète est obtenue en moyenne chez plus de 80 % des patients, bien que certaines formes de la maladie, en particulier celles se développant chez les adolescents, nécessitent un traitement antiépileptique à long terme. Parfois, il est à vie. [ 25 ] Cependant, les médicaments modernes permettent généralement de contrôler les crises et d'assurer aux patients une qualité de vie normale.

