Expert médical de l'article
Nouvelles publications
Virus de l'encéphalite à tiques
Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.
Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.
Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.
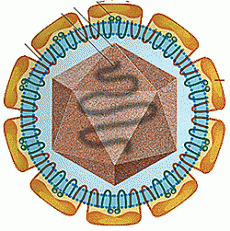
L'encéphalite à tiques est une maladie infectieuse présente en Russie, du Primorye jusqu'aux frontières occidentales, en zone forestière, habitat des tiques ixodides. Unité nosologique indépendante, elle a été identifiée en 1937 grâce aux travaux menés dans la taïga sibérienne par une expédition dirigée par L.A. Zilber. L'expédition comprenait d'éminents virologues (MP Chumakov, V.D. Soloviev), cliniciens et épidémiologistes. En trois mois, la nature virale de la maladie a été établie, les caractéristiques du virus et les principaux schémas épidémiologiques ont été déterminés, notamment la focalisation naturelle et la saisonnalité liée à l'activité des tiques. Parallèlement, les caractéristiques cliniques et la pathomorphologie de l'encéphalite à tiques ont été décrites, et des méthodes de prévention et de traitement ont été développées. D'autres études sur cette maladie ont montré sa prévalence non seulement en Russie, mais aussi à l'étranger. Depuis l'isolement du virus de l'encéphalite à tiques, plus de 500 souches ont été découvertes. Selon leur degré de pathogénicité pour la souris, leur relation avec les cultures de fibroblastes d'embryons de poulet et d'autres indicateurs, ils ont été divisés en trois groupes. Le troisième groupe comprend les souches faiblement virulentes.
Selon le type de porteur, il existe deux principaux types de virus de l'encéphalite à tiques: le persulcate oriental (porteur: Ixodes persukatus) et le ricin occidental (porteur: Ixodes ricinus). L'étude de la séquence nucléotidique de l'ARN génomique chez les représentants des types oriental et occidental du virus a révélé une homologie de 86 à 96 %. Ces dernières années, un troisième type de virus a été isolé chez des tiques Rhipicephalus bursa en Grèce. Selon l'évolution clinique, il existe deux principales variantes de la maladie: la variante orientale, plus grave, et la variante occidentale, plus bénigne.
Dans environ 80 % des cas, l'infection se produit par piqûre de tique et, dans 20 % des cas, par voie alimentaire lors de la consommation de lait cru de chèvre, de vache ou de brebis. Des cas d'infection en laboratoire sont également connus. Les enfants d'âge préscolaire et scolaire, ainsi que les travailleurs des équipes géologiques, sont les plus souvent touchés.
La période d'incubation est de 1 à 30 jours, le plus souvent de 7 à 12 jours à partir du moment où la tique s'accroche. L'apparition de la maladie est généralement aiguë: frissons, violents maux de tête, fièvre jusqu'à 38-39 °C, nausées, parfois vomissements, douleurs et contractions musculaires, et signes méningés.
Il existe trois principales formes d'encéphalite à tiques: fébrile, méningée et focale. La forme fébrile représente 30 à 50 % des cas, sans signe de méningite, l'évolution est favorable et une asthénie est rarement observée. La forme méningée représente 40 à 60 % des cas et se caractérise par un syndrome méningé avec modifications du liquide céphalorachidien. La fièvre peut être biphasique.
Les formes focales sont moins fréquentes (8 à 15 %). Les signes caractéristiques sont des symptômes méningés et des lésions focales du système nerveux de gravité variable, accompagnés de paralysie, de perte de sensibilité et d'autres symptômes neurologiques, ainsi que de lésions du tronc cérébral entraînant des troubles respiratoires et cardiaques. La mortalité est élevée et des complications persistantes persistent après la maladie.
Les diagnostics de laboratoire sont principalement réalisés par des méthodes virologiques et sérologiques. Le virus est isolé du sang, du liquide céphalorachidien, de l'urine, plus rarement des prélèvements nasopharyngés, des selles et du matériel d'autopsie lors de l'infection de cultures cellulaires. Le virus est typé selon différentes variantes de la réaction de neutralisation biologique. La méthode sérologique permet de détecter des anticorps spécifiques du virus par RSK, neutralisation, RTGA et immuno-absorption.
Le traitement est symptomatique. Pour prévenir la maladie, on utilise un vaccin contre l'encéphalite à tiques, à base de cultures inactivées.

