Expert médical de l'article
Nouvelles publications
HPV de type 18 chez les femmes
Dernière revue: 07.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.
Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.
Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.
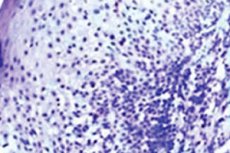
La particularité de l'appareil reproducteur féminin réside dans le fait que ses organes sont pour la plupart situés à l'intérieur du corps, à l'abri des regards. Si des processus pathologiques se développent dans les ovaires, le vagin, l'utérus ou les trompes de Fallope, ils ne se manifesteront pas forcément immédiatement. La pénétration d'une infection bactérienne ou virale et d'une inflammation des organes génitaux internes peut débuter par des douleurs et des pertes inhabituelles, ou évoluer discrètement. Cependant, l'ajout d'une infection à papillomavirus complique dans la plupart des cas l'évolution de la maladie, tout comme la présence de chlamydia, de mycoplasmes et d'autres agents pathogènes favorisant le processus inflammatoire.
Il convient de noter que la probabilité d'infection par le papillomavirus est la même chez les personnes en âge de procréer des deux sexes. Cependant, les conséquences d'une telle infection sont différentes chez les femmes et les hommes. Les organes reproducteurs féminins étant situés à l'intérieur du corps et recouverts d'une muqueuse délicate, facile à pénétrer par les virions, le virus est plus nocif pour le sexe faible. De plus, les procédures d'hygiène des organes internes sont difficiles, et le nettoyage naturel de l'utérus et du vagin ne permet pas d'éliminer complètement le virus qui pénètre dans les cellules.
Dans la pathologie virale chez la femme, des infections bactériennes se joignent souvent, affaiblissant davantage le corps, car pour elles l'environnement chaud et humide du vagin est véritablement une idylle pour la vie et la reproduction, si seulement le système immunitaire permet une telle vie.
Par exemple, l'érosion cervicale, l'une des pathologies les plus fréquemment détectées lors d'un examen gynécologique, peut ne pas provoquer de symptômes spécifiques. Dans 90 % des cas, le diagnostic est posé après un nouvel examen gynécologique, car c'est le seul moyen pour le médecin d'évaluer l'état de son appareil reproducteur. Chez certaines femmes, l'apparition d'un foyer érosif-inflammatoire entraîne une augmentation des pertes physiologiques naturelles. En revanche, si ces pertes ne présentent pas d'odeur désagréable ni de couleur jaunâtre-verdâtre suspecte indiquant la présence de pus, la patiente peut ne pas s'en inquiéter particulièrement, attribuant tout à l'hypothermie et à une baisse de l'immunité.
Beaucoup plus rarement, une gêne lors des rapports sexuels, une sensation de lourdeur dans le bas-ventre ou l'apparition de traces sanglantes dans les pertes vaginales physiologiques en dehors des règles peuvent indiquer une lésion de la muqueuse utérine à l'entrée du canal cervical. Si une douleur dans le bas-ventre survient, que le cycle menstruel est perturbé et qu'une leucorrhée malodorante apparaît, il ne s'agit pas tant de l'érosion elle-même que d'un processus inflammatoire provoqué par l'activation de micro-organismes opportunistes dans la lésion. Il est toutefois possible que des agents pathogènes (la même chlamydia ou des virus) aient pénétré dans l'utérus.
Chez les femmes présentant une érosion chronique, l'analyse révèle généralement la présence de virions du VPH. Il ne s'agit pas nécessairement de virus hautement oncogènes. On détecte généralement une microflore mixte: micro-organismes opportunistes, mycoplasmes, ureaplasma, chlamydia, papillomavirus (généralement de une à quatre variétés), herpèsvirus. Il est difficile de déterminer la contribution de chaque agent pathogène au maintien et au développement du processus inflammatoire dans la zone affectée, mais il faut reconnaître que leur présence complique toujours la situation et contribue à l'augmentation de la taille de l'érosion.
Un processus érosif prolongé peut à un moment donné changer de nature et, outre l'inflammation de la zone affectée, le médecin peut observer une prolifération de mucus (dysplasie cervicale). Il est important de noter que l'un des principaux facteurs déclenchant ce processus est l'infection par le papillomavirus. Les foyers érosifs sont les zones les plus vulnérables de la muqueuse de l'utérus et du vagin; le virus y pénètre donc beaucoup plus facilement dans les tissus des organes, puis dans les cellules.
Si des types hautement oncogènes de papillomavirus ( HPV 18 et 16) sont détectés dans les frottis, en plus de processus dysplasiques, qui correspondent à une tumeur bénigne, on peut s'attendre à une dégénérescence de cellules tumorales individuelles en cellules malignes. En effet, la modification des propriétés de la cellule hôte est intégrée au génome des virions hautement oncogènes, et le comportement de ces cellules mutées n'est plus contrôlé par le système immunitaire.
Il est difficile de dire si le papillomavirus lui-même est capable de provoquer une érosion cervicale (si cela se produit, ce ne sera pas pour bientôt). Cependant, il est tout à fait capable de provoquer des processus dysplasiques, même en l'absence de processus érosif, en pénétrant dans les microlésions de la muqueuse utérine et vaginale, ce qui peut survenir après un avortement, des rapports sexuels actifs ou être le résultat de rapports sexuels fréquents et immodérés. Dans ce cas, la dysplasie persistera très longtemps sans symptômes. Les symptômes ne seront causés que par des maladies concomitantes (processus érosifs-inflammatoires, qui se développent souvent dans le contexte d'une infection à papillomavirus).
Si la dysplasie est due à des virus de types 16 et 18, dans la moitié des cas, après 10 ans ou plus, la maladie évolue vers un cancer du col de l'utérus. Les médecins anticipent une telle évolution et prescrivent donc systématiquement une analyse spécifique permettant d'identifier le virus dans un frottis (la cytologie classique n'est pas informative à cet égard) et d'en déterminer le type. Les foyers d'érosion et de dysplasie doivent être retirés, qu'un type hautement oncogène de papillomavirus y soit détecté ou non. En cas de détection, une intervention chirurgicale visant à exciser les tissus pathologiques est obligatoire, ainsi qu'une surveillance régulière de l'état de la muqueuse utérine.
Une autre pathologie, dont le développement est associé au virus papillomateux, est le kyste ovarien. Un kyste est considéré comme une tumeur bénigne. Il ressemble à une poche de liquide, qui peut même dépasser la taille de l'organe lui-même, le comprimant et empêchant la libération de l'ovule.
Les médecins associent la formation de kystes à des interventions chirurgicales sur les organes génitaux, à des maladies érosives et inflammatoires de l'utérus, à des troubles hormonaux (dans la moitié des cas), à des règles précoces, à des troubles du cycle, etc. Idéalement, la néoplasie (kyste lutéal formé à partir du corps jaune et kyste folliculaire formé en cas d'échec de la sortie de l'ovule) devrait se résorber spontanément. Les kystes hémorragiques et endométriosiques sont traitables.
Le plus grand danger est représenté par le kyste mucineux, présent chez les femmes de plus de 50 ans et composé de plusieurs loges à croissance rapide, et par le kyste paraovarien, qui se forme non pas sur l'ovaire, mais sur les ovaires et qui est également sujet à une croissance rapide. Il est difficile de déterminer si le papillomavirus est impliqué dans la formation de ces kystes, mais la présence de VPH 16, 18 ou de virions d'un autre type hautement oncogène dans l'organisme entraîne un risque élevé de dégénérescence d'une tumeur bénigne en tumeur maligne.
Si une femme reçoit un diagnostic d'érosion cervicale, de kystes ovariens, de dysplasie utérine et de VPH de type 16 ou 18, les médecins tirent la sonnette d'alarme. On ne peut pas affirmer qu'un virus hautement oncogène provoque nécessairement un cancer du col de l'utérus ou de l'ovaire, mais sa présence dans l'organisme multiplie par plusieurs le risque de développer une maladie mortelle.
 [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]
[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]

