Expert médical de l'article
Nouvelles publications
Décryptage des résultats de l'électroencéphalographie
Dernière revue: 06.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.
Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.
Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.
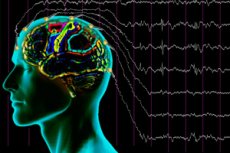
L'analyse EEG est réalisée pendant et après l'enregistrement. Lors de l'enregistrement, la présence d'artefacts (induction de champs de courant de réseau, artefacts mécaniques liés au mouvement des électrodes, électromyogramme, électrocardiogramme, etc.) est évaluée et des mesures sont prises pour les éliminer. La fréquence et l'amplitude de l'EEG sont évaluées, les éléments graphiques caractéristiques sont identifiés et leur distribution spatio-temporelle est déterminée. L'analyse est complétée par une interprétation physiologique et physiopathologique des résultats et par la formulation d'une conclusion diagnostique avec corrélation clinico-électroencéphalographique.
Le principal document médical relatif à l'EEG est le compte rendu clinique électroencéphalographique, rédigé par un spécialiste à partir de l'analyse de l'EEG brut. Ce compte rendu doit être rédigé conformément à certaines règles et comporter trois parties:
- description des principaux types d’activités et des éléments graphiques;
- résumé de la description et de son interprétation physiopathologique;
- Corrélation des résultats des deux parties précédentes avec les données cliniques. Le terme descriptif de base en EEG est « activité », qui définit toute séquence d'ondes (activité alpha, activité d'ondes aiguës, etc.).
- La fréquence est définie comme le nombre d'oscillations par seconde; elle est notée sous forme de nombre correspondant et exprimée en hertz (Hz). La description indique la fréquence moyenne de l'activité évaluée. Généralement, 4 à 5 segments EEG d'une durée d'une seconde sont prélevés et le nombre d'ondes de chacun est calculé.
- L'amplitude est la plage des oscillations du potentiel électrique sur l'EEG; elle est mesurée du pic de l'onde précédente au pic de l'onde suivante en phase opposée, exprimée en microvolts (μV). Un signal d'étalonnage est utilisé pour mesurer l'amplitude. Ainsi, si le signal d'étalonnage correspondant à une tension de 50 μV a une hauteur de 10 mm sur l'enregistrement, alors, par conséquent, une déviation de 1 mm du stylo correspondra à 5 μV. Pour caractériser l'amplitude de l'activité dans la description de l'EEG, on prend ses valeurs maximales les plus courantes, en excluant les valeurs aberrantes.
- La phase détermine l'état actuel du processus et indique la direction du vecteur de ses variations. Certains phénomènes EEG sont évalués par le nombre de phases qu'ils comportent. Une oscillation monophasique est une oscillation dans une direction à partir de la droite isoélectrique avec retour au niveau initial; une oscillation biphasique est une oscillation où, après l'achèvement d'une phase, la courbe dépasse le niveau initial, dévie dans la direction opposée et revient à la droite isoélectrique. Les oscillations polyphasiques sont des oscillations contenant trois phases ou plus. Au sens strict, le terme « onde polyphasique » définit une séquence d'ondes alpha et lentes (généralement cinq).
Rythmes de l'électroencéphalogramme d'une personne adulte éveillée
Le terme « rythme » en EEG désigne un type d'activité électrique correspondant à un état particulier du cerveau et associé à certains mécanismes cérébraux. La description d'un rythme inclut sa fréquence, typique d'un état et d'une zone cérébrale donnés, son amplitude et certaines caractéristiques de son évolution au fil du temps, en fonction des variations de l'activité fonctionnelle cérébrale.
- Rythme alpha(a): fréquence de 8 à 13 Hz, amplitude jusqu’à 100 μV. Il est observé chez 85 à 95 % des adultes en bonne santé. Il est particulièrement prononcé au niveau occipital. Le rythme alpha présente une amplitude maximale dans un état de veille calme et détendu, les yeux fermés. Outre les modifications liées à l’état fonctionnel du cerveau, des variations spontanées de l’amplitude du rythme alpha sont observées dans la plupart des cas, se traduisant par une alternance d’augmentation et de diminution, avec formation de « fuseaux » caractéristiques durant 2 à 8 s. Avec l’augmentation de l’activité fonctionnelle cérébrale (attention intense, peur), l’amplitude du rythme alpha diminue. Une activité irrégulière de basse amplitude et de haute fréquence apparaît à l’EEG, reflétant une désynchronisation de l’activité neuronale. Lors d'une stimulation externe brève et soudaine (notamment un éclair lumineux), cette désynchronisation se produit brutalement. Si la stimulation n'est pas de nature émotigène, le rythme a est rétabli assez rapidement (en 0,5 à 2 secondes). Ce phénomène est appelé « réaction d'activation », « réaction d'orientation », « réaction d'extinction du rythme a » ou « réaction de désynchronisation ».
- Rythme bêta: fréquence de 14 à 40 Hz, amplitude jusqu’à 25 μV. Le rythme bêta est mieux enregistré dans la zone des circonvolutions centrales, mais s’étend également aux circonvolutions centrales postérieures et frontales. Normalement, il est très faiblement exprimé et, dans la plupart des cas, a une amplitude de 5 à 15 μV. Le rythme bêta est associé à des mécanismes corticaux somatiques, sensoriels et moteurs, et provoque une réaction d’extinction à l’activation motrice ou à la stimulation tactile. Une activité d’une fréquence de 40 à 70 Hz et d’une amplitude de 5 à 7 μV est parfois appelée « rythme y »; elle n’a aucune signification clinique.
- Rythme mu: fréquence de 8 à 13 Hz, amplitude jusqu’à 50 μV. Les paramètres du rythme mu sont similaires à ceux du rythme a normal, mais il diffère de ce dernier par ses propriétés physiologiques et sa topographie. Visuellement, le rythme mu n’est observé que chez 5 à 15 % des sujets de la région rolandique. L’amplitude du rythme mu augmente (rarement) avec l’activation motrice ou la stimulation somatosensorielle. En analyse de routine, le rythme mu n’a aucune signification clinique.
Types d'activités pathologiques pour une personne adulte éveillée
- Activité thêta: fréquence 4-7 Hz, amplitude de l'activité thêta pathologique > 40 μV et dépasse le plus souvent l'amplitude des rythmes cérébraux normaux, atteignant 300 μV ou plus dans certaines conditions pathologiques.
- Activité delta: fréquence 0,5-3 Hz, l'amplitude est la même que l'activité thêta.
Des oscillations thêta et delta peuvent être présentes en faible quantité dans l'EEG d'un adulte éveillé et dans la norme, mais leur amplitude ne dépasse pas celle du rythme a. Un EEG contenant des oscillations thêta et delta d'une amplitude supérieure à 40 μV et occupant plus de 15 % du temps d'enregistrement total est considéré comme pathologique.
L'activité épileptiforme est un phénomène généralement observé à l'EEG des patients épileptiques. Elle résulte de changements de dépolarisation paroxystiques hautement synchronisés dans de larges populations de neurones, accompagnés de la génération de potentiels d'action. Il en résulte des potentiels aigus de forte amplitude, portant des noms correspondants.
- Un pic (en anglais spike - point, crête) est un potentiel négatif de forme aiguë, d'une durée inférieure à 70 ms, avec une amplitude de > 50 μV (parfois jusqu'à des centaines voire des milliers de μV).
- Une onde aiguë diffère d'un pic en ce qu'elle est prolongée dans le temps: sa durée est de 70 à 200 ms.
- Les ondes aiguës et les pointes peuvent être combinées avec des ondes lentes, formant ainsi des complexes stéréotypés. Une onde pointe-lente est un complexe formé d'une pointe et d'une onde lente. La fréquence de ces complexes est de 2,5 à 6 Hz, et leur période est respectivement de 160 à 250 ms. Une onde aiguë-lente est un complexe formé d'une onde aiguë et d'une onde lente qui la suit, et sa période est de 500 à 1 300 ms.
Une caractéristique importante des pics et des ondes aiguës est leur apparition et leur disparition soudaines, ainsi que leur nette distinction avec l'activité de fond, dont l'amplitude dépasse celle de l'activité de fond. Les phénomènes aigus dont les paramètres correspondants ne se distinguent pas clairement de l'activité de fond ne sont pas qualifiés d'ondes aiguës ou de pics.
Les combinaisons des phénomènes décrits sont désignées par des termes supplémentaires.
- Le terme « burst » est utilisé pour décrire un groupe d’ondes avec un début et une fin soudains qui sont clairement distinctes de l’activité de fond en termes de fréquence, de forme et/ou d’amplitude.
- Une décharge est une explosion d’activité épileptiforme.
- Un schéma de crise épileptique est une décharge d'activité épileptiforme qui coïncide généralement avec une crise d'épilepsie clinique. La détection de tels phénomènes, même si l'état de conscience du patient ne peut être clairement évalué cliniquement, est également qualifiée de « schéma de crise épileptique ».
- L'hypsarythmie (du grec « rythme de grande amplitude ») est une activité hypersynchrone lente, continue et généralisée, de grande amplitude (> 150 μV), caractérisée par des ondes aiguës, des pointes, des complexes pointes-ondes lentes, des polypointes-ondes lentes, synchrones et asynchrones. Il s'agit d'une caractéristique diagnostique importante des syndromes de West et de Lennox-Gastaut.
- Les complexes périodiques sont des bouffées d'activité de forte amplitude caractérisées par une forme constante chez un patient donné. Les critères les plus importants pour leur identification sont: un intervalle quasi constant entre les complexes; une présence continue tout au long de l'enregistrement, à condition que le niveau d'activité cérébrale fonctionnelle soit constant; une stabilité intra-individuelle de la forme (stéréotypie). Le plus souvent, ils se présentent sous la forme d'un groupe d'ondes lentes et aiguës de forte amplitude, associées à des oscillations delta ou thêta aiguës de forte amplitude, ressemblant parfois à des complexes épileptiformes d'onde aiguë-lente. L'intervalle entre les complexes varie de 0,5 à 2 secondes, voire plusieurs dizaines de secondes. Les complexes périodiques généralisés, bilatéralement synchrones, sont toujours associés à des troubles profonds de la conscience et indiquent des lésions cérébrales graves. S'ils ne sont pas causés par des facteurs pharmacologiques ou toxiques (sevrage alcoolique, surdosage ou arrêt brutal de médicaments psychotropes et hypnosédatifs, hépatopathie, intoxication au monoxyde de carbone), ils sont généralement la conséquence d'une encéphalopathie métabolique, hypoxique, à prions ou virale grave. Si l'intoxication ou les troubles métaboliques sont exclus, les complexes périodiques avec une grande fiabilité indiquent un diagnostic de panencéphalite ou de maladie à prions.
Variantes d'un électroencéphalogramme normal chez un adulte éveillé
L'EEG est globalement uniforme et symétrique pour l'ensemble du cerveau. L'hétérogénéité fonctionnelle et morphologique du cortex détermine les caractéristiques de l'activité électrique des différentes zones cérébrales. La variation spatiale des types d'EEG dans chaque zone cérébrale se produit progressivement.
Chez la majorité (85-90%) des adultes en bonne santé, les yeux fermés au repos, l'EEG enregistre un arythmie dominant avec une amplitude maximale dans les régions occipitales.
Chez 10 à 15 % des sujets sains, l'amplitude des oscillations de l'EEG ne dépasse pas 25 μV; une activité de faible amplitude à haute fréquence est enregistrée sur toutes les dérivations. Ces EEG sont dits de faible amplitude. Ils indiquent la prévalence d'influences désynchronisantes dans le cerveau et constituent une variante normale.
Chez certains sujets sains, au lieu du rythme alpha, une activité de 14 à 18 Hz d'une amplitude d'environ 50 μV est enregistrée dans les zones occipitales et, comme pour le rythme alpha normal, l'amplitude diminue vers l'avant. Cette activité est appelée « variante alpha rapide ».
Très rarement (0,2 % des cas), l'EEG, yeux fermés, enregistre des ondes lentes régulières, quasi sinusoïdales, d'une fréquence de 2,5 à 6 Hz et d'une amplitude de 50 à 80 μV dans les régions occipitales. Ce rythme présente toutes les autres caractéristiques topographiques et physiologiques du rythme alpha et est appelé « variante alpha lente ». N'étant associé à aucune pathologie organique, il est considéré comme une limite entre la norme et la pathologie et peut indiquer un dysfonctionnement des systèmes diencéphaliques non spécifiques du cerveau.
Modifications de l'électroencéphalogramme pendant le cycle veille-sommeil
- L'éveil actif (lors d'un stress mental, d'un suivi visuel, d'un apprentissage et d'autres situations nécessitant une activité mentale accrue) est caractérisé par une désynchronisation de l'activité neuronale; l'activité à haute fréquence de faible amplitude prédomine sur l'EEG.
- L'état de veille détendu correspond à l'état du sujet, assis confortablement dans un fauteuil ou un lit, les muscles détendus et les yeux fermés, sans activité physique ou mentale particulière. Chez la plupart des adultes en bonne santé, un rythme alpha régulier est enregistré à l'EEG dans cet état.
- Le premier stade du sommeil correspond à la somnolence. L'EEG montre la disparition du rythme alpha et l'apparition d'oscillations delta et thêta, isolées ou groupées, de faible amplitude, ainsi que d'une activité de faible amplitude et de haute fréquence. Des stimuli externes provoquent des bouffées du rythme alpha. Ce stade dure de 1 à 7 minutes. À la fin de ce stade, des oscillations lentes d'une amplitude inférieure à 75 μV apparaissent. Parallèlement, des « potentiels transitoires aigus au vertex » peuvent apparaître sous la forme d'ondes aiguës superficiellement négatives, monophasiques, isolées ou groupées, avec un maximum au niveau de la couronne, et une amplitude ne dépassant généralement pas 200 μV; ils sont considérés comme un phénomène physiologique normal. Le premier stade est également caractérisé par des mouvements oculaires lents.
- Le deuxième stade du sommeil est caractérisé par l'apparition de fuseaux de sommeil et de complexes K. Les fuseaux de sommeil sont des bouffées d'activité d'une fréquence de 11 à 15 Hz, prédominantes dans les dérivations centrales. Leur durée est de 0,5 à 3 s et leur amplitude d'environ 50 μV. Ils sont associés à des mécanismes sous-corticaux médians. Le complexe K est une bouffée d'activité, généralement constituée d'une onde biphasique de forte amplitude avec une phase initiale négative, parfois accompagnée d'un fuseau. Son amplitude est maximale dans la région coronale et sa durée est d'au moins 0,5 s. Les complexes K apparaissent spontanément ou en réponse à des stimuli sensoriels. À ce stade, des bouffées d'ondes lentes polyphasiques de forte amplitude sont également observées épisodiquement. Les mouvements oculaires lents sont absents.
- Sommeil de stade 3: les fuseaux disparaissent progressivement et des ondes delta et thêta d'amplitude supérieure à 75 μV apparaissent en quantités représentant 20 à 50 % de la période d'analyse. À ce stade, il est souvent difficile de différencier les complexes K des ondes delta. Les fuseaux du sommeil peuvent disparaître complètement.
- Le sommeil de stade IV est caractérisé par des ondes d'une fréquence < 2 Hz et supérieure à 75 μV, occupant plus de 50 % du temps de l'époque d'analyse.
- Pendant le sommeil, l'EEG présente parfois des périodes de désynchronisation, appelées sommeil avec mouvements oculaires rapides. Durant ces périodes, une activité polymorphe avec une prédominance de hautes fréquences est enregistrée. Ces périodes sur l'EEG correspondent à l'expérience du rêve, à une baisse du tonus musculaire avec apparition de mouvements rapides des globes oculaires et parfois des membres. L'apparition de ce stade de sommeil est associée au fonctionnement du mécanisme de régulation au niveau du pont; sa perturbation indique un dysfonctionnement de ces zones du cerveau, ce qui est d'une importance diagnostique majeure.
 [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]
[ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]
Modifications liées à l'âge dans l'électroencéphalogramme
L'EEG d'un bébé prématuré jusqu'à 24-27 semaines de gestation est représenté par des poussées d'activité lente delta et thêta, combinées épisodiquement avec des ondes aiguës, d'une durée de 2 à 20 s, sur fond d'activité de faible amplitude (jusqu'à 20-25 μV).
Chez les enfants de 28 à 32 semaines de gestation, l'activité delta et thêta d'une amplitude allant jusqu'à 100-150 μV devient plus régulière, bien qu'elle puisse également inclure des poussées d'activité thêta d'amplitude plus élevée entrecoupées de périodes d'aplatissement.
Chez les enfants de plus de 32 semaines de gestation, les états fonctionnels commencent à être retracés à l'EEG. Pendant le sommeil calme, on observe une activité delta intermittente de forte amplitude (jusqu'à 200 μV et plus), associée à des oscillations thêta et à des ondes aiguës, et alternant avec des périodes d'activité de relativement faible amplitude.
Chez un nouveau-né à terme, l'EEG distingue clairement entre l'état de veille avec les yeux ouverts (activité irrégulière avec une fréquence de 4-5 Hz et une amplitude de 50 μV), le sommeil actif (activité constante de faible amplitude de 4-7 Hz avec des oscillations de faible amplitude plus rapides superposées) et le sommeil calme, caractérisé par des poussées d'activité delta de grande amplitude en combinaison avec des fuseaux d'ondes de haute amplitude plus rapides entrecoupées de périodes de faible amplitude.
Chez les nouveau-nés prématurés et nés à terme en bonne santé, une activité alternée est observée pendant le sommeil calme au cours du premier mois de vie. L'EEG des nouveau-nés présente des potentiels aigus physiologiques caractérisés par une multifocalité, une occurrence sporadique et une occurrence irrégulière. Leur amplitude ne dépasse généralement pas 100-110 μV, leur fréquence d'apparition étant en moyenne de 5 par heure, et leur nombre principal étant limité au sommeil calme. Des potentiels aigus relativement réguliers dans les dérivations frontales, ne dépassant pas 150 μV d'amplitude, sont également considérés comme normaux. L'EEG normal d'un nouveau-né mature se caractérise par la présence d'une réponse sous forme d'aplatissement de l'EEG aux stimuli externes.
Au cours du premier mois de vie d'un enfant mature, l'EEG alterné du sommeil calme disparaît; au cours du deuxième mois, apparaissent des fuseaux de sommeil, une activité dominante organisée dans les dérivations occipitales, atteignant une fréquence de 4 à 7 Hz à l'âge de 3 mois.
Entre le 4e et le 6e mois, le nombre d'ondes thêta sur l'EEG augmente progressivement, tandis que les ondes delta diminuent. À la fin du 6e mois, l'EEG est alors dominé par un rythme de fréquence comprise entre 5 et 7 Hz. Du 7e au 12e mois, le rythme alpha se forme, avec une diminution progressive du nombre d'ondes thêta et delta. À 12 mois, les oscillations, que l'on peut qualifier de rythme alpha lent (7-8,5 Hz), dominent. De 1 an à 7-8 ans, le processus de remplacement progressif des rythmes lents par des oscillations plus rapides (gamme alpha et bêta) se poursuit. Après 8 ans, le rythme alpha domine sur l'EEG. La formation définitive de l'EEG survient entre 16 et 18 ans.
Valeurs limites de la fréquence rythmique dominante chez l'enfant
Âge, années |
Fréquence, Hz |
1 |
>5 |
3 |
>6 |
5 |
>7 |
8 |
>8 |
L'EEG des enfants en bonne santé peut contenir des ondes lentes diffuses excessives, des salves d'oscillations lentes rythmiques et des décharges d'activité épileptiforme, de sorte que du point de vue de l'évaluation traditionnelle des normes d'âge, même chez les individus manifestement en bonne santé de moins de 21 ans, seulement 70 à 80 % de l'EEG peut être classé comme « normal ».
De 3-4 à 12 ans, la proportion d'EEG avec des ondes lentes excessives augmente (de 3 à 16%), puis cet indicateur diminue assez rapidement.
La réponse à l'hyperventilation sous forme d'ondes lentes de grande amplitude chez les enfants de 9 à 11 ans est plus prononcée que chez les plus jeunes. Il est toutefois possible que cela soit dû à la performance moins précise du test par les plus jeunes.
Représentation de certaines variantes de l'EEG dans la population saine en fonction de l'âge
Type d'activité |
1 à 15 ans |
16-21 ans |
Activité diffuse lente d'amplitude supérieure à 50 μV, enregistrée pendant plus de 30 % du temps d'enregistrement |
14% |
5% |
Activité rythmique lente dans les dérivations postérieures |
25% |
0,5% |
Activité épileptiforme, bouffées d'ondes lentes rythmiques |
15% |
5% |
Variantes EEG « normales » |
68% |
77% |
La relative stabilité des caractéristiques EEG d'un adulte, déjà mentionnée, se maintient jusqu'à environ 50 ans. À partir de cette période, on observe une restructuration du spectre EEG, se traduisant par une diminution de l'amplitude et de la quantité relative du rythme alpha, ainsi qu'une augmentation de la quantité d'ondes bêta et delta. La fréquence dominante tend à diminuer après 60-70 ans. À cet âge, les ondes thêta et delta, visibles à l'analyse visuelle, apparaissent également chez des individus pratiquement sains.

