Déficit immunitaire secondaire
Last reviewed: 25.06.2018

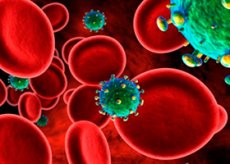
Prévalence importante des maladies infectieuses et inflammatoires chroniques dans la population, réticentes au traitement conventionnel et accompagnant de nombreuses maladies somatiques; évolution sévère des maladies infectieuses aiguës, se terminant parfois par la mort; complications septiques après interventions chirurgicales, blessures graves, stress, brûlures; complications infectieuses dans le contexte de la chimioradiothérapie; prévalence élevée de personnes fréquemment malades et de longue durée, provoquant jusqu'à 40 % de toutes les pertes de travail; l'émergence d'une maladie infectieuse du système immunitaire telle que le SIDA, a déterminé l'émergence du terme immunodéficience secondaire.
L'immunodéficience secondaire se caractérise par des troubles du système immunitaire qui se développent à la fin de la période postnatale chez l'adulte et l'enfant et ne résultent d'aucune anomalie génétique. Leur mécanisme d'origine est hétérogène, entraînant une morbidité infectieuse accrue; une évolution atypique du processus infectieux et inflammatoire, de localisation et d'étiologies diverses, et une lenteur à un traitement étiotrope bien choisi. L'immunodéficience secondaire se caractérise par la présence obligatoire d'une infection purulente-inflammatoire. Il convient de noter que l'infection elle-même peut être à la fois une manifestation et une cause d'altération de la réponse immunitaire.
Sous l'influence de divers facteurs (infections, pharmacothérapie, radiothérapie, situations de stress diverses, blessures, etc.), une défaillance de la réponse immunitaire peut se développer, entraînant des modifications transitoires et irréversibles de la réponse immunitaire. Ces modifications peuvent être à l'origine d'un affaiblissement des défenses anti-infectieuses.
 [ 1 ]
[ 1 ]
Quelles sont les causes de l’immunodéficience secondaire?
La classification la plus répandue et la plus acceptée des déficits immunitaires secondaires a été proposée par RM Khaiton. Ils distinguent trois formes de déficits immunitaires secondaires.
- déficit immunitaire secondaire acquis (SIDA);
- induit;
- spontané.
L'immunodéficience secondaire induite résulte de causes externes à l'origine de son apparition: infections, radiographies, traitements cytostatiques, prise de glucocorticoïdes, traumatismes et interventions chirurgicales. La forme induite inclut également les troubles immunitaires secondaires à la maladie principale (diabète, maladie hépatique, maladie rénale, tumeurs malignes). En présence d'une cause spécifique entraînant une altération irréversible du système immunitaire, une immunodéficience secondaire se développe, avec des manifestations cliniques et des principes thérapeutiques caractéristiques. Par exemple, la radiothérapie et la chimiothérapie peuvent entraîner des lésions irréversibles du pool de cellules responsables de la synthèse des immunoglobulines. Ces patients, par leur évolution clinique et leurs principes thérapeutiques, ressemblent alors à ceux des patients atteints de DIP, avec atteinte du lien humoral de l'immunité. Au XXe siècle, l'humanité a été confrontée pour la première fois à l'infection virale par le VIH, qui endommage de manière irréversible les cellules du système immunitaire, entraînant le développement d'une maladie infectieuse grave, le SIDA. Cette maladie se caractérise par une mortalité élevée, des caractéristiques épidémiologiques, des manifestations cliniques et des principes thérapeutiques spécifiques. Dans ce cas, l'inducteur du développement de l'immunodéficience est un virus immunotrope qui endommage irréversiblement les lymphocytes, provoquant une immunodéficience secondaire. Compte tenu des dommages directs irréversibles causés par le virus aux cellules immunocompétentes (lymphocytes T), ainsi que de la gravité et du caractère épidémique de l'évolution de la maladie, celle-ci a été isolée dans un groupe distinct d'immunodéficiences génétiquement indéterminées, à savoir l'immunodéficience acquise secondaire (SIDA).
En cas de déficit réversible du système immunitaire, une maladie autonome n'apparaît pas, mais la morbidité infectieuse augmente en raison de la maladie sous-jacente (diabète sucré, maladie rénale, maladie hépatique, tumeurs malignes, etc.) ou d'un effet inducteur (infections, stress, pharmacothérapie, etc.). Ce déficit immunitaire secondaire peut souvent être éliminé en éliminant la cause et en adoptant un traitement de fond adapté à la maladie sous-jacente. Le traitement de ces patients repose principalement sur un diagnostic correct, la correction des pathologies concomitantes et la prise en compte des effets secondaires de la pharmacothérapie visant à éliminer ceux qui conduisent au déficit immunitaire.
L'immunodéficience secondaire spontanée se caractérise par l'absence de cause évidente à l'origine d'un trouble du système immunitaire. Cette forme se manifeste cliniquement par des maladies infectieuses et inflammatoires chroniques, souvent récurrentes, de l'appareil bronchopulmonaire, des sinus paranasaux, des appareils génito-urinaire et digestif, des yeux, de la peau et des tissus mous, causées par des micro-organismes opportunistes ou opportunistes. Les patients atteints d'immunodéficiences secondaires spontanées constituent un groupe hétérogène, et beaucoup pensent que ces maladies doivent être liées à des causes encore indéterminées. On peut supposer que la cause des immunodéficiences secondaires est un déficit congénital d'un composant du système immunitaire, compensé pendant un certain temps par l'activité fonctionnelle élevée normale d'autres maillons de ce système. Ce déficit ne peut être identifié pour diverses raisons: approche méthodologique inadéquate, utilisation de matériel de recherche inapproprié ou impossibilité d'identifier le trouble à ce stade de la recherche. Lorsqu'un déficit du système immunitaire est identifié, certains patients peuvent ultérieurement se retrouver dans le groupe des IDP. Ainsi, la frontière entre les concepts d'immunodéficience primaire et secondaire (en particulier dans la forme spontanée) peut être conditionnelle. Les facteurs héréditaires et les effets induits jouent un rôle déterminant dans la détermination de la forme d'immunodéficience. D'autre part, très souvent, les patients ne bénéficient pas d'études suffisamment approfondies, ce qui rend la cause de l'immunodéficience indéterminée. Plus l'examen des patients atteints d'immunodéficience secondaire spontanée est approfondi, plus ce groupe se rétrécit.
En termes quantitatifs, l'immunodéficience secondaire induite domine. Il est nécessaire d'éviter l'erreur principale dans la prise en charge des patients et les soins de santé: l'évolution grave et lente d'une maladie infectieuse et inflammatoire n'est pas due à un défaut du système immunitaire, mais à une corrélation erronée entre causes et effets, ainsi qu'à une erreur de diagnostic.
Étant donné l'état actuel des connaissances en immunologie clinique, il n'est pas toujours possible de déterminer les marqueurs biologiques des états d'immunodéficience. Le diagnostic d'« immunodéficience secondaire » est donc avant tout clinique. Le principal signe clinique d'une immunodéficience secondaire est l'évolution atypique de processus inflammatoires et infectieux aigus et chroniques, résistants à un traitement adéquat.
Quand peut-on suspecter un déficit immunitaire secondaire?
Les maladies les plus courantes qui peuvent accompagner les formes congénitales et acquises d’immunodéficience et qui nécessitent un examen immunologique obligatoire:
- infections généralisées: septicémie, méningite purulente, etc.
- bronchite chronique avec rechutes fréquentes et antécédents de pneumonie et association à des maladies ORL (sinusite purulente, otite, lymphadénite), résistante au traitement standard;
- pneumonie et bronchopleuropneumonie fréquemment récurrentes;
- bronchectasie;
- infections bactériennes chroniques de la peau et du tissu sous-cutané (pyoderma, furonculose, abcès, phlegmon, granulomes septiques, paraproctite récidivante chez l'adulte);
- infections fongiques chroniques de la peau et des muqueuses, candidoses, maladies parasitaires;
- stomatite aphteuse récurrente associée à une incidence accrue d’infections virales respiratoires aiguës;
- infection récurrente par le virus de l'herpès de diverses localisations;
- gastro-entéropathie avec diarrhée chronique d'étiologie inconnue, dysbactériose intestinale;
- lymphadénopathie, lymphadénite récurrente;
- température subfébrile prolongée, LNG.
Ces maladies peuvent survenir dans le contexte de pathologies somatiques existantes, dont l'évolution et le traitement prédisposent à la formation d'une immunodéficience avec une diminution de la tolérance aux infections (diabète sucré; maladies auto-immunes, oncologiques, etc.).
Comment se manifeste l’immunodéficience secondaire?
Les symptômes du déficit immunitaire secondaire sont non spécifiques et multiformes. La CIM-10 ne prévoit pas de diagnostic de déficit immunitaire secondaire, sauf en cas d'immunodéficience acquise (SIDA). Dans cette classification, les adultes ne sont pas diagnostiqués de DIP (contrairement à la classification pédiatrique). Par conséquent, la question de la coordination du diagnostic de déficit immunitaire secondaire avec la CIM-10 se pose légitimement. Certains proposent la solution suivante: lorsque les modifications du statut immunitaire sont irréversibles et conduisent à la formation d'une maladie, le diagnostic doit être basé sur le déficit immunologique identifié, car cela implique un ensemble de mesures thérapeutiques permanentes, par exemple, le SIDA; l'AO avec atteinte du système du complément; le diagnostic principal est une tumeur cérébrale; l'hypogammaglobulinémie après radiothérapie et chimiothérapie; la sinusite purulente chronique.
Lorsque les modifications du statut immunitaire sont réversibles et accompagnent des maladies somatiques ou peuvent résulter de traitements pharmacologiques ou autres, les anomalies biologiques transitoires constatées ne sont pas prises en compte dans le diagnostic. Le diagnostic repose sur la maladie sous-jacente et la pathologie concomitante, par exemple: le diagnostic principal est un diabète sucré de type II, une évolution sévère, une variante insulino-dépendante, une phase de décompensation; les complications sont une furonculose chronique récurrente, une exacerbation.
Comment reconnaître un déficit immunitaire secondaire?
Des tests immunologiques de dépistage (niveau 1) sont disponibles, appropriés et peuvent être réalisés dans de nombreux hôpitaux et cliniques disposant d'un laboratoire de diagnostic clinique. Ces tests comprennent l'étude des indicateurs suivants:
- nombre absolu de leucocytes, de neutrophiles, de lymphocytes et de plaquettes;
- niveaux de protéines et de fraction Y;
- taux d'immunoglobulines sériques IgG, IgA, IgM, IgE;
- activité hémolytique du complément;
- hypersensibilité retardée (tests cutanés).
Une analyse approfondie ne peut être effectuée que dans un établissement médical et préventif spécialisé doté d'un laboratoire d'immunologie clinique moderne.
L'étude du statut immunitaire en cas d'immunodéficience doit inclure l'étude de la quantité et de l'activité fonctionnelle des principaux composants du système immunitaire jouant un rôle majeur dans la défense anti-infectieuse de l'organisme. Il s'agit notamment du système phagocytaire, du système du complément et des sous-populations de lymphocytes T et B. Les méthodes utilisées pour évaluer le fonctionnement du système immunitaire ont été divisées conditionnellement par RV Petrov et al. en 1984 en tests de premier et deuxième niveaux. Les tests de premier niveau sont indicatifs; ils visent à identifier les anomalies importantes du système immunitaire responsables d'une diminution de la défense anti-infectieuse.
Les tests de niveau 2 sont des examens complémentaires visant à identifier un trouble spécifique du système immunitaire. Ils complètent considérablement les informations sur le fonctionnement du système immunitaire concerné.
Tests de niveau 1 pour évaluer le lien phagocytaire:
- détermination du nombre absolu de neutrophiles et de monocytes;
- détermination de l'intensité de la neutralisation des micro-organismes par les neutrophiles et les monocytes;
- détermination de la teneur en formes d'oxygène actif.
Tests de niveau 1 pour évaluer le système immunitaire B:
- détermination du taux d'IgG, IgA, IgM et IgE dans le sérum sanguin;
- détermination du pourcentage et du nombre absolu de lymphocytes B (CD19, CD20) dans le sang périphérique.
La détermination du taux d'immunoglobulines est une méthode importante et fiable pour évaluer le fonctionnement du système immunitaire B. Elle peut être considérée comme la principale méthode de diagnostic de toutes les formes d'immunodéficiences associées à une altération de la synthèse des anticorps. Ce type de trouble est le plus fréquent. Il peut accompagner de nombreuses maladies somatiques et affections aiguës associées à un catabolisme accru ou à une altération de la synthèse des immunoglobulines.
Tests de niveau 1 pour évaluer le système T de l'immunité:
- détermination du nombre total de lymphocytes;
- détermination du pourcentage et du nombre absolu de lymphocytes T matures (CD3 et leurs deux principales sous-populations: helpers (CD4) et killers (CD8));
- détection de la réponse proliférative des lymphocytes T aux mitogènes (phytohémagglutinane et concanavaline A).
Les tests de niveau 2 visent à une étude approfondie de l'état immunitaire, à l'identification des causes des troubles et des défauts du système immunitaire aux niveaux cellulaire, moléculaire et moléculaire-génétique.
Tests de niveau 2 pour l'évaluation de la phagocytose:
- détermination de l'intensité de la chimiotaxie des phagocytes:
- établissement de l'expression des molécules d'adhésion (CD11a, CD11b, CD11c, CD18) sur la membrane superficielle des neutrophiles;
- détermination de l'achèvement de la phagocytose par ensemencement ou cytométrie de flux.
Tests de niveau 2 pour évaluer le système immunitaire B:
- détermination de la teneur en sous-classes d'immunoglobulines (notamment IgG):
- détermination de la teneur en IgA sécrétoires;
- établissement du rapport des chaînes kappa et lambda:
- détermination de la teneur en anticorps spécifiques dirigés contre des antigènes protéiques et polysaccharidiques;
- Détermination de la capacité des lymphocytes à répondre aux mitogènes avec prolifération: cellules B - staphylocoque, lipopolysaccharide d'entérobactéries; cellules T et B - mitogène du phytolaque.
La détermination des sous-classes d'IgG présente une certaine valeur diagnostique, car un déficit en sous-classes d'immunoglobulines peut survenir avec un taux d'IgG normal. Dans certains cas, ces personnes présentent un déficit immunitaire secondaire se traduisant par une diminution de la protection anti-infectieuse des IgG2 – une sous-classe d'IgG contenant principalement des anticorps dirigés contre les polysaccharides de bactéries encapsulées (Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae). La détermination du taux d'anticorps dirigés contre les antigènes protéiques et polysaccharidiques bactériens fournit des informations importantes sur l'état de l'immunité humorale, car le degré de protection de l'organisme contre une infection donnée dépend du taux global d'immunoglobulines et du nombre d'anticorps dirigés contre son agent pathogène. Par conséquent, l'absence d'anticorps IgG spécifiques d'une infection passée est toujours un signe pronostique favorable. L'étude de leurs propriétés fonctionnelles permet également d'obtenir des informations précieuses sur l'état de l'immunité humorale. Tout d'abord, cela inclut une propriété des anticorps, l'affinité, dont dépend en grande partie la force de l'interaction des anticorps avec l'antigène. La production d'anticorps de faible affinité peut entraîner une protection insuffisante contre l'infection.
Le système immunitaire B peut être évalué par le niveau et la qualité de l'activité fonctionnelle des immunoglobulines, car elles sont le principal produit final de ces cellules. Une telle approche reste difficile à mettre en œuvre pour le système immunitaire T, car le principal produit final de l'activation des lymphocytes T est les cytokines, et les systèmes permettant leur détermination sont encore peu disponibles dans le domaine de la santé. Néanmoins, l'évaluation de l'activité fonctionnelle du système immunitaire T est une tâche extrêmement importante, car cette activité peut être significativement réduite avec un nombre normal de lymphocytes T et le ratio de leurs sous-populations. Les méthodes d'évaluation de l'activité fonctionnelle des lymphocytes T sont assez complexes. La plus simple d'entre elles est la réaction de transformation blastique utilisant deux principaux mitogènes T: la phytohémagglutinine et la concanavaline A. La réponse proliférative des lymphocytes T aux mitogènes est réduite dans presque tous les processus inflammatoires infectieux chroniques, les maladies malignes (en particulier du système hématopoïétique); dans tous les types de traitement immunosuppresseur, le SIDA et tous les types d'immunodéficience primaire des lymphocytes T.
La détermination de la production de cytokines par les lymphocytes et les macrophages demeure essentielle. Le dosage de cytokines telles que le TNF, l'IL-1 et l'IF-γ joue un rôle important dans l'étiopathogénie de divers processus inflammatoires aigus et chroniques, non seulement de nature infectieuse, mais aussi auto-immune. Leur production accrue est la principale cause de choc septique.
Il convient de noter que les cytokines sont des médiateurs des interactions cellulaires; elles déterminent uniquement la gravité de l’inflammation infectieuse et non infectieuse.
L'étude de l'expression des molécules d'activation et d'adhésion à la surface des lymphocytes fournit des informations importantes sur leur degré d'activation. Une altération de l'expression du récepteur de l'IL-2 est observée dans de nombreuses hémopathies malignes (leucémie à cellules T, leucémie à tricholeucocytes, lymphogranulomatose, etc.) et maladies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux disséminé, anémie aplasique, sclérodermie, maladie de Crohn, sarcoïdose, diabète sucré, etc.).
Selon les recommandations des spécialistes étrangers et celles des experts de l'OMS, les tests cutanés sont utilisés comme tests de dépistage ou tests de premier niveau pour le diagnostic des déficits immunitaires des lymphocytes T. Les tests cutanés sont les plus simples et les plus informatifs pour évaluer l'activité fonctionnelle des lymphocytes T. Des tests cutanés positifs à certains antigènes microbiens, avec une forte probabilité, permettent d'exclure la présence d'un déficit immunitaire des lymphocytes T chez le patient. Plusieurs entreprises occidentales ont développé des systèmes standardisés de tests cutanés incluant les principaux antigènes permettant de déterminer l'immunité des lymphocytes T. Cela permet d'évaluer l'activité fonctionnelle du système immunitaire T dans des conditions strictement contrôlées. Malheureusement, les systèmes de tests cutanés pour évaluer l'immunité du système immunitaire T sont absents en Russie et, par conséquent, ils ne sont pratiquement pas utilisés.
Schéma d'examen des différents maillons du système immunitaire
Immunité humorale:
- principales classes et sous-classes d'immunoglobulines: IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) IgA, IgM, IgE; IgA, IgM, IgG, IgE spécifiques de l'antigène; complexes immuns circulants;
- système du complément: inhibiteur de C3, C4, C5, C1;
- affinité des anticorps.
Phagocytose:
- index phagocytaire des neutrophiles et des monocytes;
- indice opsonique;
- activité bactéricide et fongicide intracellulaire des phagocytes;
- formation d'espèces réactives de l'oxygène dans la chimioluminescence spontanée et induite dépendante du luminol et de la lucentinine.
Immunophénotypage:
- CD19, CD3, CD3 CD4, CD3 CD8, CD3-HLA-DR, CD3-HLA-DR;
- CD3 CD16/56. CD4 CD25.
Activité fonctionnelle des lymphocytes:
- Réponse proliférative aux mitogènes T et B;
- Activité cytotoxique des cellules RL;
- Détermination du profil des cytokines (IL I, IL-2, IL-4, IL-6, etc.).
Profil de l'interféron:
- détermination de l'IF-a dans le sérum sanguin et dans le surnageant des suspensions de leucocytes activées par le virus de la maladie de Newcastle;
- détermination de l'IF-γ dans le sérum sanguin et dans le surnageant des suspensions de lymphocytes activés par la phytohémagglutinine.
En fonction de la nature des modifications identifiées lors de l’examen immunologique, les patients présentant un déficit immunitaire secondaire peuvent être divisés en trois groupes:
- patients présentant des signes cliniques de déficit immunitaire et des modifications identifiées des paramètres du statut immunitaire;
- patients présentant uniquement des signes cliniques de déficit immunitaire et des indicateurs d’état immunitaire normaux;
- patients ne présentant aucune manifestation clinique de déficit immunitaire, mais présentant des modifications identifiées des paramètres du statut immunitaire.
Pour les groupes 1 et 2, il est nécessaire de sélectionner un traitement immunotrope. Le groupe 3 nécessite une observation et un examen de contrôle par un immunologiste afin d'exclure tout artéfact de recherche, ainsi qu'un examen clinique approfondi pour clarifier les causes ayant conduit aux modifications immunologiques.
Traitement de l'immunodéficience secondaire
Le principal outil de traitement des patients atteints d'immunodéficience secondaire est le traitement immunotrope. Il comporte trois axes:
- immunisation active (vaccination);
- thérapie de remplacement (préparations sanguines: plasma, immunoglobulines, masse leucocytaire, etc.);
- médicaments immunotropes (immunostimulants, facteurs de stimulation des colonies de granulocytes et de macrophages; immunomodulateurs d'origine exogène et endogène, chimiquement purs et synthétisés)
Le choix du traitement immunotrope dépend de la gravité du processus infectieux et inflammatoire et du défaut immunologique identifié.
Thérapie vaccinale
La vaccination est utilisée à des fins prophylactiques uniquement pendant la période de rémission des maladies infectieuses et somatiques. Chaque médicament utilisé a ses propres indications, contre-indications et schémas d'utilisation.
Traitement de remplacement de l'immunodéficience secondaire
Il peut être utilisé à n'importe quel stade du processus infectieux et inflammatoire. Les traitements de substitution sont les médicaments de choix en situation aiguë. Les immunoglobulines intraveineuses sont le plus souvent utilisées. Leurs principaux principes actifs sont des anticorps spécifiques, obtenus auprès d'un grand nombre de donneurs. Actuellement, les immunoglobulines intraveineuses sont utilisées pour prévenir les processus infectieux et traiter les maladies dont la pathogenèse présente des déficits de l'immunité humorale. Le traitement de substitution est utilisé pour compenser le déficit en anticorps dans un certain nombre de maladies aiguës et chroniques avec déficit immunitaire secondaire, accompagné d'une hypogammaglobulinémie, causée soit par un catabolisme accru des immunoglobulines, soit par un trouble de leur synthèse.
Une augmentation du catabolisme des immunoglobulines est observée dans le syndrome néphrotique, les entéropathies d'étiologies diverses, les brûlures, le jeûne, la paraprotéinémie, le sepsis et d'autres affections. Une perturbation de la synthèse des immunoglobulines survient dans les tumeurs primaires du tissu lymphoïde sous traitement par cytostatiques, glucocorticoïdes et radiothérapie, ainsi que dans les maladies accompagnées de toxicose (insuffisance rénale, thyrotoxicose, infections généralisées sévères d'étiologies diverses).
La fréquence d'administration et les doses d'immunoglobulines intraveineuses dépendent de la situation clinique, du taux initial d'IgG, de la gravité et de la prévalence du processus infectieux et inflammatoire. Les préparations d'immunoglobulines intraveineuses les plus utilisées contiennent uniquement des IgG: la gabriglobine (immunoglobuline humaine normale), l'octagam (immunoglobuline humaine normale) et l'intraglobine (immunoglobuline humaine normale). Les immunoglobulines intraveineuses contenant les trois classes d'immunoglobulines (IgA, IgM, IgG), similaires à la pentaglobine plasmatique (immunoglobuline humaine normale | IgG + IgA + IgM), sont incluses dans les normes de traitement des patients septiques. Les immunoglobulines présentant un titre élevé d'IgG dirigé contre des antigènes spécifiques, telles que la cytotec (immunoglobuline anti-cytomégalovirus) présentant un titre élevé d'anticorps dirigés contre l'infection à cytomégalovirus et la neohepatec (immunoglobuline contre l'hépatite B humaine) dirigée contre l'hépatite B, sont beaucoup moins utilisées. Il est nécessaire de rappeler que les préparations contenant des IgA (pentaglobine, plasma) sont contre-indiquées chez les patients présentant un déficit immunitaire sélectif de type A.
Traitement immunotrope de l'immunodéficience secondaire
Il ne fait aucun doute aujourd'hui que l'utilisation d'immunomodulateurs d'origines diverses dans le traitement complexe des processus infectieux et inflammatoires augmente l'efficacité du traitement antimicrobien. Les immunomodulateurs sont largement utilisés chez les patients présentant un déficit immunitaire secondaire.
Principes généraux d'utilisation des immunomodulateurs chez les patients présentant une protection anti-infectieuse insuffisante.
- Les immunomodulateurs sont prescrits en association avec un traitement étiotrope du processus infectieux. La monothérapie n'est autorisée qu'en rémission du processus infectieux.
- Le choix de l'immunomodulateur et le schéma de son utilisation sont déterminés en fonction de la gravité du processus infectieux-inflammatoire, de sa cause, du défaut immunitaire identifié, en tenant compte des maladies somatiques et des effets inductifs.
- Les principaux critères de prescription des médicaments immunomodulateurs sont les manifestations cliniques d’immunodéficience (présence d’un processus inflammatoire infectieux résistant à un traitement étiotrope adéquat).
- Les doses, les schémas thérapeutiques et la durée du traitement doivent être conformes aux instructions du médicament; l'ajustement des schémas thérapeutiques ne doit être effectué que par un immunologiste clinicien expérimenté.
- Si l'établissement médical et préventif concerné dispose de la base matérielle et technique appropriée, il est conseillé d'utiliser des immunomodulateurs dans le cadre d'une surveillance immunologique, qui doit être effectuée indépendamment des modifications initialement identifiées des paramètres immunologiques.
- La présence d'un paramètre immunitaire détecté lors d'une étude immunodiagnostique chez une personne en bonne santé ne peut justifier la prescription d'un traitement immunomodulateur. Ces patients doivent subir des examens complémentaires et être supervisés par un immunologiste.
Bien que l'action des médicaments immunomodulateurs soit multidirectionnelle, chacun d'entre eux présente ses propres avantages. En cas de lésions des cellules du système monocytes-macrophages, on utilise le polyoxidonium (azoximère), le galavit (aminodihydrophtalazinedione sodique), le bronchomunal et le ribomunil. En cas de déficience du lien cellulaire de l'immunité, il est conseillé de prescrire le polyoxidonium (azoximère) et le taktivin (thymus).
Extrait), thymotène (alpha-glutamyl-tryptophane), thymaline (extrait de thymus), imunofan (arginyl-alpha-aspartyl-lysyl-valyl-tyrosyl-arginine). En cas d'altération de la synthèse d'anticorps par les lymphocytes B et d'altération de l'affinité des anticorps pour le déterminant antigénique commun, la galavit (aminodihydrophtalazinedione sodique) et le myélopide sont indiqués. Les modifications des indicateurs de statut interféron sont corrigées par des médicaments inducteurs d'interféron ou par un traitement substitutif par IF naturel ou recombinant.
La prudence est de mise lors de la prescription d'immunomodulateurs en phase aiguë d'un processus infectieux. Par exemple, les préparations d'origine microbienne sont déconseillées pendant cette période en raison du risque d'activation polyclonale des cellules du système immunitaire. Lors de l'utilisation de cytokines, il est important de garder à l'esprit que leurs indications sont la leucopénie, la lymphopénie et une faible activation spontanée des neutrophiles; dans le cas contraire, elles peuvent provoquer une réaction inflammatoire systémique sévère, pouvant conduire à un choc septique. L'immunomodulateur le plus sûr dans ces cas est le polyoxidonium, qui, outre son effet immunomodulateur, possède des propriétés détoxifiantes, antioxydantes et chélatantes.
Immunostimulants
Les préparations de facteurs de stimulation des colonies de granulocytes et de macrophages ne sont utilisées que dans les cas de leucopénie sévère et d'agranulocytose sous surveillance quotidienne des analyses sanguines cliniques.
Ainsi, en raison de la nature multifactorielle des facteurs étiologiques impliqués dans la formation d'une maladie telle que l'immunodéficience secondaire, le succès du traitement de ces patients dépend du professionnalisme de l'immunologiste, qui mettra correctement l'accent sur les relations de cause à effet, évaluera de manière adéquate les résultats de l'étude immunologique et sélectionnera un traitement immunotrope, qui réduira la durée d'hospitalisation, prolongera la rémission dans les processus infectieux et inflammatoires chroniques et, dans certains cas, sauvera la vie du patient.
Parmi les immunomodulateurs systémiques, l'utilisation d'inducteurs d'interféron mérite une attention particulière, notamment Lavomaks, comprimés pelliculés (principe actif: tiloron 0,125 g). Lavomaks induit la synthèse des trois types d'interférons par l'organe lui-même et active les mécanismes immunitaires cellulaires, qui, ensemble, interrompent la reproduction des virus et autres agents intracellulaires dans les cellules infectées, ou provoquent la mort et favorisent l'élimination du virus. La synthèse d'interféron dans le sang après administration de Lavomaks est déterminée 20 à 24 heures après la prise du médicament. Lavomaks, en tant qu'inducteur d'interféron, se distingue par sa capacité à induire une circulation sanguine prolongée de doses thérapeutiques d'IFN, qui préviennent l'infection des cellules non infectées et créent une barrière antivirale, inhibent la synthèse de protéines spécifiques du virus et la reproduction intracellulaire du VPH. De plus, l'induction d'IFN endogène peut être considérée comme un mécanisme physiologique de la genèse de l'IFN. Schéma posologique: 1 comprimé les deux premiers jours, puis 1 comprimé tous les deux jours. La dose du traitement est de 10 à 20 comprimés.
