Expert médical de l'article
Nouvelles publications
Fracture de la mâchoire supérieure
Dernière revue: 07.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.
Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.
Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.
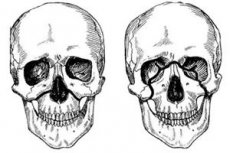
Une fracture du maxillaire suit généralement l'une des trois lignes de moindre résistance décrites par Le Fort: supérieure, moyenne et inférieure. On les appelle communément lignes de Le Fort (Le Fort, 1901).
- Le Fort I – la ligne inférieure, partant de la base de l'ouverture piriforme horizontalement et retournant au processus ptérygoïde du sphénoïde. Ce type de fracture a été décrit pour la première fois par Guérin, et Le Fort le mentionne également dans son ouvrage; la fracture le long de la ligne inférieure devrait donc être appelée fracture Guérin-Le Fort.
- Le Fort II - la ligne médiane, passe transversalement à travers les os nasaux, le plancher de l'orbite, la marge infraorbitaire, puis descend le long de la suture zygomaticomaxillaire et du processus ptérygoïde de l'os sphénoïde.
- Le Fort III est la ligne supérieure de moindre résistance, passant transversalement par la base des os nasaux, le plancher de l'orbite, son bord externe, l'arcade zygomatique et le processus ptérygoïde de l'os sphénoïde.
En cas de fracture de type Le Fort I, seule l'arcade dentaire du maxillaire supérieur et le processus palatin sont mobiles; en cas de fracture de type Le Fort II, c'est l'ensemble du maxillaire supérieur et du nez qui sont mobiles; et en cas de fracture de type Le Fort III, c'est l'ensemble du maxillaire supérieur, le nez et les os zygomatiques. La mobilité indiquée peut être unilatérale ou bilatérale. En cas de fracture unilatérale du maxillaire supérieur, la mobilité du fragment est moins prononcée qu'en cas de fracture bilatérale.
Les fractures de la mâchoire supérieure, notamment le long de la ligne Le Fort III, s'accompagnent souvent de lésions de la base du crâne, de commotions cérébrales, d'ecchymoses ou de compressions cérébrales. Les lésions simultanées de la mâchoire et du cerveau résultent souvent de traumatismes graves: choc au visage avec un objet lourd, compression, chute de grande hauteur. L'état des patients présentant une fracture de la mâchoire supérieure est considérablement aggravé par les lésions des parois des sinus paranasaux, de la partie nasale du pharynx, de l'oreille moyenne, des méninges, de la fosse crânienne antérieure avec les os nasaux enfoncés, et des parois du sinus frontal. Suite à une fracture des parois de ce sinus ou du labyrinthe ethmoïdal, un emphysème du tissu sous-cutané de l'orbite, du front et des joues peut survenir, se manifestant par un symptôme caractéristique de crépitation. Un écrasement ou une rupture des tissus mous du visage est souvent observé.
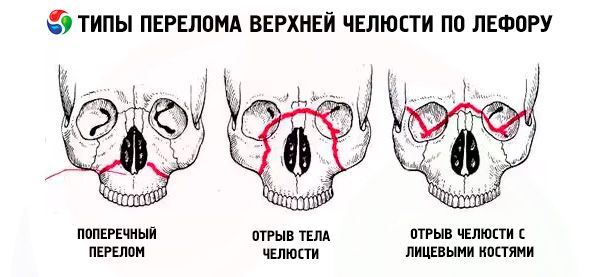
 [ 1 ]
[ 1 ]
Symptômes d'une fracture de la mâchoire supérieure
Les fractures de la base du crâne s'accompagnent de symptômes de « lunettes sanglantes », de suffusion sous-conjonctivale (imprégnation de sang), d'hématome rétroauriculaire (en cas de fracture de la fosse crânienne moyenne), de saignements et surtout de liquorrhée oto-rhino-laryngologique, de dysfonctionnement des nerfs crâniens et de troubles neurologiques généraux. Le plus souvent, les branches des nerfs trijumeau, facial et oculomoteur sont endommagées (perte de sensibilité, troubles de l'expression faciale, douleur lors des mouvements oculaires vers le haut ou vers les côtés, etc.).
Le taux de développement des hématomes est d'une grande importance diagnostique: rapide - indique son origine locale, et lent - sur 1 à 2 jours - est typique d'un saignement indirect et profond, c'est-à-dire d'une fracture de la base du crâne.
Le diagnostic des fractures de la mâchoire supérieure, par rapport aux blessures de la mâchoire inférieure, est une tâche plus complexe, car elles s'accompagnent souvent d'un gonflement rapidement croissant des tissus mous (paupières, joues) et d'hémorragies intra-tissulaires.
Les symptômes les plus typiques d’une fracture de la mâchoire supérieure:
- allongement ou aplatissement de la partie médiane du visage en raison du déplacement de la mâchoire déchirée vers le bas ou vers l'intérieur (vers l'arrière);
- douleur en essayant de fermer les dents;
- malocclusion;
- saignement du nez et de la bouche.
Ce dernier est particulièrement prononcé dans les fractures de la ligne Le Fort III. De plus, les fractures de la mâchoire supérieure sont souvent impactées, ce qui rend difficile la détection du principal symptôme d'une fracture osseuse: le déplacement des fragments et leur mobilité pathologique. Dans de tels cas, le diagnostic peut être facilité par l'aplatissement du tiers moyen du visage, la malocclusion et le symptôme en escalier, révélés par la palpation des bords des orbites, des arcades zygomatiques et des crêtes zygomato-alvéolaires (zone de jonction entre le processus zygomatique de la mâchoire supérieure et le processus maxillaire de l'os zygomatique) et causés par une atteinte à l'intégrité de ces formations osseuses.
Pour augmenter la précision du diagnostic des fractures de la mâchoire supérieure, il faut prendre en compte la douleur lors de la palpation des points suivants, correspondant aux zones d'extensibilité et de compression accrues des os:
- nasal supérieur - à la base de la racine du nez;
- nasale inférieure - à la base de la cloison nasale;
- supraorbitaire - le long du bord supérieur de l'orbite oculaire;
- extraorbitaire - au bord extérieur de l'orbite oculaire;
- infraorbitaire - le long du bord inférieur de l'orbite oculaire;
- zygomatique;
- arqué - sur l'arcade zygomatique;
- tubéral - sur le tubercule de la mâchoire supérieure;
- zygomatique-alvéolaire - au-dessus de la zone de la 7e dent supérieure;
- canin;
- palatin (les points sont palpés du côté de la cavité buccale).
Les symptômes de mobilité des fragments de la mâchoire supérieure et de « palais flottant » peuvent être identifiés comme suit: le médecin saisit le groupe dentaire antérieur et le palais avec les doigts de la main droite, puis pose la main gauche sur les joues de l'extérieur; il effectue ensuite de légers mouvements de bascule d'avant en arrière. En cas de fractures impactées, la mobilité du fragment ne peut être déterminée de cette manière. Dans ce cas, il est nécessaire de palper les apophyses ptérygoïdes des os sphénoïdes; le patient ressent alors généralement une douleur, notamment en cas de fractures le long des lignes de Le Fort II et III, parfois accompagnée de plusieurs des symptômes mentionnés ci-dessus, de fracture de la base du crâne, du labyrinthe ethmoïdal, des os nasaux, des parois inférieures des orbites et des os zygomatiques.
Chez les patients présentant des lésions de la mâchoire supérieure et de l'os frontal, des fractures des parois des sinus maxillaires, de la mâchoire inférieure et des os zygomatiques, du labyrinthe ethmoïdal et de la cloison nasale sont possibles. Par conséquent, en cas de fractures combinées de la base du crâne, de la mâchoire supérieure, des os zygomatiques, de la cloison nasale et des os lacrymaux, un larmoiement intense et une liquorrhée nasale et auriculaire peuvent survenir.
L'association de fractures des maxillaires supérieures et de lésions traumatiques d'autres parties du corps se manifeste cliniquement dans la plupart des cas par un syndrome particulièrement sévère d'aggravation mutuelle et de chevauchement. Les patients présentant une telle association doivent être classés comme des victimes présentant un risque accru de complications septiques générales, non seulement au niveau maxillo-facial, mais aussi au niveau d'autres foyers de lésions à distance (résultant de métastases infectieuses), y compris les foyers fermés sans lien anatomique direct avec les maxillaires, la cavité buccale ou le visage.
De nombreux patients souffrant de fractures de la mâchoire supérieure souffrent d'un certain degré de névrite traumatique des branches infra-orbitaires du nerf trijumeau; certaines victimes souffrent d'une diminution prolongée de l'excitabilité électrique des dents du côté de la blessure.
La détection par palpation d'irrégularités dans les bords de l'orbite (saillies en forme de marches), des crêtes zygomatiques-alvéolaires, des sutures nasogéniennes, ainsi que des modifications des bords de la mâchoire supérieure lors de la radiographie en projections axiales et frontales, est d'une certaine importance diagnostique.
Conséquences des fractures de la mâchoire
L'évolution des fractures de la mâchoire dépend de nombreux facteurs: l'âge et l'état général de la victime avant la blessure, la présence d'un syndrome d'aggravation mutuelle, les conditions environnementales de la zone de résidence; en particulier, la présence d'un déséquilibre en éléments minéraux dans l'eau et l'alimentation (GP Ruzin, 1995). Ainsi, selon GP Ruzin, chez les habitants de différentes zones de la région d'Ivano-Frankivsk, l'évolution des fractures et la nature des processus métaboliques étudiés sont quasiment identiques et peuvent être considérés comme optimaux, tandis que dans la région de l'Amour, le processus de régénération osseuse et les réactions métaboliques sont plus lents. La fréquence et la nature des complications dépendent de la période d'adaptation de l'individu à ce domaine. Les indicateurs qu'il a utilisés: l'indice de réponse inflammatoire (IRI), l'indice métabolique (IM) et l'indice de régénération (IR) permettent d'analyser l'ensemble des variations des indicateurs étudiés, même lorsque leurs variations ne dépassent pas les normes physiologiques. Par conséquent, l'utilisation des indices IVR, MI et RI permet de prédire l'évolution d'une fracture et le développement d'une complication inflammatoire-infectieuse, d'élaborer un plan de traitement pour le patient afin d'optimiser les processus métaboliques, de prévenir les complications et de surveiller la qualité du traitement en tenant compte des caractéristiques du patient et des conditions externes. Par exemple, pour la région d'Ivano-Frankivsk, les valeurs critiques des indices sont: IVR – 0,650, MI – 0,400, RI – 0,400. Si les valeurs sont inférieures, un traitement correctif est nécessaire. L'optimisation métabolique n'est pas nécessaire si IVR > 0,6755, MI > 0,528, RI > 0,550. L'auteur a établi que, dans différentes régions, les valeurs des indices peuvent varier en fonction des conditions médico-géographiques et biogéochimiques à prendre en compte lors de leur analyse. Ainsi, dans la région de l'Amour, ces valeurs sont inférieures à celles d'Ivano-Frankivsk. C'est pourquoi il est conseillé de procéder à une évaluation de l'IVR, de l'IM et de l'IR en conjonction avec un examen clinique et radiologique du patient dans les 2 à 4 premiers jours après la blessure - pour identifier le niveau initial de potentiel régénératif et prescrire la thérapie corrective nécessaire, le 10e-12e jour - pour clarifier le traitement en cours, le 20e-22e jour - pour analyser les résultats du traitement et prédire les caractéristiques de la rééducation.
Selon le médecin généraliste Ruzin, dans les régions présentant des états d'hypotension et d'inconfort, ainsi qu'un déséquilibre des composants minéraux et de la composition en acides aminés des protéines pendant la période d'adaptation, il est nécessaire d'inclure des anabolisants et des adaptogènes dans le traitement. Parmi tous les facteurs physiques qu'il a utilisés, le rayonnement laser a eu l'effet positif le plus marqué.
Sur la base de ses recherches, l’auteur résume les recommandations pratiques comme suit:
- Il est conseillé d'utiliser des tests qui caractérisent les conditions du métabolisme et du processus réparateur: indice de réponse inflammatoire (IRI), indice métabolique (IM), indice de régénération (IR).
- Si l'IVR est inférieur à 0,675, il est nécessaire d'utiliser des antibiotiques ostéotropes; si l'IVR est supérieur à 0,675, avec une immobilisation rapide et adéquate, l'antibiothérapie n'est pas indiquée.
- Si les valeurs de MI et de RI sont inférieures à 0,400, un traitement est nécessaire, comprenant un complexe de médicaments et d’agents qui stimulent le métabolisme des protéines et des minéraux.
- À de faibles valeurs d'IVR, l'utilisation de procédures thermiques locales (UHF) est contre-indiquée jusqu'à ce que le foyer inflammatoire soit résolu ou drainé.
- Lors du traitement des patients souffrant de fractures de la mâchoire inférieure dans des conditions médicales et géographiques défavorables, notamment pendant la période d'adaptation, des adaptogènes, des anabolisants et des antioxydants doivent être prescrits.
- Afin de résoudre rapidement l'infiltrat et de réduire la durée de la douleur, il est conseillé d'utiliser une irradiation laser dans les 5 à 7 premiers jours après la blessure.
- Pour optimiser le traitement des patients présentant une fracture de la mâchoire inférieure et réduire la durée d'hospitalisation, il est nécessaire d'organiser des salles de rééducation et d'assurer la continuité à toutes les étapes du traitement.
Grâce à une prise en charge préhospitalière, médicale et spécialisée rapide, l'évolution des fractures de la mâchoire chez l'adulte est favorable. Par exemple, V.F. Chistyakova (1980), utilisant un complexe d'antioxydants pour le traitement des fractures non compliquées de la mâchoire inférieure, a pu réduire la durée d'hospitalisation des patients de 7,3 jours-lits, et V.V. Lysenko (1993), traitant des fractures ouvertes, c'est-à-dire manifestement infectées par la microflore buccale, a réduit de 3,87 fois le pourcentage d'ostéomyélites traumatiques grâce à l'utilisation d'un aérosol intrabuccal de mousse de nitazole, réduisant également la durée d'utilisation des antibiotiques. Selon KS Malikov (1983), en comparant l'image radiographique du processus de régénération réparatrice de la mâchoire inférieure avec les indices autoradiographiques, un schéma spécifique du métabolisme minéral osseux a été établi: une augmentation de l'intensité de l'inclusion des isotopes radioactifs 32 P et 45 Ca dans le régénérat osseux de la mâchoire inférieure endommagée s'accompagne de l'apparition de zones radiographiques de calcification dans les sections terminales des fragments; la dynamique de l'absorption des radiopharmaceutiques se présente sous la forme de deux phases de concentration maximale des composés marqués 32 P et 45 Ca dans la zone lésée. À mesure que les fragments osseux cicatrisent lors des fractures de la mâchoire inférieure, le degré d'intensité de l'inclusion des isotopes 32 P, 45 Ca dans la zone lésée augmente. La concentration maximale de composés radioactifs ostéotropes dans les sections terminales des fragments est observée le 25e jour après la blessure de la mâchoire. L'accumulation de macro- et microéléments dans les sections terminales des fragments de la mâchoire inférieure a un caractère phasique. La première augmentation de la concentration minérale est observée entre le 10e et le 25e jour, la seconde entre le 40e et le 60e jour. Aux stades ultérieurs de la régénération réparatrice (120 jours), le métabolisme minéral dans la zone de fracture commence à se rapprocher progressivement de la normale et, au 360e jour, il est complètement normalisé, ce qui correspond au processus de réorganisation finale du cal osseux reliant les fragments de la mâchoire inférieure. L'auteur a constaté qu'un alignement anatomique correct et opportun des fragments et leur fixation chirurgicale fiable (par exemple, par suture osseuse) conduisent à une fusion osseuse précoce (25 jours) des fragments de la mâchoire inférieure et à la restauration (après 4 mois) de la structure normale du tissu osseux néoformé. Son étude par des méthodes de recherche biochimique et spectrale, en comparaison avec des données morphologiques et autoradiographiques, a montré que le degré de saturation des microstructures du cal en minéraux augmente progressivement avec la maturité du tissu osseux.
En cas d'utilisation intempestive d'un traitement complexe, les complications inflammatoires mentionnées ci-dessus et d'autres (sinusite, arthrite, granulome migrant, etc.) peuvent survenir, de fausses articulations peuvent se former, une défiguration esthétique du visage peut survenir, des troubles de la mastication et de la parole peuvent survenir et d'autres maladies non inflammatoires peuvent se développer qui nécessitent un traitement complexe et à long terme.
Dans les cas de fractures multiples de la mâchoire chez les personnes âgées et séniles, on observe souvent un retard de fusion, une pseudarthrose, une ostéomyélite, etc.
Dans certains cas, le traitement des complications post-traumatiques nécessite le recours à des structures orthopédiques complexes en fonction de la nature des troubles fonctionnels et anatomo-esthétiques, ainsi que des chirurgies reconstructives (ostéoplastie, refracture et ostéosynthèse, arthroplastie, etc.).
Diagnostic de fracture de la mâchoire supérieure
Le diagnostic radiographique des fractures maxillaires est souvent très difficile, car les radiographies en projection latérale montrent une superposition des deux os maxillaires. Par conséquent, les radiographies du maxillaire sont généralement prises en une seule projection (sagittale) (radiographie de synthèse), et il convient de prêter attention aux contours de la crête alvéolaire zygomatique, du bord infraorbitaire et des limites des sinus maxillaires. Leur violation (plis et zigzags) indique une fracture du maxillaire.
En cas de disjonction craniofaciale (fracture selon la ligne de Le Fort III), la radiographie du squelette facial en projection axiale est d'une grande aide pour établir le diagnostic. Ces dernières années, la tomographie et la radiographie panoramique ont également été utilisées avec succès.
Ces dernières années, des technologies diagnostiques (tomodensitométrie, imagerie par résonance magnétique) sont apparues, permettant le diagnostic simultané des lésions du crâne facial et crânien. Ainsi, Y. Raveh et al. (1992), T. Vellemin, I. Mario (1994) ont divisé les fractures des os frontaux, maxillaires, ethmoïdaux et orbitaires en deux types et un sous-type (1a). Le type I comprend les fractures fronto-naso-ethmoïdiennes et médio-orbitaires sans lésion des os de la base du crâne. Dans le sous-type 1a, s'ajoutent également des lésions de la paroi médiale du canal optique et une compression du nerf optique.
Le type II comprend les fractures fronto-naso-ethmoïdiennes et médio-orbitaires impliquant la base du crâne. Dans ce cas, les parties internes et externes du crâne facial et crânien sont endommagées, avec déplacement intracrânien de la paroi postérieure du sinus frontal, de la partie antérieure de la base du crâne, de la paroi supérieure de l'orbite, des os temporaux et sphénoïdes, et de la selle turcique; on observe des ruptures de la dure-mère. Ce type de lésion se caractérise par une fuite de liquide céphalorachidien, une protrusion herniaire du tissu cérébral au niveau de la fracture, la formation d'un télécanthus bilatéral avec extension de la région interorbitaire, ainsi qu'une compression et une lésion du nerf optique.
Un tel diagnostic détaillé des traumatismes cranio-faciaux complexes permet, 10 à 20 jours après la blessure, de comparer simultanément les fragments osseux de la base du crâne et du visage, ce qui permet de réduire la durée d'hospitalisation des victimes et le nombre de complications.
Qu'est-ce qu'il faut examiner?
Comment examiner?
Qui contacter?
Assistance aux victimes de traumatismes maxillo-faciaux
Le traitement des patients souffrant de fractures de la mâchoire consiste à restaurer la forme et la fonction perdues le plus rapidement possible. La solution à ce problème comprend les principales étapes suivantes:
- alignement des fragments déplacés,
- les fixer dans la bonne position;
- stimulation de la régénération du tissu osseux dans la zone de fracture;
- prévention de divers types de complications (ostéomyélite, pseudarthrose, sinusite traumatique, phlegmon ou abcès périmaxillaire, etc.).
Les soins spécialisés pour les fractures de la mâchoire doivent être prodigués le plus tôt possible (dans les premières heures après la blessure), car le repositionnement et la fixation rapides des fragments offrent des conditions plus favorables à la régénération osseuse et à la guérison des tissus mous endommagés de la cavité buccale, et aident également à arrêter le saignement primaire et à prévenir le développement de complications inflammatoires.
L'organisation de l'assistance aux victimes de traumatisme maxillo-facial doit prévoir la continuité des mesures médicales tout au long du parcours de la victime, du lieu de l'incident jusqu'à l'établissement médical, avec évacuation obligatoire vers sa destination. L'étendue et la nature de l'assistance fournie peuvent varier en fonction de la situation sur le lieu de l'incident et de l'emplacement des centres et établissements médicaux.
Une distinction est faite entre:
- premiers secours, prodigués directement sur les lieux d'un incident, dans des postes médicaux, et effectués par les victimes (dans l'ordre d'auto-assistance ou d'entraide), un infirmier ou un instructeur médical;
- soins prémédicaux dispensés par un ambulancier ou une infirmière et visant à compléter les mesures de premiers secours;
- premiers soins médicaux, qui doivent être prodigués, si possible, dans les 4 heures suivant le moment de la blessure; ils sont effectués par des médecins non spécialistes (dans les hôpitaux de district ruraux, dans les centres médicaux et les stations d'ambulance);
- soins chirurgicaux qualifiés, qui doivent être prodigués dans des établissements médicaux au plus tard 12 à 18 heures après la blessure;
- Soins spécialisés devant être prodigués dans un établissement spécialisé dans la journée suivant la blessure. Les délais impartis pour la prestation des différents types de soins sont optimaux.
 [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]
[ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]
Premiers secours sur place
L'issue favorable du traitement des blessures maxillo-faciales dépend en grande partie de la qualité et de la rapidité des premiers secours. De sa bonne organisation dépend non seulement la santé, mais parfois aussi la vie de la victime, notamment en cas d'hémorragie ou d'asphyxie. L'une des principales caractéristiques des blessures maxillo-faciales est souvent l'inadéquation entre le type de victime et la gravité de la blessure. Il est nécessaire d'attirer l'attention de la population sur ce point en menant des actions d'éducation sanitaire (au sein du système Croix-Rouge, lors des formations à la protection civile).
Le service médical doit accorder une grande attention à la formation aux techniques de premiers secours, en particulier pour les travailleurs des secteurs où l’incidence des blessures est assez élevée (mines, agriculture, etc.).
Lors des premiers soins prodigués à une victime présentant une blessure au visage sur les lieux de l'accident, il est essentiel de la placer dans une position prévenant l'asphyxie, c'est-à-dire allongée sur le côté, la tête tournée vers la blessure ou face contre terre. Un pansement aseptique doit ensuite être appliqué sur la plaie. En cas de brûlure chimique du visage (acide ou base), il est nécessaire de laver immédiatement la surface brûlée à l'eau froide afin d'éliminer les résidus de substances ayant causé la brûlure.
Après que les premiers soins ont été prodigués sur les lieux de l'incident (poste médical), la victime est évacuée vers un poste de secours médical, où les premiers soins sont prodigués par du personnel médical de niveau intermédiaire.
De nombreux patients souffrant de lésions maxillo-faciales peuvent se rendre seuls dans les centres médicaux situés à proximité du lieu de l'accident (centres de soins d'usines, etc.). Les victimes incapables de se déplacer seules sont transportées vers des établissements médicaux dans le respect des règles de prévention de l'asphyxie et des hémorragies.
Les premiers soins en cas de blessures à la région maxillo-faciale peuvent être prodigués par des professionnels de la santé de niveau intermédiaire appelés sur les lieux de l’incident.
 [ 9 ]
[ 9 ]
PREMIERS SECOURS
Tout comme les secours d'urgence, les secours vitaux sont prodigués sur les lieux de l'accident, dans les postes médicaux, les centres de santé, les postes paramédicaux et paramédicaux-obstétricaux. Dans ce cas, les efforts doivent viser en priorité à stopper les saignements et à prévenir l'asphyxie et le choc.
Les professionnels de santé de niveau intermédiaire (technicien dentaire, ambulancier, sage-femme, infirmier) doivent connaître les bases du diagnostic des blessures au visage, les éléments de premiers secours et les spécificités du transport des patients.
La quantité de soins préhospitaliers dépend de la nature de la blessure, de l’état du patient, de l’environnement dans lequel ces soins sont prodigués et des qualifications du personnel médical.
Le personnel médical doit déterminer le moment, le lieu et les circonstances de la blessure; après avoir examiné la victime, établir un diagnostic préliminaire et mettre en œuvre un certain nombre de mesures thérapeutiques et préventives.
Combattre les saignements
Le riche réseau vasculaire de la région maxillo-faciale crée des conditions favorables au saignement lors de blessures faciales. Le saignement peut se produire non seulement vers l'extérieur ou dans la cavité buccale, mais aussi dans les profondeurs des tissus (saignement latent).
En cas de saignement provenant de petits vaisseaux, la plaie peut être tamponnée et un bandage compressif peut être appliqué (si cela n'entraîne pas de risque d'asphyxie ou de déplacement de fragments de mâchoire). Un bandage compressif peut être utilisé pour arrêter le saignement dans la plupart des blessures de la région maxillo-faciale. En cas de lésion des grosses branches de l'artère carotide externe (linguale, faciale, maxillaire, temporale superficielle), le saignement peut être arrêté temporairement en urgence par pression digitale.
Prévention de l'asphyxie et méthodes pour la combattre
Tout d'abord, il est nécessaire d'évaluer correctement l'état du patient, en prêtant attention à sa respiration et à sa position. Dans ce cas, une asphyxie peut être détectée, dont le mécanisme peut être différent:
- déplacement de la langue vers l'arrière (luxation);
- fermeture de la lumière de la trachée par des caillots sanguins (obstructive);
- compression de la trachée par un hématome ou un tissu œdémateux (sténose);
- fermeture de l'entrée du larynx par un lambeau pendant de tissu mou provenant du palais ou de la langue (valvulaire);
- aspiration de sang, de vomi, de terre, d'eau, etc. (aspiration).
Pour prévenir l'asphyxie, le patient doit être assis, légèrement penché en avant et la tête baissée; en cas de blessures multiples graves et de perte de connaissance, il doit être allongé sur le dos, la tête tournée vers la blessure ou sur le côté. Si la blessure le permet, le patient peut être allongé sur le ventre.
La cause la plus fréquente d'asphyxie est la rétraction de la langue, qui survient lorsque le corps de la mâchoire inférieure, en particulier le menton, est écrasé lors de doubles fractures mentonnières. Une méthode efficace pour lutter contre cette asphyxie (luxation) consiste à fixer la langue avec une ligature de soie ou à la percer avec une épingle à nourrice ou une épingle à cheveux. Pour prévenir l'asphyxie obstructive, il est nécessaire d'examiner attentivement la cavité buccale et d'éliminer les caillots sanguins, les corps étrangers, le mucus, les débris alimentaires ou les vomissures.
Mesures antichocs
Les mesures ci-dessus doivent principalement inclure l’arrêt rapide du saignement, l’élimination de l’asphyxie et la mise en œuvre d’une immobilisation du transport.
La lutte contre le choc lors de blessures de la région maxillo-faciale comprend toute une série de mesures réalisées en cas de choc résultant de blessures d'autres zones du corps.
Pour prévenir toute infection supplémentaire de la plaie, il est nécessaire d'appliquer un pansement de gaze aseptique (protecteur) (par exemple, en sachet individuel). Il est important de rappeler qu'en cas de fractures des os de la face, le pansement ne doit pas être trop serré pour éviter le déplacement des fragments, notamment en cas de fractures de la mâchoire inférieure.
Il est interdit aux professionnels de santé de niveau intermédiaire de suturer les plaies des tissus mous en cas de blessure au visage. En cas de plaies ouvertes de la région maxillo-faciale, y compris toutes les fractures de la mâchoire au niveau de l'arcade dentaire, il est obligatoire, à ce stade de l'assistance, d'administrer 3 000 AE de sérum antitétanique Bezredko.
Pour l'immobilisation du transport, des bandages de fixation sont appliqués - un bandage de gaze ordinaire, un bandage en forme d'écharpe, un bandage circulaire, un bandage rigide pour le menton ou un bandage de transport standard composé d'un bandage pour le menton et d'un bonnet de tête souple.
Si le médecin ne dispose pas de ces moyens standards, il peut utiliser une gaze ordinaire (bandage) de type bonnet d'Hippocrate en combinaison avec un bandage de gaze de type écharpe; cependant, dans les cas où le patient est transporté sur une longue distance vers un établissement spécialisé, il est plus approprié d'appliquer un bandage de type écharpe en plâtre.
Il est nécessaire de remplir clairement la demande d'orientation vers l'établissement médical, en indiquant tout ce qui a été fait au patient, et de s'assurer du bon mode de transport.
Si les antécédents médicaux du patient indiquent une perte de connaissance, l'examen, l'assistance et le transport doivent être effectués uniquement en position allongée.
L'équipement du poste de premiers secours doit comprendre tout le nécessaire pour prodiguer les premiers soins en cas de blessure au visage, y compris nourrir et étancher la soif du patient (un gobelet, etc.).
En cas d'afflux massif de victimes (suite à des accidents, des catastrophes, etc.), leur évacuation correcte et leur tri de transport (par un ambulancier ou une infirmière) sont très importants, c'est-à-dire établir l'ordre d'évacuation et déterminer la position des victimes pendant le transport.
 [ 10 ]
[ 10 ]
PREMIERS SECOURS
Les premiers soins médicaux sont dispensés par les médecins des hôpitaux régionaux, de district, de district rural, des centres de santé médicaux centraux, de district et de ville, etc.
La tâche principale dans ce cas est de fournir une assistance vitale: combattre les saignements, l'asphyxie et le choc, vérifier et, si nécessaire, corriger ou remplacer les bandages précédemment appliqués.
La lutte contre le saignement consiste à ligaturer les vaisseaux de la plaie ou à la tamponner hermétiquement. En cas de saignement important de la cavité buccale, impossible à arrêter par les moyens conventionnels, le médecin doit pratiquer en urgence une trachéotomie et tamponner hermétiquement la cavité buccale et le pharynx.
Si des signes d'asphyxie apparaissent, le traitement est déterminé en fonction de la cause. En cas d'asphyxie par luxation, la langue est suturée. Un examen approfondi de la cavité buccale et l'élimination des caillots sanguins et des corps étrangers permettent d'éliminer le risque d'asphyxie obstructive. Si, malgré les mesures indiquées, l'asphyxie persiste, une trachéotomie en urgence est indiquée.
Les mesures antichoc sont réalisées selon les règles générales de la chirurgie d'urgence.
Ensuite, en cas de fractures de la mâchoire, il est nécessaire d'appliquer un bandage de fixation pour effectuer une immobilisation de transport (temporaire) et donner au patient quelque chose à boire de la manière habituelle ou à l'aide d'un gobelet avec un tube en caoutchouc attaché au bec.
Méthodes de fixation temporaire des fragments de mâchoire
Actuellement, il existe les méthodes suivantes d’immobilisation temporaire (de transport) des fragments de mâchoire:
- mentonnières;
- pansement en forme d'écharpe ou bandage adhésif;
- ligature intermaxillaire avec fil métallique ou en plastique;
- ensemble standard et autres. par exemple, ligature continue en huit, ligature linguale-labiale, ligature Y. Galmosh, ligature continue en fil selon Stout, Ridson, Obwegeser, Elenk, décrite assez bien par Y. Galmosh (1975).
Le choix de la méthode d'immobilisation temporaire des fragments est déterminé par la localisation des fractures, leur nombre, l'état général de la victime et la présence de dents suffisamment stables pour fixer l'attelle ou le bandage.
En cas de fracture du processus alvéolaire de la mâchoire supérieure ou inférieure, après alignement des fragments, un bandage externe en forme d'écharpe de gaze est généralement utilisé, pressant la mâchoire inférieure contre la mâchoire supérieure.
Pour toutes les fractures du corps de la mâchoire supérieure, après réduction des fragments, une cuillère-attelle métallique de AA Limberg est placée sur la mâchoire supérieure ou un bandage en forme d'écharpe est appliqué sur la mâchoire inférieure.
S'il n'y a pas de dents dans la mâchoire supérieure, une couche de stensiles ou de cire est placée sur les gencives.
Si le patient porte des prothèses dentaires, celles-ci servent d'espaceurs entre les arcades dentaires et un bandage en écharpe est appliqué. Dans la partie antérieure des prothèses dentaires en plastique, un trou doit être pratiqué à l'aide d'une fraise pour le bec d'une tasse, d'un drain ou d'une cuillère à café afin de permettre au patient de manger.
S'il y a des dents sur les deux mâchoires, en cas de fractures du corps de la mâchoire inférieure, les fragments sont renforcés avec un bandage de ligature intermaxillaire, une écharpe standard rigide ou une attelle en plâtre, qui est placée sur la mâchoire inférieure et fixée à la voûte crânienne.
En cas de fractures des apophyses condyliennes de la mâchoire inférieure, une ligature intra-orale ou un bandage rigide avec traction élastique est utilisé sur la calotte crânienne. En cas de fractures des apophyses condyliennes avec malocclusion (ouverte), la mâchoire inférieure est fixée par une entretoise entre les dernières grandes molaires antagonistes. En cas d'absence de dents sur la mâchoire inférieure endommagée, une prothèse dentaire peut être utilisée en association avec une écharpe rigide; en l'absence de prothèse, une écharpe rigide ou un bandage de gaze circulaire est utilisé.
En cas de fractures combinées des mâchoires supérieure et inférieure, les méthodes décrites ci-dessus de fixation séparée des fragments sont utilisées, par exemple l'attelle en cuillère de Rauer-Urbanskaya associée à une ligature des dents aux extrémités des fragments de la mâchoire inférieure. La ligature doit recouvrir deux dents de chaque fragment en forme de huit. En l'absence de risque d'hémorragie intra-orale, de rétraction de la langue, de vomissements, etc., une écharpe rigide peut être utilisée.
Lors des premiers secours, il est nécessaire de déterminer avec précision le moment et le mode de transport de la victime et, si possible, le but de l'évacuation. En cas de fractures faciales complexes et multiples, il est conseillé de réduire au minimum le nombre d'étapes d'évacuation et d'orienter les patients directement vers les services d'hospitalisation maxillo-faciale des hôpitaux républicains, régionaux et provinciaux (municipaux).
En cas de traumatisme combiné (notamment crânien), la question du transport du patient doit être étudiée avec soin et en concertation avec les spécialistes concernés. Dans ce cas, il est plus judicieux de faire appel à des spécialistes d'institutions régionales ou municipales pour une consultation à l'hôpital de district rural plutôt que d'y transporter les patients présentant une commotion cérébrale ou une contusion cérébrale.
S'il y a un dentiste dans l'hôpital local, les premiers soins pour des affections telles que les lésions non pénétrantes des tissus mous du visage qui ne nécessitent pas de chirurgie plastique primaire, les fractures dentaires, les fractures des processus alvéolaires des mâchoires supérieure et inférieure, les fractures simples non compliquées de la mâchoire inférieure sans déplacement, les fractures des os nasaux qui ne nécessitent pas de réduction, les luxations de la mâchoire inférieure qui ont été réduites avec succès, les brûlures du visage au premier et au deuxième degré, peuvent être complétées par des éléments de soins spécialisés.
Les patients présentant un traumatisme facial combiné, notamment en cas de commotion cérébrale, doivent être hospitalisés dans les hôpitaux de district. Lors de la décision de leur transport vers des services spécialisés dans les premières heures suivant la blessure, l'état général du patient, le type de transport, l'état des routes et la distance jusqu'au centre médical doivent être pris en compte. Le mode de transport le plus adapté pour ces patients peut être l'hélicoptère et, si les routes sont en bon état, les ambulances spécialisées.
Après avoir prodigué les premiers soins à l'hôpital de district, les patients présentant des fractures des maxillaires supérieures et inférieures, des polytraumatismes des os de la face compliqués par un traumatisme de toute localisation, des lésions pénétrantes et étendues des tissus mous nécessitant une chirurgie plastique primaire sont orientés vers les services spécialisés de l'hôpital de district, de la ville ou de la région. Le choix du lieu d'orientation du patient – à l'hôpital de district (si des dentistes y sont présents) ou au service maxillo-facial de l'hôpital le plus proche – dépend des conditions locales.
Soins chirurgicaux qualifiés
Des soins chirurgicaux qualifiés sont dispensés par des chirurgiens et des traumatologues dans les cliniques externes, les centres de traumatologie et les services de chirurgie ou de traumatologie des hôpitaux municipaux ou régionaux. Ils doivent être prodigués en priorité aux victimes qui en ont besoin pour des raisons vitales. Il s'agit notamment des patients présentant des signes de choc, d'hémorragie, de perte sanguine aiguë et d'asphyxie. Par exemple, si, en cas de saignement non stoppé des gros vaisseaux de la région maxillo-faciale ou de saignement survenu à des stades antérieurs, il n'est pas possible de ligaturer correctement le vaisseau saignant, l'artère carotide externe du côté correspondant est ligaturée. À ce stade de la prise en charge, toutes les victimes présentant des lésions de la région maxillo-faciale sont réparties en trois groupes.
Le premier groupe est celui des personnes qui ne nécessitent qu'une intervention chirurgicale (lésions des tissus mous sans véritables défauts, brûlures du premier et du deuxième degré, gelures du visage); pour elles, cette étape du traitement est la dernière.
Le deuxième groupe est celui des personnes nécessitant un traitement spécialisé (blessures des tissus mous nécessitant une chirurgie plastique; lésions des os du visage; brûlures du troisième et du quatrième degré et gelures du visage nécessitant un traitement chirurgical); après des soins chirurgicaux d'urgence, elles sont transportées vers des hôpitaux maxillo-faciaux.
Le troisième groupe comprend les victimes non transportables, ainsi que les personnes présentant des blessures combinées à d’autres parties du corps (en particulier des lésions cérébrales traumatiques), qui sont en tête en termes de gravité.
L'une des raisons du traitement chirurgical répété d'une plaie est l'absence d'examen radiographique préalable. En cas de suspicion de fracture des os de la face, cet examen est obligatoire. La capacité de régénération accrue des tissus faciaux permet une intervention chirurgicale avec une préservation maximale des tissus.
Lorsqu'il fournit des soins chirurgicaux qualifiés aux victimes du groupe II qui seront envoyées dans des établissements médicaux spécialisés (en l'absence de contre-indications au transport), le chirurgien doit:
- pour effectuer une anesthésie prolongée du site de fracture; ou mieux encore - une anesthésie prolongée de toute la moitié du visage, soit en utilisant la méthode de P. Yu. Stolyarenko (1987): par une injection à l'aiguille sous le rebord osseux sur le bord inférieur de l'arcade zygomatique à la jonction du processus temporal de l'os zygomatique avec le processus zygomatique de l'os temporal;
- injecter des antibiotiques dans la plaie, administrer des antibiotiques par voie interne;
- effectuer l’immobilisation de transport la plus simple, par exemple, appliquer un bandage de transport standard;
- s'assurer qu'il n'y a pas de saignement de la plaie, d'asphyxie ou de risque d'asphyxie pendant le transport;
- surveiller l’administration du sérum antitétanique;
- assurer un transport adéquat vers un établissement médical spécialisé accompagné de personnel médical (déterminer le type de transport, la position du patient);
- indiquer clairement dans les documents d’accompagnement tout ce qui a été fait au patient.
Dans les cas où il existe des contre-indications à l'envoi de la victime dans un autre établissement médical (Groupe III), une assistance qualifiée lui est fournie dans le service de chirurgie avec la participation de dentistes d'hôpitaux ou de cliniques, qui sont obligés
Les chirurgiens généralistes et les traumatologues doivent quant à eux connaître les bases de l'assistance en cas de traumatisme de la région maxillo-faciale, adhérer aux principes du traitement chirurgical des plaies faciales et connaître les méthodes de base d'immobilisation du transport des fractures.
Le traitement des victimes présentant des blessures combinées au visage et à d'autres zones dans un hôpital chirurgical (traumatologique) doit avoir lieu avec la participation d'un chirurgien maxillo-facial.
Si un hôpital de district dispose d'un service maxillo-facial ou d'un cabinet dentaire, le chef de service (dentiste) doit être responsable de l'état et de l'organisation des soins dentaires traumatologiques dans le district. Pour un enregistrement correct des traumatismes maxillo-faciaux, le dentiste doit établir des contacts avec les postes de feldsher et les hôpitaux de district. De plus, une analyse des résultats des traitements des patients souffrant de traumatismes faciaux et hospitalisés dans les établissements de district et régionaux doit être réalisée.
Les patients présentant des blessures faciales complexes et compliquées sont orientés vers le service maxillo-facial si une chirurgie plastique primaire des tissus mous est nécessaire et les dernières méthodes de traitement des fractures des os du visage, y compris la greffe osseuse primaire, sont utilisées.
Soins d'urgence spécialisés et traitement de suivi pour fracture maxillaire
Ce type de soins est dispensé dans les services maxillo-faciaux d'hospitalisation des hôpitaux républicains, régionaux, provinciaux et municipaux, dans les cliniques de dentisterie chirurgicale des universités de médecine, des instituts de recherche en dentisterie, dans les services maxillo-faciaux des instituts de recherche en traumatologie et en orthopédie.
Lors de l'admission des victimes au service d'admission de l'hôpital, il est conseillé d'identifier trois groupes de tri (selon V.I. Lukyanenko):
Le premier groupe comprend les personnes nécessitant des mesures urgentes, des soins qualifiés ou spécialisés au bloc opératoire: blessés au visage avec saignements persistants sous les bandages ou au niveau de la cavité buccale; asphyxiés ou présentant une respiration externe instable, après une trachéotomie avec tamponnement serré de la cavité buccale et du pharynx; inconscients. Ils sont d'abord conduits au bloc opératoire ou au bloc opératoire sur civière.
Le deuxième groupe comprend les blessés nécessitant une clarification du diagnostic et une détermination de la gravité principale de la blessure. Il s'agit notamment des blessés présentant des lésions combinées des mâchoires et du visage, des organes ORL, du crâne, des organes de la vision, etc.
Le troisième groupe comprend les victimes qui doivent être orientées vers le service en deuxième priorité. Ce groupe comprend toutes les victimes qui n'étaient pas incluses dans les deux premiers groupes.
Avant le début du traitement chirurgical, la victime doit subir un examen clinique et radiologique. Les données obtenues permettent de déterminer l'étendue de l'intervention.
Le traitement chirurgical, qu'il soit précoce, différé ou tardif, doit être immédiat et, si possible, complet, incluant une chirurgie plastique locale sur les tissus mous et même une greffe osseuse de la mâchoire inférieure.
Comme le soulignent AA Skager et TM Lurye (1982), la nature du blastème régénératif (ostéogénique, chondrogénique, fibreux, mixte) est déterminée par l'activité oxybiotique des tissus de la zone fracturée. De ce fait, tous les facteurs traumatiques et thérapeutiques influencent la vitesse et la qualité de l'ostéogenèse réparatrice, principalement par l'apport sanguin local. Suite à une blessure, des troubles circulatoires locaux (plaie et fracture), régionaux (zone maxillo-faciale) ou généraux (choc traumatique) surviennent systématiquement. Les troubles circulatoires locaux et régionaux sont généralement plus prolongés, notamment en l'absence d'immobilisation des fragments et en cas de complications inflammatoires. Par conséquent, la réaction réparatrice des tissus est altérée.
Avec un apport sanguin adéquat à la zone lésée et dans des conditions de stabilité des fragments, une formation osseuse primaire, dite angiogénique, se produit. Dans des conditions de régénération vasculaire moins favorables, créées principalement en l'absence de stabilité au niveau de la jonction des fragments, du tissu conjonctif ou cartilagineux se régénère, c'est-à-dire une « ostéosynthèse réparatrice », notamment en l'absence d'alignement correct et opportun des fragments. Ce processus de régénération réparatrice nécessite davantage de ressources tissulaires et de temps. Il peut aboutir à une fusion osseuse secondaire de la fracture, mais dans ce cas, du tissu conjonctif cicatriciel avec des foyers d'inflammation chronique persiste parfois longtemps, voire définitivement, dans la zone de fracture, ce qui peut se manifester cliniquement par une exacerbation d'une ostéomyélite traumatique.
Du point de vue de l'optimisation du complexe vasculaire-régénératif, le repositionnement fermé et la fixation des fragments osseux du visage présentent un avantage par rapport à l'ostéosynthèse ouverte avec une large exposition des extrémités des fragments.
Par conséquent, les principes suivants constituent la base du traitement moderne des fractures osseuses:
- comparaison parfaitement exacte de fragments;
- amener les fragments le long de toute la surface de fracture dans une position de contact étroit (rapprochement);
- fixation solide des fragments repositionnés et de leurs surfaces de contact, éliminant ou presque toute mobilité visible entre eux pendant toute la période nécessaire à la guérison complète de la fracture;
- maintien de la mobilité des articulations temporo-mandibulaires si le chirurgien dispose d'un dispositif de repositionnement extra-buccal et de fixation de fragments de la mâchoire inférieure.
Cela garantit une fusion plus rapide des fragments osseux. Le respect de ces principes assure la fusion primaire de la fracture et permet des périodes de traitement plus courtes pour les patients.
Mesures de traitement générales et locales supplémentaires pour les fractures récentes compliquées par une inflammation
La prise en charge spécialisée des lésions maxillo-faciales comprend un ensemble de mesures visant à prévenir les complications et à accélérer la régénération osseuse (traitements physiothérapeutiques, rééducation par l'exercice, vitaminothérapie, etc.). Tous les patients doivent également bénéficier d'une alimentation adaptée et de soins bucco-dentaires adaptés. Dans les grands services, il est recommandé de prévoir des services spécifiques pour les patients traumatisés.
Dans tous les types d’assistance, il est nécessaire de remplir la documentation médicale de manière claire et correcte.
Les mesures de prévention des complications comprennent l'administration de sérum antitétanique, l'administration locale d'antibiotiques en période préopératoire, l'assainissement de la cavité buccale et l'immobilisation temporaire des fragments (dans la mesure du possible). Il est important de rappeler qu'une infection des fractures de l'arcade dentaire peut survenir non seulement en cas de rupture de la muqueuse ou de lésion cutanée, mais aussi en présence de foyers inflammatoires périapicales situés dans la zone de fracture ou à proximité immédiate.
Si nécessaire, en plus de l'application d'un bandage de transport standard, une fixation intermaxillaire est réalisée à l'aide d'une ligature des dents.
La méthode d'anesthésie est choisie en fonction de la situation et du nombre de patients admis. Outre l'état général du patient, il est nécessaire de prendre en compte la localisation et la nature de la fracture, ainsi que le temps nécessaire à la fixation orthopédique ou à l'ostéosynthèse. Dans la plupart des cas de fractures du corps et d'une branche de la mâchoire (à l'exception des fractures hautes du processus condylien, accompagnées d'une luxation de la tête mandibulaire), une anesthésie locale par conduction et par infiltration peut être utilisée. L'anesthésie par conduction est préférablement réalisée au niveau de l'ouverture ovale (si nécessaire des deux côtés) afin de désactiver non seulement les branches sensitives, mais aussi motrices du nerf mandibulaire. Une anesthésie locale potentialisée est plus efficace. Un bloc de conduction prolongé et son association avec l'utilisation de calypsol à doses subnarcotiques sont également utilisés.
Pour décider du traitement d'une dent située directement dans l'espace fracturé, il est nécessaire de déterminer la relation entre ses racines et le plan de fracture. Trois positions sont possibles:
- la fracture s'étend sur toute la surface latérale de la racine de la dent - de son col jusqu'à l'ouverture de l'apex;
- l'apex de la dent est situé dans l'espace de fracture;
- L'espace de fracture passe obliquement par rapport à l'axe vertical de la dent, mais à l'extérieur de son alvéole, sans endommager le parodonte et les parois de l'alvéole dentaire.
La troisième position de la dent est la plus favorable en termes de pronostic de consolidation (sans développement de complication inflammatoire cliniquement perceptible), tandis que la première position est la moins favorable, car dans ce cas, il y a rupture de la muqueuse gingivale au niveau du collet de la dent et un espace de fracture béant, provoquant une infection inévitable des fragments de mâchoire par la microflore pathogène de la cavité buccale. Par conséquent, avant même l'immobilisation, il est nécessaire d'extraire les dents en première position, ainsi que les dents cassées, luxées, écrasées, détruites par des caries, compliquées par une pulpite ou une parodontite chronique. Après l'extraction dentaire, il est recommandé d'isoler la zone de fracture en tamponnant l'alvéole avec une gaze iodoformée. NM Gordiyuk et al. (1990) recommandent de tamponner les alvéoles avec de l'amnios conservé (dans une solution de chloramine à 2 %).
Il est essentiel de déterminer la nature de la microflore de la zone fracturée et d'évaluer sa sensibilité aux antibiotiques. Les dents intactes en deuxième et troisième position peuvent être laissées dans l'espace fracturé, mais dans ce cas, un traitement complexe doit inclure une antibiothérapie et une physiothérapie. Si, au cours de ce traitement, les premiers signes cliniques d'inflammation apparaissent dans la zone fracturée, la dent restante est traitée de manière conservatrice: ses canaux radiculaires sont obturés et, s'ils sont obstrués, ils sont extraits.
Les rudiments dentaires, les dents dont les racines sont informes et celles qui n'ont pas encore fait éruption (en particulier les troisièmes molaires), en l'absence d'inflammation autour d'elles, peuvent également être laissés dans la zone de fracture, sous certaines conditions. En effet, comme le montrent notre expérience et les observations d'autres auteurs, l'état de santé des dents laissées dans la zone de fracture, cliniquement déterminé le jour de la sortie du patient, est souvent trompeur et instable, surtout dans les 3 à 9 mois suivant le traumatisme. Cela s'explique par le fait que la pulpe des dents biradiculo-radiculo-nerveuses situées dans la zone de fracture, accompagnée d'une lésion du faisceau vasculo-nerveux mandibulaire, subit parfois de profondes modifications inflammatoires et dystrophiques aboutissant à une nécrose. Lorsque le faisceau vasculo-nerveux d'une dent monoradiculo-radiculo-nerveux est endommagé, des modifications nécrotiques de la pulpe sont observées dans la plupart des cas.
Selon les données de divers auteurs, la préservation des dents dans l'espace fracturé n'est possible que chez 46,3 % des patients, les autres développant une parodontite, une résorption osseuse ou une ostéomyélite. Parallèlement, les ébauches dentaires et les dents dont les racines sont incomplètement formées, préservées en l'absence de signes d'inflammation, présentent une grande viabilité: après une immobilisation fiable des fragments, les dents continuent de se développer normalement (dans 97 %) et font éruption rapidement, tandis que l'excitabilité électrique de leur pulpe se normalise à long terme. Les dents réimplantées dans l'espace fracturé meurent en moyenne chez la moitié des patients.
Si, outre une lésion maxillo-faciale, une commotion cérébrale ou un traumatisme crânien, un dysfonctionnement des systèmes circulatoire, respiratoire et digestif, etc., est présent, les mesures nécessaires sont prises et un traitement approprié est prescrit. Il est souvent nécessaire de consulter divers spécialistes.
En raison de la connexion anatomique des os du crâne et de la face, toutes les structures de la partie crânienne du crâne sont affectées en cas de traumatisme maxillo-facial. L'intensité du facteur agissant dépasse généralement les limites d'élasticité et de résistance des os individuels du visage. Dans de tels cas, les parties adjacentes et plus profondes du crâne, voire de la partie crânienne, sont endommagées.
Une caractéristique des traumatismes combinés facial et cérébral est que des lésions cérébrales peuvent survenir même sans impact sur la partie cérébrale du crâne. La force traumatique à l'origine d'une fracture de l'os facial est transmise directement au cerveau adjacent, provoquant des modifications neurodynamiques, physiopathologiques et structurelles d'intensité variable. Par conséquent, des lésions combinées de la région maxillo-faciale et du cerveau peuvent être causées par l'impact d'un agent traumatique uniquement sur la partie faciale du crâne, ou simultanément sur les parties faciale et cérébrale du crâne.
Cliniquement, une lésion cranio-cérébrale fermée se manifeste par des symptômes cérébraux généraux et locaux. Les symptômes cérébraux généraux incluent une perte de connaissance, des céphalées, des étourdissements, des nausées, des vomissements et une amnésie, tandis que les symptômes locaux incluent un dysfonctionnement des nerfs crâniens. Tous les patients ayant des antécédents de commotion cérébrale nécessitent un traitement complexe avec un neurochirurgien ou un neurologue. Malheureusement, une commotion cérébrale associée à un traumatisme des os de la face n'est généralement diagnostiquée qu'en cas de symptômes neurologiques prononcés.
Complications de la fracture de la mâchoire, prévention et traitement
Toutes les complications résultant de fractures de la mâchoire peuvent être divisées en générales et locales, inflammatoires et non inflammatoires; selon le temps, elles sont divisées en précoces et à distance (tardives).
Les complications précoces fréquentes comprennent des troubles psycho-émotionnels et neurologiques, ainsi que des modifications du système circulatoire et d'autres systèmes. La prévention et le traitement de ces complications sont assurés par des chirurgiens maxillo-faciaux en collaboration avec des spécialistes compétents.
Parmi les complications locales précoces, les plus fréquemment observées sont les dysfonctionnements de l'appareil masticateur (y compris les articulations temporo-mandibulaires), l'ostéomyélite traumatique (chez 11,7 % des victimes), la suppuration des hématomes, la lymphadénite, l'arthrite, les abcès, le phlegmon, la sinusite, le retard de consolidation des fragments, etc.
Pour prévenir d'éventuelles complications générales et locales, il est conseillé d'effectuer des blocages trigémino-sympathiques et des sinus carotidiens à la novocaïne, qui permettent de désactiver les zones réflexogènes extracérébrales, grâce auxquelles la dynamique du liquide céphalo-rachidien, la respiration et la circulation cérébrale sont normalisées.
Le bloc trigémino-sympathique est réalisé selon la méthode bien connue de MP Zhakov. Le bloc du sinus carotidien est réalisé comme suit: un coussin est placé sous le dos du patient allongé sur le dos, au niveau des omoplates, de sorte que la tête soit légèrement renversée en arrière et tournée dans la direction opposée. Une aiguille est injectée le long du bord interne du muscle sterno-cléido-mastoïdien, 1 cm sous le niveau du bord supérieur du cartilage thyroïdien (projection du sinus carotidien). De la novocaïne est injectée à mesure que l'aiguille avance. Lorsque le fascia du faisceau vasculo-nerveux est ponctionné, une certaine résistance est surmontée et une pulsation des sinus carotidiens est ressentie. 15 à 20 ml de solution de novocaïne à 0,5 % sont injectés.
Compte tenu du risque accru de développer des complications septiques chez les patients présentant des lésions de la région maxillo-faciale, du cerveau et d'autres zones du corps, il est nécessaire de prescrire des doses massives d'antibiotiques (après un test intradermique de tolérance individuelle) dès le premier jour après l'admission à l'hôpital.
En cas de complications respiratoires (souvent cause de décès chez ces patients), un traitement hormonal et une radiographie dynamique (avec la participation de spécialistes compétents) sont indiqués. Une prise en charge spécialisée de ces patients par un chirurgien maxillo-facial doit être assurée immédiatement après la sortie du choc, et au plus tard 24 à 36 heures après la blessure.
Divers facteurs indésirables locaux et généraux (infection de la cavité buccale et caries dentaires, écrasement des tissus mous, hématome, fixation insuffisamment rigide, épuisement du patient dû à une alimentation perturbée, stress psycho-émotionnel, dysfonctionnement du système nerveux, etc.) contribuent à l'apparition de processus inflammatoires. Par conséquent, l'un des principaux points du traitement est de stimuler la guérison de la fracture de la mâchoire en augmentant les capacités de régénération du corps du patient et en prévenant la formation de couches inflammatoires dans la zone endommagée.
Ces dernières années, en raison de la résistance accrue des infections staphylococciques aux antibiotiques, le nombre de complications inflammatoires liées aux lésions osseuses faciales a augmenté. Les complications inflammatoires les plus fréquentes surviennent lors de fractures localisées au niveau de l'angle de la mâchoire inférieure. Cela s'explique par la contraction réflexe des muscles masticateurs situés de part et d'autre de la fracture, qui pénètrent dans l'espace et sont pincés entre les fragments. La muqueuse gingivale au niveau de l'angle de la mâchoire inférieure étant étroitement fusionnée avec le périoste du processus alvéolaire et se rompant au moindre déplacement des fragments, des portes d'entrée constamment béantes se forment, permettant aux micro-organismes pathogènes, à la salive, aux cellules épithéliales exfoliées et aux amas alimentaires de pénétrer dans l'espace osseux. Lors de la déglutition, les fibres musculaires pincées par les fragments se contractent, ce qui entraîne un afflux actif de salive dans la profondeur de l'espace osseux.
Les signes d’une inflammation croissante des os et des tissus mous sont généralement une hyperémie cutanée à développement rapide, des douleurs, une infiltration, etc.
Le développement de complications est facilité par des facteurs tels que la parodontite (chez 14,4 % des victimes), l'hospitalisation tardive et la fourniture intempestive de soins spécialisés, l'âge avancé des patients, la présence de maladies chroniques concomitantes, les mauvaises habitudes (alcoolisme), la diminution de la réactivité du corps, un diagnostic et un choix de méthode de traitement incorrects, un dysfonctionnement du système nerveux périphérique résultant d'une fracture (lésions des branches du nerf trijumeau), etc.
Un facteur important qui retarde la consolidation des fragments de mâchoire est l'ostéomyélite traumatique, qui, avec d'autres processus inflammatoires, survient particulièrement souvent dans les cas où le repositionnement et l'immobilisation des fragments ont été effectués à un stade ultérieur.
Il est important de prendre en compte que toute blessure provoque une réaction inflammatoire autour de la plaie. Quel que soit le type d'agent pathogène (physique, chimique, biologique), les mécanismes pathogéniques du processus inflammatoire en développement sont identiques et se caractérisent par une perturbation de la microcirculation, des processus d'oxydoréduction et l'action de micro-organismes dans les tissus lésés. En cas de blessure, la contamination bactérienne de la plaie est inévitable. La gravité du processus purulent-inflammatoire dépend des caractéristiques de l'agent infectieux, de l'état immunobiologique du patient au moment de l'introduction de l'agent pathogène, ainsi que du degré de troubles vasculaires et métaboliques des tissus au site de la blessure. La résistance des tissus lésés à l'infection purulente est fortement réduite, ce qui crée des conditions propices à la reproduction de l'agent pathogène et à la manifestation de ses propriétés pathogènes, provoquant une réaction inflammatoire et un effet destructeur sur les tissus.
Au site d'action du facteur dommageable, des conditions optimales sont créées pour l'activation des enzymes protéolytiques libérées par les micro-organismes, les tissus affectés et les leucocytes, et la formation de médiateurs stimulant l'inflammation – histamine, sérotonine, kinines, héparine, protéines activées, etc. – qui perturbent la microcirculation, les échanges transcapillaires et la coagulation sanguine. Les protéases tissulaires, produits de l'activité microbienne, contribuent au désordre des processus d'oxydoréduction et à la perturbation de la respiration tissulaire.
L'accumulation de produits sous-oxydés qui en résulte et le développement d'une acidose tissulaire entraînent des troubles secondaires de la microhémodynamique au site de la blessure et le développement d'une carence locale en vitamines.
Des dommages particulièrement graves aux processus de régénération tissulaire sont observés en cas de carence en vitamine C, ce qui entraîne une inhibition de la synthèse du collagène du tissu conjonctif et de la cicatrisation des plaies; dans ce cas, la teneur en vitamine C est considérablement réduite dans les granulations flasques des plaies infectées.
Dans toute blessure, un rôle important dans la limitation du processus inflammatoire est attribué à la réaction hémostatique, car la formation d'une couche de fibrine et le dépôt de substances toxiques et de micro-organismes à sa surface empêchent la propagation ultérieure du processus pathologique.
Ainsi, en cas de complications purulentes suite à des blessures, une chaîne fermée de processus pathologiques se met en place, favorisant la propagation de l'infection et empêchant la cicatrisation. Par conséquent, l'utilisation précoce de divers médicaments biologiquement actifs aux effets anti-inflammatoires, antimicrobiens, antihypoxiques et stimulants des processus réparateurs est justifiée d'un point de vue pathogénique afin de réduire les complications purulentes et d'accroître l'efficacité des traitements complexes.
L'Institut de recherche en orthopédie de Kiev du ministère de la Santé de l'Ukraine a mené des recherches sur le mécanisme d'action des substances biologiquement actives et a recommandé l'utilisation d'amben, de galascorbin, de Kalanchoe et de propolis dans les maladies purulentes-inflammatoires.
Contrairement aux inhibiteurs naturels de la protéolyse (trasylol, contrycal, iniprole, tsalol, gordox, pantrypin), l'Amben pénètre facilement toutes les membranes cellulaires et peut être utilisé localement en solution à 1 %, par voie intraveineuse ou intramusculaire, à raison de 250 à 500 mg toutes les 6 à 8 heures. En 24 heures, le médicament est excrété inchangé par les reins. Appliqué localement, il pénètre efficacement dans les tissus et neutralise complètement la fibrinolyse tissulaire des tissus endommagés en 10 à 15 minutes.
Dans les complications purulentes-inflammatoires des fractures de la mâchoire, l'Amoxiclav est utilisé avec succès. Il s'agit d'une association d'acide clavulanique et d'amoxicilline, administrée par voie intraveineuse à raison de 1,2 g toutes les 8 heures ou par voie orale à raison de 375 mg 3 fois par jour pendant 5 jours. Chez les patients ayant subi une intervention chirurgicale programmée, le médicament est prescrit par voie intraveineuse à raison de 1,2 g une fois par jour ou par voie orale aux mêmes doses.
L'activité biologique de la galascorbine est nettement supérieure à celle de l'acide ascorbique, grâce à sa présence dans la préparation, associée à des substances à activité vitaminique P (polyphénols). La galascorbine favorise l'accumulation d'acide ascorbique dans les organes et les tissus, épaissit la paroi vasculaire, stimule la cicatrisation, accélère la régénération musculaire et osseuse et normalise les processus d'oxydoréduction. La galascorbine s'utilise par voie orale à raison de 1 g 4 fois par jour; en application locale, en solutions fraîchement préparées à 1-5 % ou sous forme de pommade à 5-10 %.
La propolis contient 50 à 55 % de résines végétales, 30 % de cire et 10 à 18 % d'huiles essentielles. Elle est utilisée dans la fabrication de divers baumes, contient de l'acide cinnamique, de l'alcool et des tanins. Elle est riche en micro-éléments (cuivre, fer, manganèse, zinc, cobalt, etc.), en substances antibiotiques, en vitamines des groupes B, E, C, PP, P et en provitamine A. Elle possède également un effet analgésique. Son effet antibactérien est particulièrement prononcé. Les propriétés antimicrobiennes de la propolis ont été établies contre un certain nombre de micro-organismes pathogènes à Gram positif et à Gram négatif. Sa capacité à augmenter la sensibilité des micro-organismes aux antibiotiques et à modifier les propriétés morphologiques, culturales et tinctoriales de diverses souches a également été constatée. Sous l'influence de la propolis, les plaies se débarrassent rapidement de leur couverture purulente et nécrotique. Il s'utilise sous forme de pommade (33 g de propolis et 67 g de lanoline) ou par voie sublinguale - sous forme de comprimés (0,01 g) 3 fois par jour.
D'autres mesures sont également recommandées pour prévenir les complications inflammatoires et stimuler l'ostéogenèse. En voici quelques-unes:
- Administration d'antibiotiques (en tenant compte de la sensibilité de la microflore) dans les tissus mous entourant la fracture ouverte, dès le premier jour de traitement. L'administration locale d'antibiotiques permet de réduire de plus de 5 fois le nombre de complications. L'administration d'antibiotiques à un stade ultérieur (du 6e au 9e jour et au-delà) ne diminue pas le nombre de complications, mais accélère l'élimination de l'inflammation déjà développée.
- Administration intramusculaire d'antibiotiques si indiqué (augmentation de l'infiltrat, augmentation de la température corporelle, etc.).
- Thérapie UHF locale du 2e au 12e jour à compter du moment de la blessure (10 à 12 minutes par jour), irradiation générale au quartz du 2e au 3e jour (environ 20 procédures), électrophorèse au chlorure de calcium sur la zone de fracture - du 13e au 14e jour jusqu'à la fin du traitement (jusqu'à 15 à 20 procédures).
- Administration orale de multivitamines et d'une solution de chlorure de calcium à 5 % (une cuillère à soupe trois fois par jour avec du lait); l'acide ascorbique et la thiamine sont particulièrement utiles.
- Afin d'accélérer la consolidation des fragments, OD Nemsadze (1991) recommande l'utilisation supplémentaire des médicaments suivants: stéroïde anabolisant (par exemple, nerobol per os, 1 comprimé 3 fois par jour pendant 1 à 2 mois, ou retabolil 50 mg par voie intramusculaire une fois par semaine pendant 1 mois); solution de fluorure de sodium à 1 %, 10 gouttes 3 fois par jour pendant 2 à 3 mois; hydrolysat de protéines (hydrolysine, hydrolysat de caséine) pendant 10 à 20 jours.
- Afin de réduire le spasme des vaisseaux sanguins dans la zone de fracture (qui, selon AI Elyashev (1939), dure 1 à 1,5 mois et inhibe la formation osseuse), ainsi que pour accélérer la consolidation des fragments, OD Nemsadze (1985) suggère l'administration intramusculaire de médicaments antispasmodiques (gangleron, dibazol, papavérine, trental, etc.) 3 jours après la blessure pendant 10 à 30 jours.
- Administration intramusculaire de lysozyme 100-150 mg deux fois par jour pendant 5 à 7 jours.
- Utilisation d'un complexe d'antioxydants (acétate de tocophérol, flacumine, acide ascorbique, cystéine, extrait d'éleuthérocoque ou acémine).
- L'application de l'hypothermie locale selon la technique décrite par AS Komok (1991), à condition d'utiliser un dispositif spécial pour l'hypothermie locale de la région maxillo-faciale, permet de maintenir la température des tissus lésés, y compris l'os de la mâchoire inférieure, entre +30 °C et +28 °C. Grâce au refroidissement équilibré des tissus par les chambres externe et intra-orale, la température du liquide de refroidissement circulant peut être réduite à +16 °C, ce qui rend la procédure bien tolérée et permet sa poursuite à long terme. AS Komok indique que la réduction de la température tissulaire locale dans la zone de fracture de la mâchoire inférieure à des valeurs de +28 °C sur la peau, +29 °C sur la muqueuse de la joue et +29,5 °C sur la muqueuse du processus alvéolaire de la mâchoire inférieure contribue à normaliser le flux sanguin, à éliminer la congestion veineuse et les gonflements, à prévenir le développement d'hémorragies et d'hématomes et à éliminer les réactions douloureuses. L'hypothermie tissulaire modérée, uniforme et stratifiée en mode de refroidissement de +30°C - +28°C pendant les 10 à 12 heures qui suivent l'immobilisation des deux mâchoires en combinaison avec des médicaments permet la normalisation du flux sanguin dans les tissus dès le troisième jour, l'élimination des réactions de température et des phénomènes inflammatoires, et provoque un effet analgésique prononcé.
Dans le même temps, AS Komok souligne également la complexité de cette méthode, car, selon ses données, seul un ensemble de méthodes électrophysiologiques, comprenant l'électrothermométrie, la rhéographie, la rhéodermatométrie et l'électroalgésimétrie, permet une évaluation assez objective du flux sanguin, de l'échange de chaleur et de l'innervation dans les tissus lésés et la dynamique des changements de ces indicateurs sous l'influence du traitement.
Selon VP Korobov et al. (1989), la correction des variations métaboliques sanguines lors des fractures de la mâchoire inférieure peut être obtenue soit par la ferramide, soit (plus efficace encore) par la coamide, qui favorise la fusion accélérée des fragments osseux. En cas d'ostéomyélite traumatique aiguë, l'abcès est ouvert et la fracture est lavée; une autohémothérapie fractionnée est également souhaitable: réinfusion de sang irradié aux ultraviolets 3 à 5 fois, associée à un traitement antiseptique anti-inflammatoire actif selon le schéma généralement admis. Au stade de l'inflammation chronique, il est recommandé d'activer la régénération osseuse selon le schéma suivant: lévamisole (150 mg par voie orale une fois par jour pendant 3 jours; l'intervalle entre les cycles est de 3 à 4 jours; il y a 3 cycles de ce type), ou T-activine par voie sous-cutanée (0,01 %, 1 ml pendant 5 jours), ou exposition à un laser hélium-néon sur des points biologiquement actifs du visage et du cou (10 à 15 s par point avec un flux lumineux ne dépassant pas 4 mW pendant 10 jours). Après l'apparition d'une raideur dans la zone de fracture, une mécanothérapie dosée et d'autres effets biologiques généraux ont été prescrits. Selon les auteurs, la durée du traitement hospitalier est réduite de 10 à 12 jours et l'incapacité temporaire de 7 à 8 jours.
Français De nombreux autres moyens et méthodes ont été proposés pour la prévention ou le traitement de l'ostéomyélite traumatique des mâchoires, tels qu'une suspension d'os déminéralisé, l'aérosol de Nitazol, l'anatoxine staphylococcique avec du sang autologue, l'aspiration sous vide du contenu de la fracture et le rinçage de la plaie osseuse sous pression avec un jet de solution de dioxidine à 1 %; thérapie immunocorrectrice. EA Karasyunok (1992) rapporte que lui et ses collègues ont étudié expérimentalement et prouvé cliniquement l'opportunité d'utiliser, dans le contexte d'une antibiothérapie rationnelle, une solution à 25 % d'acémine par voie orale à raison de 20 ml 2 fois par jour pendant 10 à 14 jours, ainsi que le sondage de la zone de fracture avec l'appareil UPSK-7N en mode labile continu, et l'introduction d'une solution à 10 % de chlorhydrate de lincomycine par électrophorèse. L’utilisation de cette technique a permis une réduction des complications de 28 % à 3,85 % et une réduction de l’incapacité temporaire de 10,4 jours.
R. 3. Ogonovsky, IM Got, OM Sirii, I. Ya. Lomnitsky (1997) recommandent l'utilisation de la xéno-brephotransplantation cellulaire dans le traitement des fractures de la mâchoire non cicatrisantes à long terme. À cette fin, une suspension de cellules de moelle osseuse dévitalisées provenant d'embryons de 14 jours est introduite dans l'espace fracturé. Aux 12-14 jours, les auteurs ont observé un épaississement du cal osseux périosté, et aux 20-22 jours, le début d'une consolidation stable de la fracture, qui n'avait pas cicatrisé pendant 60 jours d'immobilisation. Cette méthode permet d'éviter les interventions chirurgicales répétées.
La littérature nationale et internationale regorge d'autres propositions, malheureusement réservées actuellement aux médecins exerçant dans des cliniques bien équipées en matériel et médicaments. Cependant, chaque médecin doit garder à l'esprit qu'il existe d'autres moyens plus accessibles de prévenir les complications liées au traitement des fractures des os de la face. Par exemple, il ne faut pas oublier qu'une procédure aussi simple que l'électrophorèse au chlorure de calcium (introduction d'une solution à 40 % depuis l'anode sous un courant de 3 à 4 mA) favorise la compaction rapide du cal osseux en formation. En cas de complication inflammatoire de la fracture, il est conseillé, en complément d'une antibiothérapie, d'utiliser un blocage alcool-novocaïne (solution de novocaïne à 0,5 % dans de l'alcool à 5 %). Un traitement complexe selon le schéma décrit permet de réduire le temps d'immobilisation du fragment de 8 à 10 jours, et de 6 à 8 jours en cas de fractures compliquées par un processus inflammatoire.
Nous avons observé une réduction significative de la durée d'hospitalisation après l'introduction de 0,2 ml de sérum cytotoxique ostéogénique (stimoblaste) dans une solution isotonique de chlorure de sodium (dilution 1:3) dans la zone de fracture. Le sérum a été administré les 3e, 7e et 11e jours après la blessure.
Certains auteurs recommandent d'inclure la thérapie par micro-ondes et UHF en combinaison avec une irradiation ultraviolette générale et une électrophorèse au chlorure de calcium dans un traitement complexe pour accélérer la consolidation des fragments de mâchoire, et VP Pyurik (1993) recommande d'utiliser une injection interfragmentaire des cellules de moelle osseuse du patient (à raison de 1 mm3 de cellules pour 1 cm2 de surface de fracture osseuse).
Compte tenu du mécanisme de développement des complications inflammatoires des fractures des angles de la mâchoire inférieure, leur prévention nécessite l'immobilisation la plus précoce possible des fragments osseux, associée à un traitement anti-inflammatoire ciblé. En particulier, après traitement de la cavité buccale avec une solution de furaciline (1:5000), une anesthésie par infiltration de la zone fracturée avec une solution de novocaïne à 1 % (côté peau) doit être réalisée. Après avoir vérifié que l'aiguille est bien insérée dans la fracture (le sang pénètre dans la seringue et l'anesthésique pénètre dans la bouche), rincer à plusieurs reprises (avec une solution de furaciline) le contenu de la fracture vers la cavité buccale à travers la muqueuse lésée (LM Vartanyan).
Avant d'immobiliser les fragments de mâchoire par fixation intermaxillaire rigide (traction) ou par la méthode d'ostéosynthèse la moins traumatisante (percutanée) avec broche de Kirschner, il est recommandé d'infiltrer les tissus mous de la zone de fracture de l'angle mandibulaire avec une solution antibiotique à large spectre. Un traumatisme plus important (par exemple, exposition de l'angle mandibulaire et suture osseuse) est déconseillé, car il contribue à l'intensification du processus inflammatoire amorcé.
En cas d'ostéomyélite traumatique avancée, après séquestrectomie, la fracture peut être fixée à l'aide d'une broche métallique insérée par voie transfocale (à travers l'espace fracturé). Cependant, la fixation des fragments de la mâchoire inférieure par des dispositifs de compression extrafocale externes est plus efficace. Ces dispositifs, en cas de fractures compliquées par une ostéomyélite traumatique (au stade aigu de l'évolution), assurent une consolidation dans les délais habituels (ne dépassant pas la cicatrisation des fractures récentes) et contribuent à stopper le processus inflammatoire, la compression étant réalisée sans intervention préalable sur la lésion. La fixation extrafocale des fragments permet une intervention chirurgicale ultérieure nécessaire (ouverture d'un abcès, d'un phlegmon, retrait de séquestres, etc.) sans perturber l'immobilisation.
L'ostéomyélite traumatique évolue presque toujours lentement et n'affecte pas significativement l'état général du patient. Un gonflement persistant des tissus mous au niveau de la zone fracturée est associé à une congestion, une réaction périostée et une infiltration ganglionnaire. Le rejet des séquestrants osseux de la fracture est lent; leur taille est généralement insignifiante (quelques millimètres). Des exacerbations périodiques d'ostéomyélite, de périostite et de lymphadénite sont possibles, avec formation d'abcès périmandibulaires, de phlegmon et d'adénophlegmon. Dans ces cas, il est nécessaire de disséquer les tissus pour évacuer le pus, drainer la plaie et prescrire des antibiotiques.
Au stade chronique de l'ostéomyélite, il est conseillé de rapprocher les fragments de mâchoire par compression, ou de prescrire du pentoxyl à raison de 0,2 à 0,3 g 3 fois par jour pendant 10 à 14 jours (après la pose d'une attelle dentaire et après une ostéosynthèse percutanée), ou d'injecter (à l'aide d'une aiguille de Dufour) 2 à 3 ml d'une suspension de poudre d'allobone fœtal lyophilisée dans la fracture. Il est recommandé d'injecter la suspension une fois, sous anesthésie locale, 2 à 3 jours après le repositionnement et la fixation des fragments, c'est-à-dire lorsque la plaie cicatrisée de la gencive empêche la suspension de s'infiltrer dans la cavité buccale. Grâce à cette technique, la traction intermaxillaire peut être levée, aussi bien pour les fractures simples que doubles, 6 à 7 jours plus tôt que d'habitude, réduisant ainsi la durée totale de l'invalidité de 7 à 8 jours en moyenne. L'injection extra-orale de 5 à 10 ml d'une solution d'alcool à 10 % dans une solution de novocaïne à 0,5 % dans la zone de fracture accélère également la consolidation clinique des fragments de 5 à 6 jours et réduit la durée d'invalidité de 6 jours en moyenne. L'utilisation d'allocostéum et de pentoxyl permet de réduire significativement le nombre de complications inflammatoires.
Français Il existe des données sur l'efficacité de l'utilisation de diverses autres méthodes et moyens pour stimuler l'ostéogenèse (dans le domaine de l'ostéomyélite traumatique): vide focal dosé, exposition aux ultrasons, thérapie magnétique selon NA Berezovskaya (1985), stimulation électrique; rayonnement de faible intensité d'un laser hélium-néon en tenant compte du stade du processus post-traumatique; oxygénothérapie locale et irradiation aux rayons X à trois ou quatre reprises à des doses de 0,3 à 0,4 fée (avec des signes prononcés d'inflammation aiguë, lorsqu'il est nécessaire de soulager le gonflement et l'infiltration ou d'accélérer la formation d'abcès, de soulager les symptômes de la douleur et de créer des conditions favorables à la cicatrisation des plaies); thyrocalcitonine, ectericide en combinaison avec l'acide ascorbique, nérobol en combinaison avec l'hydrolysat de protéines, phosphrène, gemostimuline, préparations fluorées, sérum cytotoxique ostéogénique, carbostimuline, retabolil, éleuthérocoque; inclusion de la pâte "Ocean" de krill, etc. dans l'alimentation du patient. Au stade d'ostéomyélite traumatique chronique après nécrectomie, certains auteurs ont recours à la radiothérapie à une dose de 0,5 à 0,7 gray (5 à 7 irradiations) pour éliminer les signes locaux d'exacerbation du processus inflammatoire, accélérer le nettoyage de la plaie des masses nécrotiques, améliorer le sommeil, l'appétit et le bien-être général des patients. De bons résultats dans l'ostéomyélite traumatique de la mâchoire inférieure sont obtenus en associant la séquestrectomie à un traitement radical de la plaie osseuse, en comblant le défaut osseux par du brefobos et en immobilisant rigidement les fragments de mâchoire.
Lorsqu'une fracture est associée à une parodontite, l'inflammation des tissus mous est particulièrement prononcée. Les patients admis au troisième ou quatrième jour présentent une gingivite prononcée, des saignements des gencives, une mauvaise haleine et un écoulement de pus des poches pathologiques. La consolidation de la fracture en cas de parodontite est plus longue. Dans ce cas, il est recommandé d'associer un traitement complexe de la parodontite au traitement de la fracture.
La kinésithérapie est essentielle dans le traitement des fractures de la mâchoire inférieure. Des exercices actifs pour les muscles masticateurs (avec une amplitude de mouvement minimale), les muscles faciaux et la langue peuvent être débutés 1 à 2 jours après l'immobilisation par une gouttière dentaire unimaxillaire ou un dispositif extra-oral osseux. Avec la traction intermaxillaire, des exercices toniques généraux, des exercices pour les muscles faciaux et la langue, ainsi que des exercices de tension volontaire des muscles masticateurs peuvent être réalisés à partir du 2e ou 3e jour après la fracture (pose d'une gouttière) jusqu'au retrait de la traction en caoutchouc. Après la consolidation primaire de la fracture et le retrait de la traction en caoutchouc intermaxillaire, des exercices actifs pour la mâchoire inférieure sont prescrits.
Une altération de la circulation sanguine au niveau des muscles masticateurs entraîne une diminution de l'intensité de la minéralisation du régénérat dans l'espace de fracture angulaire (V.I. Vlasova, I.A. Lukyanchikova), ce qui est également à l'origine de complications inflammatoires fréquentes. Un programme d'activité physique (exercice thérapeutique) prescrit à temps améliore significativement les indices électromyographiques, gnathodynométriques et dynamométriques de la fonction des muscles masticateurs. La mise en charge fonctionnelle précoce des processus alvéolaires à l'aide de gouttières-prothèses gingivales utilisées pour les fractures intra-arcades dentaires (en présence d'un fragment édenté pouvant être réduit manuellement et maintenu par la base de la gouttière-prothèse, ainsi qu'en cas d'immobilisation rigide et stable par ostéosynthèse) permet également de réduire la période d'incapacité de travail de 4 à 5 jours en moyenne. Lorsque des charges de mastication fonctionnelles sont incluses dans l'ensemble des mesures thérapeutiques, le régénérat se restructure plus rapidement, restaure sa structure histologique et sa fonction, tout en conservant sa forme anatomique.
Pour réduire l'intensité des troubles hypodynamiques des muscles masticateurs et de la zone de fracture de la mâchoire inférieure, il est possible d'utiliser la méthode de stimulation bioélectrique (fréquente en traumatologie générale, médecine du sport et médecine spatiale) des muscles temporo-pariétaux et masticateurs à l'aide du dispositif Myoton-2. Les séances sont réalisées quotidiennement pendant 5 à 7 minutes pendant 15 à 20 jours, du premier au troisième jour après l'immobilisation. La stimulation électrique entraîne la contraction des muscles concernés sans mouvements des articulations temporo-mandibulaires; ainsi, la circulation sanguine et les connexions neuroréflexes de la région maxillo-faciale sont rétablies plus rapidement, et le tonus musculaire est préservé. Tout cela contribue également à réduire la période de consolidation de la fracture.
Selon V.I. Chirkin (1991), l'inclusion de la stimulation électrique proportionnelle biocontrôlée multicanal des muscles temporaux, masticateurs et abaissant la mâchoire inférieure dans le cadre habituel des mesures de rééducation en mode infraliminaire et thérapeutique chez les patients présentant un traumatisme unilatéral a permis, dès le 28e jour, de rétablir complètement l'apport sanguin aux tissus, d'augmenter le volume d'ouverture buccale à 84 % et l'amplitude de la réponse M à 74 % par rapport à la norme. La fonction masticatoire a pu être normalisée, et les patients ont consacré autant de temps et effectué le même nombre de mouvements de mastication à mâcher des échantillons alimentaires que les personnes en bonne santé.
Chez les patients présentant un traumatisme chirurgical bilatéral des muscles masticateurs, des procédures de stimulation électrique proportionnelle biocontrôlée multicanal en modes sous-seuil, thérapeutique et d'entraînement peuvent être démarrées à un stade précoce (7 à 9 jours après la chirurgie), ce qui garantit des changements positifs dans l'apport sanguin à la zone blessée, comme en témoignent les résultats des études rhéographiques, qui ont atteint la norme au moment du retrait des attelles.
L'ouverture buccale a été augmentée à 74 %, et l'amplitude de la réponse M a également augmenté à 68 %. La fonction masticatoire s'est presque normalisée, selon l'électromyographie fonctionnelle, dont les indicateurs ont atteint le niveau moyen des individus sains. L'auteur estime que la méthode de rhéovasofaciographie multicanal, l'électromyographie de stimulation des muscles masticateurs, l'enregistrement du réflexe parodontomusculaire et l'électromyographie fonctionnelle multicanal avec des échantillons alimentaires standard constituent les méthodes les plus objectives pour étudier le système masticateur et peuvent constituer des méthodes de choix pour l'examen des patients présentant des fractures de la mâchoire et des traumatismes chirurgicaux des muscles masticateurs.
Les procédures de stimulation électrique proportionnelle biocontrôlée multicanal des muscles masticateurs, selon trois modes, selon la méthode recommandée par l'auteur, permettent d'initier précocement un traitement de rééducation fonctionnelle. Ce type de traitement, parfaitement adapté au fonctionnement naturel du système masticateur, est bien dosé et contrôlé, ce qui permet d'obtenir les meilleurs résultats de restauration fonctionnelle à ce jour et de réduire la durée totale d'incapacité des patients de 5 à 10 jours.
Le problème du traitement et de la rééducation des patients présentant des fractures de la mâchoire inférieure, accompagnées d'une atteinte du nerf alvéolaire inférieur, mérite une attention particulière. Selon SN Fedotov (1993), une atteinte du nerf alvéolaire inférieur a été diagnostiquée chez 82,2 % des victimes de fracture de la mâchoire inférieure, dont 28,3 % étaient légères, 22 % modérées et 31,2 % graves. Les lésions légères incluent celles pour lesquelles la réaction de toutes les dents du côté de la fracture était comprise entre 40 et 50 μA, et une légère hypoesthésie a été observée au niveau de la peau du menton et de la muqueuse buccale; la catégorie modérée inclut une réaction des dents jusqu'à 100 μA. Une réaction supérieure à 100 μA et une perte partielle ou totale de sensibilité des tissus mous, la lésion est considérée comme grave. Parallèlement, les troubles neurologiques liés aux fractures des os de la face et leur traitement en médecine pratique n'ont pas reçu suffisamment d'attention à ce jour. Selon SN Fedorov, la profondeur des lésions nerveuses augmente encore avec les méthodes chirurgicales de jonction des fragments. Il en résulte des troubles sensoriels à long terme, des processus neurotrophiques destructeurs du tissu osseux, un ralentissement de la fusion des fragments, une diminution de la fonction masticatoire et des douleurs atroces.
Sur la base de ses observations cliniques (336 patients), l'auteur a élaboré un ensemble rationnel de traitements restaurateurs des fractures mandibulaires accompagnées d'une atteinte de la troisième branche du nerf trijumeau, utilisant des méthodes physiques et des stimulants médicinaux (neurotropes et vasodilatateurs). Afin de prévenir les lésions secondaires du nerf alvéolaire inférieur et de ses branches lors du traitement chirurgical des fractures, une nouvelle version de l'ostéosynthèse des fragments par des rayons métalliques est proposée, basée sur une approche respectueuse des dents et des branches du nerf alvéolaire inférieur.
Pour certains patients atteints de troubles neurologiques, l'auteur a prescrit une exposition à un champ électrique UHF ou à une lampe Sollux dès le deuxième ou le troisième jour suivant l'immobilisation des fragments; en cas de douleur le long du nerf alvéolaire inférieur, une électrophorèse avec une solution à 0,5 % de novocaïne adrénaline selon A.P. Parfenov (1973) a été réalisée. Chez d'autres patients, selon les indications, seule une échographie a été prescrite. Douze jours plus tard, au stade de la formation du cal osseux primaire, une électrophorèse avec une solution à 5 % de chlorure de calcium a été prescrite.
Parallèlement au traitement physique, à partir du 2e ou 3e jour, des stimulants médicinaux ont été utilisés: vitamines B6 et B12; dibazol à 0,005 %; en cas de troubles profonds, 1 ml de solution de prosérine à 0,05 %, selon le schéma. Parallèlement, des médicaments ont été prescrits pour stimuler la circulation sanguine (chlorhydrate de papavérine 2 ml d’une solution à 2 %; acide nicotinique 1 % 1 ml; complamine 2 ml d’une solution à 15 %, pour une cure de 25 à 30 injections).
Après une pause de 7 à 10 jours, si les lésions nerveuses persistaient, une électrophorèse avec une solution d'iodure de potassium à 10 % ou une électrophorèse avec enzymes était prescrite pour une série de 10 à 12 procédures; de la galantamine à 1 % (1 ml) était utilisée pour une série de 10 à 20 injections, ainsi que des applications de paraffine et d'ozokérite. Après 3 à 6 mois, si les troubles neurologiques persistaient, les traitements étaient répétés jusqu'à guérison complète. Un élément obligatoire du traitement recommandé par SN Fedotov est la surveillance constante de son efficacité selon les méthodes de recherche neurologique. L'utilisation du complexe de traitement réparateur décrit a contribué à un rétablissement plus rapide de la conductivité du nerf alvéolaire inférieur: pour les troubles fonctionnels légers, en 1,5 à 3 mois, et pour les troubles modérés et sévères, en 6 mois. Chez les patients traités par méthodes traditionnelles, la conductivité du nerf alvéolaire inférieur a été rétablie en 1,5 à 3 à 6 mois pour les troubles légers et en 6 à 12 mois pour les troubles modérés et sévères. Selon SN Fedorov, environ 20 % des patients présentaient des troubles persistants et profonds de la sensibilité à la douleur depuis plus d'un an. Les lésions modérées et sévères du nerf alvéolaire inférieur s'accompagnent très probablement d'un étirement excessif du tronc nerveux lors du déplacement des fragments, de contusions avec rupture des fibres nerveuses, et de ruptures partielles ou complètes. Tout cela ralentit la réinnervation. Une restauration précoce de la fonction trophique du système nerveux a eu un effet bénéfique sur la qualité et le délai de consolidation des fragments. Dans le premier groupe (principal) de patients, la consolidation des fragments est survenue en moyenne après 27 + 0,58 jours, les périodes d'incapacité de travail étant de 25 ± 4,11 jours. La fonction masticatoire et la contractilité musculaire ont retrouvé des valeurs normales en 1,5 à 3 mois. Dans le deuxième groupe (témoin), ces indicateurs étaient respectivement de 37,7 + 0,97 et 34 + 5,6 jours, et la fonction masticatoire et la contractilité musculaire ont été rétablies plus tard, en 3 à 6 mois. Les mesures spécifiées pour le suivi du traitement des patients traumatisés doivent être réalisées dans les salles de rééducation.
Outre l'ostéomyélite traumatique, les abcès et les phlegmons liés aux fractures de la mâchoire, une lymphadénite sous-maxillaire peut survenir dans le contexte d'une inflammation osseuse lente, difficilement traitable par les traitements conventionnels. Seul un examen approfondi et complet de ces patients, comprenant une radiographie, une scintigraphie-lymphographie indirecte avec une solution colloïdale d' 198 Au et des tests immunodiagnostiques, permet d'établir avec certitude un diagnostic d'actinomycose secondaire (post-traumatique) des ganglions sous-maxillaires.
Il est possible que les fractures de la mâchoire inférieure se compliquent simultanément d'actinomycose et de tuberculose (plus souvent chez les patients atteints de tuberculose). Des complications plus rares, mais non moins graves, des lésions maxillo-faciales peuvent également survenir: angine de poitrine de Jansoul-Ludwig; saignement tardif après ostéosynthèse compliqué d'inflammation; asphyxie après traction intermaxillaire, entraînant parfois le décès du patient par aspiration de sang lors d'un saignement de l'artère linguale ou carotide; faux anévrisme de l'artère faciale; thrombose de l'artère carotide interne; paralysie faciale secondaire (en cas de fracture de la mâchoire inférieure); emphysème facial (en cas de fracture de la mâchoire supérieure); pneumothorax et médiastinite (en cas de fracture de l'os zygomatique et de la mâchoire supérieure), etc.
La durée du séjour des patients à l'hôpital dépend de la localisation de la lésion dans la région maxillo-faciale, du déroulement de la période de consolidation et de la présence de complications.
Les conditions indiquées ne sont pas optimales. À l'avenir, avec la fin de la crise économique et l'augmentation de la capacité d'accueil, il sera possible de prolonger l'hospitalisation des patients jusqu'à la fin du traitement complet des traumatismes faciaux de diverses localisations. Les patients souffrant de lésions maxillo-faciales en milieu rural devraient rester hospitalisés plus longtemps, car ils ne peuvent généralement pas se rendre en ville pour une observation et un traitement ambulatoires en raison de l'éloignement. La disponibilité de salles de traumatologie et de réadaptation bien équipées pour les patients souffrant de telles blessures dans les établissements dentaires urbains permet de réduire légèrement leur durée d'hospitalisation.
Traitement ambulatoire (rééducation) des victimes présentant des blessures de la région maxillo-faciale
L'organisation de l'étape ambulatoire du traitement des victimes de blessures de la région maxillo-faciale n'est pas toujours suffisamment claire, car les patients sont dans de nombreux cas sous la supervision de médecins de diverses institutions qui n'ont pas une formation suffisante dans le domaine de la traumatologie maxillo-faciale.
À cet égard, il est possible de recommander d'utiliser l'expérience de la salle de rééducation de la clinique maxillo-faciale de l'Institut d'études médicales avancées de l'État de Zaporizhzhya et de la clinique dentaire régionale, qui a introduit dans sa pratique des cartes d'échange contenant toutes les informations sur le traitement de la victime à l'hôpital, dans la clinique du lieu de résidence et dans la salle de rééducation.
Lors de la rééducation des patients souffrant de lésions maxillo-faciales, il convient de prendre en compte que ces lésions sont souvent associées à des lésions cranio-cérébrales fermées et s'accompagnent également d'un dysfonctionnement et d'une altération de la structure des articulations temporo-mandibulaires (ATM). La gravité de ces troubles dépend de la localisation de la fracture: dans les fractures du processus condylien, des modifications dégénératives des deux articulations sont plus fréquentes que dans les fractures extra-articulaires. Initialement, ces troubles présentent une insuffisance fonctionnelle, qui peut évoluer vers des modifications dégénératives après 2 à 7 ans. Une arthrose unilatérale se développe du côté de la lésion après une fracture simple, et bilatérale après une fracture double ou multiple. De plus, tous les patients présentant des fractures mandibulaires présentent, à l'électromyographie, des modifications marquées des muscles masticateurs. Par conséquent, afin d'assurer la continuité du suivi des patients traumatisés en clinique dentaire, il est recommandé de consulter un dentiste-traumatologue qui assure une prise en charge globale des patients présentant des lésions faciales, quelle que soit leur localisation.
Une attention particulière doit être portée à la prévention des complications inflammatoires et des troubles neuropsychiatriques – céphalées, méningo-encéphalite, arachnoïdite, troubles autonomes, déficiences auditives et visuelles, etc. À cette fin, il est nécessaire de recourir plus largement aux méthodes de traitement physiothérapeutiques et à la rééducation par l'exercice. Il est nécessaire de surveiller attentivement l'état des bandages de fixation dans la cavité buccale, l'état des dents et des muqueuses, et de réaliser des prothèses dentaires rapides et rationnelles. Pour déterminer les modalités d'immobilisation, la durée de l'incapacité temporaire et le traitement, il est nécessaire d'aborder chaque patient individuellement, en tenant compte de la nature de la blessure, de l'évolution de la maladie, de l'âge et de la profession du patient.
Le patient doit suivre un traitement en cabinet dentaire de réadaptation. Par conséquent, par arrêté spécial du service de santé compétent, le médecin de ce cabinet est habilité à délivrer et à prolonger des certificats d'incapacité temporaire de travail, quels que soient le lieu de travail et de résidence du patient. Il est souhaitable de mettre en place un cabinet de réadaptation dentaire pour 200 000 à 300 000 personnes. En cas de diminution de la fréquence des blessures, les missions du cabinet pourraient être élargies pour prendre en charge d'autres patients opérés, sortis de l'hôpital pour un traitement ambulatoire.
Dans les zones rurales, le traitement de suivi des victimes présentant des blessures dans la région maxillo-faciale doit être effectué dans les cliniques de district (hôpitaux) sous la supervision d'un chirurgien-dentiste de district.
Le système de traitement des patients souffrant de traumatisme facial doit inclure un examen systématique des résultats à long terme du traitement.
Les services dentaires hospitaliers des hôpitaux régionaux et des cliniques dentaires régionales (territoriales) doivent mettre en œuvre des orientations organisationnelles et méthodologiques pour la prestation de soins dentaires dans la région, y compris aux patients souffrant de traumatismes faciaux.
Les centres de soins dentaires spécialisés constituent souvent le socle clinique des départements de chirurgie maxillo-faciale des universités et instituts de médecine (académies, facultés) de formation continue des médecins. La présence d'un personnel hautement qualifié permet d'appliquer largement les méthodes les plus récentes de diagnostic et de traitement des diverses lésions maxillo-faciales et de réaliser des économies substantielles.
Le dentiste en chef et le chirurgien maxillo-facial de la région, du territoire, de la ville et le chef du service maxillo-facial sont confrontés aux tâches suivantes pour améliorer l'état des soins aux victimes de traumatismes faciaux:
- Prévention des blessures, y compris l'identification et l'analyse des causes des blessures industrielles, en particulier dans la production agricole; participation à des mesures générales de prévention pour prévenir les blessures industrielles, de transport, de rue et sportives; prévention des blessures chez les enfants; réalisation d'un vaste travail d'explication auprès de la population, en particulier des jeunes en âge de travailler, afin de prévenir les blessures domestiques.
- Élaboration des recommandations nécessaires pour fournir les premiers soins et les premiers secours médicaux aux patients souffrant de traumatismes faciaux dans les centres de santé, les postes paramédicaux, les centres de traumatologie, les postes d'ambulance; familiarisation du personnel médical de niveau intermédiaire et des médecins d'autres spécialités avec les éléments de premiers soins et de premiers secours médicaux pour les traumatismes faciaux.
- Organisation et mise en œuvre de cycles continus de spécialisation et de formation avancée pour les dentistes, chirurgiens, traumatologues et médecins généralistes sur les questions d'assistance aux patients souffrant de blessures faciales.
- Application et développement ultérieur des méthodes les plus avancées de traitement des fractures de la mâchoire; prévention des complications, notamment de nature inflammatoire; application plus large de méthodes complexes de traitement des blessures faciales traumatiques.
- Formation du personnel médical de niveau intermédiaire aux compétences de base pour prodiguer les premiers soins aux patients souffrant de blessures au visage et à la mâchoire.
Lors de l'analyse des indicateurs de qualité des établissements dentaires, il convient également de prendre en compte la qualité des soins prodigués aux patients présentant des lésions faciales. Une attention particulière doit être portée à l'analyse des erreurs de soins. Il convient de distinguer les erreurs diagnostiques, thérapeutiques et organisationnelles, pour lesquelles il est recommandé de tenir un journal spécifique (par ville et par district).
Sélection de la méthode de repositionnement et de fixation des fragments de mâchoire dans les fractures anciennes
Selon l'ancienneté de la fracture de la mâchoire supérieure ou inférieure et le degré de rigidité des fragments, des méthodes orthopédiques ou chirurgicales sont utilisées. Ainsi, en cas de fracture du processus alvéolaire de la mâchoire supérieure avec déplacement difficile des fragments, des attelles en fil d'acier destinées à la traction squelettique sont utilisées. L'élasticité du fil facilite la réduction du fragment horizontalement et verticalement. En particulier, si un fragment de la partie frontale du processus alvéolaire est déplacé vers l'arrière, une attelle-support lisse est appliquée, fixée de manière classique aux dents de part et d'autre du trait de fracture; les dents du fragment sont fixées au fil par des ligatures dites « de suspension » avec une légère tension. Progressivement (en une seule fois ou sur plusieurs jours, selon l'ancienneté de la fracture), en resserrant le fil de ligature par torsion, le fragment du processus alvéolaire est lentement réduit. Dans le même but, vous pouvez utiliser de fins anneaux en caoutchouc qui recouvrent le col de la dent et sont fixés à l'avant sur un fil, qui dans ce cas ne doit pas nécessairement être en acier.
Si la partie latérale du processus alvéolaire de la mâchoire supérieure est déplacée vers l'intérieur, l'attelle en fil d'acier est pliée pour épouser la forme de l'arcade dentaire normale. Le fragment revient progressivement à sa position correcte par rapport à l'arcade dentaire inférieure. En cas de déplacement de la partie latérale du processus alvéolaire vers l'extérieur, elle est ajustée vers l'intérieur grâce à une traction élastique installée sur le palais dur.
En cas de raideur du fragment déplacé vers le bas du processus alvéolaire de la mâchoire supérieure, des anneaux en caoutchouc ou un bandage Shelgorn appliqués à travers la surface de l'occlusion des dents peuvent être utilisés pour la traction.
En cas de raideur des fragments de la mâchoire inférieure, une traction intermaxillaire est réalisée à l'aide de gouttières dentaires. En l'absence de dents sur les fragments de mâchoire raidis, des dispositifs de repositionnement et de fixation des fragments peuvent être utilisés, ou le repositionnement et la fixation des fragments peuvent être réalisés par voie extra-orale ou intra-orale.
Examen d'incapacité temporaire en cas de fracture de la mâchoire
Tout citoyen a droit à la sécurité financière dans la vieillesse, en cas de maladie, de perte totale ou partielle de la capacité de travail, ainsi que de perte du soutien de famille.
Ce droit est garanti par l’assurance sociale des ouvriers, des employés et des paysans, les prestations d’invalidité temporaire et de nombreuses autres formes de sécurité sociale.
La perte de capacité de travail après un accident est constatée en cas d'incapacité à effectuer un travail socialement utile sans porter atteinte à la santé et à l'efficacité de la production.
En cas de fractures de la mâchoire, une perte temporaire et permanente de la capacité de travail est possible, cette dernière étant divisée en complète et partielle.
Si les dysfonctionnements de la mâchoire empêchant l'exercice d'une activité professionnelle sont réversibles et disparaissent avec un traitement, l'invalidité est temporaire. En cas d'invalidité temporaire totale, la victime ne peut exercer aucun travail et doit suivre le traitement prescrit par le médecin. Par exemple, les patients présentant des fractures de la mâchoire en phase aiguë, accompagnées d'un syndrome douloureux intense et d'un dysfonctionnement, sont considérés comme totalement invalides temporairement.
L'incapacité temporaire partielle est prononcée lorsque la victime est incapable d'exercer sa spécialité, mais peut effectuer d'autres tâches sans risque pour sa santé, ce qui assure le repos ou une charge acceptable sur l'organe endommagé. Par exemple, un mineur de mine souffrant d'une fracture de la mâchoire inférieure avec consolidation tardive des fragments est généralement incapable d'exercer sa spécialité pendant un mois et demi à deux mois. Cependant, après la résolution des symptômes aigus un mois et demi après l'accident, sur décision du VKK, le travailleur peut être muté à des postes plus faciles (pour une durée maximale de deux mois): opérateur de treuil, chargeur dans une lampisterie, etc. En cas de mutation suite à une fracture de la mâchoire, aucun certificat d'arrêt de travail n'est délivré.
L'examen de la victime par un expert doit commencer par l'établissement d'un diagnostic précis, qui permet de déterminer le pronostic professionnel. Il arrive que, malgré un diagnostic précis, le médecin ne tienne pas compte du pronostic professionnel. Par conséquent, la victime est renvoyée prématurément au travail ou, une fois sa capacité de travail rétablie, son arrêt de travail est prolongé de manière injustifiée. Dans le premier cas, diverses complications nuisent à la santé et retardent le traitement; dans le second, des dépenses injustifiées pour le paiement des arrêts de travail sont nécessaires.
Par conséquent, le principal critère différentiel pour une perte temporaire de capacité de travail est un pronostic clinique et professionnel favorable, caractérisé par une restauration complète ou significative de la dysfonction de la mâchoire suite à un traumatisme et une capacité de travail dans un délai relativement court. La restauration de la capacité de travail en cas de fracture de la mâchoire est caractérisée par le degré de restauration de la fonction de la mâchoire endommagée, à savoir: une bonne consolidation des fragments en position correcte, le maintien d'une occlusion dentaire normale, une mobilité suffisante des articulations temporo-mandibulaires, l'absence de troubles importants de la circulation sanguine et lymphatique, de douleur et de tout autre trouble associé à une atteinte des nerfs périphériques de la région maxillo-faciale.
Une perte temporaire de capacité de travail due à une fracture de la mâchoire peut être causée par des accidents du travail ou des traumatismes domestiques. Déterminer la cause d'une perte temporaire de capacité de travail due à une fracture de la mâchoire est l'une des tâches importantes du dentiste, car il est nécessaire de résoudre des problèmes qui requièrent une compétence non seulement médicale, mais aussi juridique.
Français Une maladie est considérée comme liée à un « accident du travail » dans les cas suivants: lors de l'exécution de tâches professionnelles (y compris un voyage d'affaires pendant les heures de travail), lors de l'exécution d'une action dans l'intérêt d'une entreprise ou d'une société, bien que sans l'autorisation de celle-ci; lors de l'exécution de fonctions publiques ou d'État, ainsi que dans le cadre de l'exécution de missions spéciales d'organismes d'État, syndicaux ou autres organismes publics, même si ces missions n'étaient pas liées à l'entreprise ou à l'institution donnée; sur le territoire d'une entreprise ou d'une institution ou dans un autre lieu de travail pendant les heures de travail, y compris les pauses établies, ainsi que pendant le temps nécessaire pour ranger les outils de production, les vêtements, etc. avant le début et après la fin du travail; à proximité d'une entreprise ou d'une institution pendant les heures de travail, y compris les pauses établies, si la présence sur place n'était pas contraire aux règles de la routine établie; sur le chemin du travail ou du retour du travail; lors de l'accomplissement du devoir de citoyen de protéger la loi et l'ordre, de sauver des vies humaines et de protéger les biens de l'État.
Pour établir la cause de l'incapacité temporaire, un constat d'accident est requis. Il doit être établi rapidement et en bonne et due forme par la direction de l'entreprise où l'accident s'est produit. Le constat doit indiquer que l'accident est survenu pendant le travail, en décrire la nature, etc. En cas d'accident collectif, un constat doit être établi pour chaque victime.
Un acte ne peut être dressé si l'accident s'est produit sur le trajet du travail. Dans ce cas, il est nécessaire de présenter une attestation de l'administration des transports, un procès-verbal de police, une attestation de l'entreprise ou de l'établissement où travaille la victime, indiquant l'heure de début et de fin de son travail à cette date, ainsi qu'un certificat de domicile.
Les plus grandes difficultés surviennent lors de la détermination de la nature de la perte de capacité de travail (temporaire ou permanente), ainsi que lors de l'établissement de la date de fin de la perte temporaire de capacité de travail, qui est individuelle pour chaque patient.
Il convient de tenir compte du fait que, dans certains cas, la période d'incapacité temporaire ne correspond pas à la période pour laquelle le patient reçoit un certificat d'incapacité (par exemple, en cas d'accident domestique, etc.). Par conséquent, pour caractériser la durée moyenne d'incapacité, il est nécessaire d'indiquer précisément la période entre le moment de l'accident et le moment où la victime reprend le travail.
Les patients souffrant de fractures de la mâchoire continuent d'être traités en ambulatoire après la fin de l'hospitalisation et, jusqu'à ce que leur catégorie d'invalidité soit établie, la perte d'aptitude au travail est attestée par un certificat d'incapacité. Cependant, la durée de validité du certificat d'incapacité pour les patients ultérieurement reconnus invalides ne peut être assimilée à la durée moyenne de la perte temporaire d'aptitude au travail. Cette période, précédant le passage du patient en invalidité, est appelée à juste titre « période pré-invalidité ».
Pour déterminer la durée de l'incapacité temporaire, il est nécessaire de prendre en compte non seulement la nature de la blessure, mais aussi la profession du patient, ses conditions de travail et de vie, ainsi que le type de blessure (accident du travail, accident domestique, etc.). Ainsi, le rétablissement de la capacité de travail est plus rapide en cas de blessures sportives relativement légères; en cas d'accidents du travail ou de transport, la durée de l'incapacité temporaire est plus longue.
Pour exclure une éventuelle aggravation, des méthodes de recherche objectives telles que la palpation, la mastication, la radiographie et l’ostéométrie doivent être largement utilisées.
La durée d'incapacité de travail pour fractures de la mâchoire dépend également de la profession de la victime: pour les travailleurs psychiatriques, l'incapacité temporaire est plus courte que pour les personnes exerçant un travail physique; elles peuvent reprendre le travail 20 à 25 jours après l'accident, avec un traitement ambulatoire. En revanche, les patients dont la profession implique des tensions et des mouvements constants des muscles de la région maxillo-faciale (artistes, conférenciers, musiciens, enseignants, etc.) ne sont autorisés à reprendre le travail qu'après rétablissement complet de la fonction de la mâchoire.
La période d'incapacité temporaire est particulièrement longue pour les patients effectuant des travaux physiques lourds. Pour ces patients, l'arrêt de travail est prolongé de 2 à 3 jours après le retrait des attelles et appareils de fixation, afin de permettre une adaptation complète du processus de mastication. Une sortie prématurée du travail peut entraîner des complications (ostéomyélite, refractures de la mâchoire, etc.). De plus, ces patients sont souvent incapables d'effectuer l'intégralité des tâches de base. Par exemple, les travailleurs de l'industrie charbonnière ont une période d'incapacité temporaire plus longue que les autres professions, en raison des spécificités du travail souterrain et de la nature des blessures, souvent accompagnées de lésions des tissus mous du visage.
Chez les personnes de plus de 50 ans, la durée de la période d’incapacité temporaire augmente en raison d’un ralentissement de la consolidation.
La consolidation d'une fracture mandibulaire chez les patients atteints de parodontite dure 1,5 à 2 mois de plus. Chez les patients indemnes de parodontite, elle survient en moyenne 3 à 4 mois après la blessure. Les facteurs environnementaux doivent également être pris en compte pour déterminer la durée de la fixation et la durée de l'incapacité temporaire.
L'utilisation de méthodes extrafocales de compression pour le traitement des fractures de la mâchoire en combinaison avec des effets généraux sur le corps et le traitement de la parodontite, ainsi que des mesures orthopédiques et chirurgicales locales opportunes et rationnelles visant à repositionner et à fixer les fragments de la mâchoire, contribuent à réduire la période d'incapacité temporaire.
Si, dans la phase aiguë de la blessure, l'évaluation de l'aptitude au travail est relativement simple, plus tard, lorsque le patient développe certaines complications (retard de consolidation des fragments, contracture, ankylose, etc.), il devient difficile de déterminer la durée et le type de perte d'aptitude au travail de la victime. En fonction de la nature de la fracture, de son évolution clinique et des complications survenues, le chirurgien-dentiste doit déterminer, au moins approximativement, la durée de la perte temporaire d'aptitude au travail de la victime et établir un pronostic correct, critère déterminant pour l'établissement d'une incapacité temporaire ou permanente.
Le pronostic professionnel peut être favorable, défavorable ou incertain. Un pronostic favorable permet de rétablir l'aptitude au travail et de réintégrer la victime dans son poste précédent ou équivalent. Le pronostic est défavorable lorsque, en raison de la blessure ou de ses complications, la victime ne peut plus exercer sa spécialité et nécessite une mutation vers un autre poste adapté à son état de santé, ou lorsqu'elle est incapable d'effectuer un travail. Un pronostic incertain signifie qu'au moment de l'examen, les données nécessaires pour déterminer l'issue de la fracture de la mâchoire et la possibilité de rétablir l'aptitude au travail sont absentes. Le pronostic est parfois compliqué en cas de consolidation tardive des fractures de la mâchoire compliquées d'ostéomyélite traumatique. Dans certains cas, malgré le recours à des traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques ou autres, la fusion des fragments se poursuit et la capacité de travail est restaurée. Dans d'autres cas, malgré le traitement, des lésions osseuses se forment, entraînant une altération persistante de l'aptitude au travail.
Il convient de noter que le pronostic de l'accouchement est étroitement lié au pronostic clinique, qu'il en dépend, mais ne coïncide pas toujours avec lui. Ainsi, même en cas d'évolution clinique défavorable des fractures de la mâchoire (cal vicieux sans trouble de l'occlusion ou mâchoires édentées), le pronostic de l'accouchement peut être favorable, car il est déterminé non seulement par les modifications anatomiques, mais aussi, principalement, par le degré de restauration fonctionnelle, le développement de dispositifs compensatoires, la profession de la victime, ainsi que par d'autres facteurs.
Examen d'incapacité temporaire en cas de fractures de la mâchoire inférieure
La durée moyenne d'incapacité temporaire en cas de fracture mandibulaire est de 43,4 jours. Le temps de récupération dépend de la localisation des fractures. En cas de fractures au niveau du processus condylien et de la branche maxillaire avec un bon alignement des fragments osseux, la durée de l'incapacité temporaire est minimale (36,6 jours). Les fractures de cette localisation sont généralement fermées et non infectées.
Les principaux facteurs contribuant à une consolidation rapide sont une bonne vascularisation osseuse au niveau de la zone fracturée et la présence d'une gaine musculaire, permettant de retirer la traction intermaxillaire en caoutchouc entre le 12e et le 14e jour. Un traitement fonctionnel précoce contribue à accélérer la consolidation des fragments de mâchoire.
Le traitement des victimes de fractures et de luxations des processus condyliens de la mâchoire inférieure présente de grandes difficultés, ce qui fait que la période d'incapacité temporaire des personnes effectuant un travail physique est en moyenne de 60 jours.
Pour évaluer le degré de consolidation des fragments de mâchoire, il est utile d'utiliser l'échoostéomètre EOM-01-ts avec une fréquence d'oscillation de 120 ± 36 kHz. L'indicateur d'échoostéométrie, utilisé par exemple avec le dispositif extrafocal de VA Petrenko et al. (1987) pour le traitement des fractures du processus condylien, ne se normalise quasiment qu'au 90e jour. Il est donc évident que la période de 60 jours mentionnée, précédemment établie dans les « Recommandations méthodologiques », est sujette à justification scientifique ou à modification, notamment dans les domaines de la contamination radio-isotopique, industrielle et chimique des sols, de l'eau et des produits alimentaires.
Dans les cas de fractures de la mâchoire inférieure avec une dent dans l'espace de fracture, la durée de la période de perte temporaire de capacité de travail est significativement plus longue que dans les cas de fractures en dehors de l'arcade dentaire.
En cas de fractures centrales de la mâchoire inférieure, la période de récupération de la capacité de travail est presque la même qu'en cas de fractures localisées dans ses sections latérales (44,2 jours).
La période de récupération pour les fractures simples de la mâchoire inférieure est en moyenne de 41,2 jours, contre 44,8 jours pour les fractures doubles. Les fractures multiples de la mâchoire inférieure sont les plus graves, car elles impliquent presque toujours un déplacement important de fragments, qui peuvent faire saillie dans la cavité buccale. Ces fractures sont ouvertes et sujettes aux infections. La durée moyenne d'incapacité temporaire est de 59,6 jours.
En cas de fractures comminutives de la mâchoire inférieure, la période de récupération de la capacité de travail est un peu plus longue qu'en cas de fractures linéaires et est égale à 45,5 jours en moyenne.
Chez les patients présentant une fracture mandibulaire associée à une commotion cérébrale, la durée moyenne d'incapacité s'élève à 47,4 jours. La possibilité de sortie de l'hôpital de ces patients doit être décidée en concertation avec un neurologue.
La durée de la perte de capacité de travail dépend également des méthodes utilisées pour traiter les fractures de la mâchoire inférieure. La période de récupération de la capacité de travail chez les patients présentant des fractures de la mâchoire inférieure traitées par des méthodes non chirurgicales est en moyenne de 43,7 jours, contre 41,3 jours pour les méthodes chirurgicales. Les durées minimales de perte temporaire de capacité de travail sont observées lors du traitement des fractures de la mâchoire inférieure sans déplacement de fragments avec des coiffes en plastique autodurcissantes (26,3 jours) et un bandage en forme de fronde ZI Urbanskaya (36,7 jours). La capacité de travail des victimes ayant bénéficié d'attelles dentaires en aluminium à deux mâchoires utilisées pour le traitement des fractures de la mâchoire inférieure a été restaurée plus tardivement (après 44,6 jours).
Les principales raisons de l'augmentation de la période de récupération de la capacité de travail sont la fixation intermaxillaire à long terme sans recours à un traitement fonctionnel précoce, la mobilité relative des fragments, le traumatisme des papilles interdentaires des gencives par des attelles métalliques, le déchaussement des dents, etc.
 [ 18 ]
[ 18 ]
Examen d'incapacité temporaire en cas de fractures de la mâchoire supérieure
La durée moyenne de la période d’incapacité temporaire due à des fractures de la mâchoire supérieure est de 64,9 jours.
La durée moyenne de la période d'incapacité de travail dépend de la nature de la blessure à la mâchoire supérieure: dans le cas d'une blessure non professionnelle, elle est de 62,5 jours et dans le cas d'une blessure professionnelle, de 68,3 jours.
La durée de l'invalidité due à un accident dépend dans une certaine mesure de la gravité de l'accident. Le rétablissement de la capacité de travail après une fracture du processus alvéolaire du maxillaire survient en moyenne en 43,6 jours, et en cas de fracture du corps du maxillaire, la durée moyenne d'invalidité est de 69,9 jours; selon le type Le Fort I: 56,0 jours, selon le type Le Fort II: 65,4 jours et selon le type Le Fort III: 74,7 jours.
Dans les fractures non compliquées de la mâchoire supérieure, la période d'incapacité de travail est en moyenne de 60,1 jours et dans les fractures compliquées de 120 à 130 jours.
L'une des caractéristiques des fractures maxillaires est leur caractère combiné, dû à la proximité anatomique des parties faciale et cérébrale du crâne. Les lésions traumatiques des os du crâne et du cerveau ne sont pas toujours diagnostiquées par les dentistes, ce qui nuit au traitement des patients.
Les durées d'incapacité temporaire varient selon qu'il s'agit de fractures isolées ou combinées de la mâchoire supérieure. Ainsi, pour une fracture de la mâchoire supérieure associée à une commotion cérébrale, elles sont de 70,8 jours; en cas de fracture de la mâchoire inférieure, la durée moyenne d'incapacité est de 73,3 jours; pour une fracture de la base du crâne, de 81,0 jours; pour une fracture de la voûte crânienne, de 126,7 jours; pour une lésion de l'orbite, de 120,5 jours; et pour une fracture d'autres os, de 89,5 jours.
Les fractures multiples des os du visage, du crâne et du tronc entraînent une invalidité temporaire pouvant aller jusqu’à 87,5 jours.
La durée de l'incapacité temporaire dépend également des méthodes de traitement des fractures de la mâchoire supérieure. En cas de traitement orthopédique, la durée moyenne de l'incapacité temporaire est de 59,2 jours (55,4 pour les fractures simples et 116,0 pour les fractures compliquées), et de 76,0 jours (69,3 pour les fractures simples et 153,5 pour les fractures compliquées) en cas de traitement chirurgical.
La période plus longue d’incapacité temporaire avec les méthodes chirurgicales de traitement des fractures est due au fait qu’elles sont utilisées pour les blessures les plus graves, lorsque les méthodes orthopédiques ne sont pas indiquées ou inefficaces.
 [ 19 ]
[ 19 ]
Enregistrement d'une incapacité temporaire
Un dentiste est autorisé à délivrer un arrêt maladie à un patient souffrant d'une fracture de la mâchoire pour une durée maximale de six jours. Les commissions de contrôle médical (MCC) sont habilitées à prolonger l'arrêt maladie pour une durée plus longue (jusqu'à 10 jours consécutifs pour les patients blessés), mais en général pas plus de quatre mois à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, les personnes qui autorisent la prolongation de l'arrêt maladie sont tenues d'examiner personnellement le patient. En cas d'évolution prolongée de la maladie, ces examens doivent être effectués au moins une fois tous les 10 jours, et si nécessaire beaucoup plus souvent, surtout dans les premiers temps suivant l'accident.
En cas de perte de capacité de travail suite à un accident du travail, le médecin délivre un certificat d'incapacité de travail, qui est un document confirmant l'incapacité temporaire de travail et donnant droit à la personne lésée à percevoir des prestations d'assurance sociale.
En cas d'incapacité de travail due à un accident domestique, l'établissement médical délivre un certificat d'incapacité de travail de cinq jours, puis un certificat d'incapacité à partir du sixième jour. Si la personne accidentée consulte le médecin le jour même de son retour au travail, celui-ci délivre, si nécessaire, un certificat d'incapacité de travail daté du jour de la demande, mais ne libère la personne accidentée du travail qu'à compter du lendemain.
Les patients souffrant de fractures de la mâchoire et traités à l'hôpital reçoivent un certificat d'arrêt de travail à leur sortie, mais en cas de séjour prolongé à l'hôpital, un certificat d'incapacité de travail peut être délivré avant la sortie afin de percevoir un salaire.
Si le patient retrouve sa capacité de travail suite à une hospitalisation, son arrêt de travail est clôturé. Si, à sa sortie, le patient reste inapte au travail en raison des conséquences de la fracture, son arrêt de travail n'est pas clôturé à l'hôpital, mais une mention y est inscrite concernant la nécessité d'une prise en charge ambulatoire. Par la suite, l'arrêt de travail est prolongé par le dentiste de l'établissement de médecine préventive où le patient poursuit son traitement. Il est à noter que les personnes ayant subi une blessure due à une intoxication ou à des actes liés à une intoxication et nécessitant une prise en charge ambulatoire ou hospitalière ne bénéficient pas d'un arrêt de travail.
La décision de remettre un patient au travail ou de l'orienter vers le centre de réadaptation professionnelle (CRP) en cas de fracture simple ou compliquée de la mâchoire supérieure est prise en fonction du pronostic clinique et professionnel. Si, malgré toutes les mesures thérapeutiques, le pronostic clinique et professionnel reste défavorable et que l'altération de la capacité de travail persiste, le patient doit être orienté vers le CRP afin de déterminer le groupe d'invalidité, par exemple en cas de fracture de la mâchoire inférieure compliquée d'ostéomyélite avec formation ultérieure d'un important défaut osseux, ou en cas de nécessité de chirurgies ostéoplastiques restauratrices. Dans ce cas, la détermination rapide du groupe d'invalidité et la libération du patient permettent la mise en œuvre d'un ensemble complet de mesures thérapeutiques pour rétablir la santé de la victime, après quoi elle peut reprendre son activité professionnelle dans sa spécialité ou dans une autre. Le certificat d'incapacité de travail est clôturé le jour de la délivrance de la conclusion du CRP constatant l'invalidité, quelles que soient ses causes et son groupe.
L’emploi rationnel des personnes handicapées est d’une grande importance, car un travail réalisable contribue à une restauration ou une compensation plus rapide des fonctions altérées, améliore l’état général des personnes handicapées et augmente leur sécurité matérielle.
Parfois, des maladies concomitantes, qui n'entraînent pas en elles-mêmes une altération significative de la capacité de travail, aggravent l'état du patient et, associées à la maladie principale, entraînent une altération fonctionnelle plus prononcée. Par conséquent, lors de l'examen de la capacité de travail dans de tels cas, une extrême prudence et une approche critique sont nécessaires afin d'évaluer correctement l'importance de ces changements dans la réduction ou la perte de la capacité de travail.

