Expert médical de l'article
Nouvelles publications
Paralysie spastique
Dernière revue: 04.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.
Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.
Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.
La paralysie se divise en deux grands groupes: la paralysie spastique et la paralysie flasque. La spasticité résulte d'une lésion de la moelle épinière dans la région cervicale ou thoracique et est également caractéristique de la plupart des cas de paralysie cérébrale. La paralysie est également classée selon le degré de lésion. On distingue la paralysie partielle, appelée parésie, et la paralysie complète, appelée plégie.
Épidémiologie
Causes paralysie spastique
Il s'agit d'une conséquence d'une pathologie des motoneurones. Les faisceaux pyramidaux étant très proches les uns des autres, la paralysie touche souvent l'ensemble du membre, ou tout le côté gauche ou droit du corps. La paralysie périphérique touche généralement certains muscles ou un groupe de muscles. Cependant, ces règles connaissent des exceptions. Par exemple, une petite lésion située dans le cortex cérébral peut entraîner une paralysie de la paume, des muscles faciaux, etc.; et, inversement, des lésions importantes des fibres nerveuses peuvent entraîner une paralysie périphérique étendue.
De plus, les lésions cérébrales et la sclérose en plaques sont des causes fréquentes de paralysie. La principale cause de paralysie spastique est une perturbation de la transmission des signaux nerveux, entraînant une hypertonie musculaire.
La spasticité peut également être la conséquence d’autres troubles et maladies:
- Dysfonctionnement cérébral dû à l’hypoxie;
- Maladies infectieuses du cerveau (encéphalite, méningite);
- Sclérose latérale amyotrophique;
- Facteur héréditaire. Il s'agit de la paralysie spastique familiale de Strumpell, une maladie lente, héréditaire et évolutive. Le système nerveux se dégrade progressivement, les faisceaux pyramidaux de la moelle épinière étant touchés. Ce type de paralysie doit son nom à A. Strumpell, qui a identifié le caractère familial de la maladie. Dans la littérature médicale, elle est également connue sous le nom de « paraplégie spastique familiale d'Erb-Charcot-Strumpell ».
Facteurs de risque
Les facteurs de risque qui augmentent la probabilité de développer une paralysie in utero ou pendant l’accouchement sont identifiés séparément:
- Faible poids à la naissance et naissance prématurée;
- Grossesse multiple;
- Infections contractées pendant la grossesse;
- Incompatibilité rhésus des groupes sanguins;
- Intoxication (par exemple, exposition au méthylmercure);
- Dysfonctionnement thyroïdien maternel;
- Complications lors de l'accouchement;
- Faibles scores d’Apgar;
- Jaunisse;
- Crampes.
Symptômes paralysie spastique
Outre les troubles de la fonction motrice, la paralysie spastique s'accompagne dans presque tous les cas d'autres troubles, notamment des troubles de la conscience, de la vision, de l'audition, de la parole, de l'attention et du comportement.
Le premier signe de paralysie et le principal facteur empêchant le rétablissement des fonctions motrices est la spasticité. Elle se manifeste par une hypertonie et des contractions involontaires des muscles affectés. Les contractions se produisent dans les muscles auparavant contrôlés consciemment. Dans les premiers temps suivant une blessure ou une maladie, la moelle épinière est en état de choc et les signaux du cerveau ne transitent pas par cette zone. Les réflexes tendineux ne sont pas détectés. Lorsque la réaction de choc se dissipe, ils reprennent, mais la fonction est souvent altérée.
Les muscles sont tendus et denses; lors des mouvements passifs, une résistance est ressentie, parfois surmontée par l'effort. Cette spasticité est due à un tonus réflexe élevé et sa répartition est inégale, ce qui entraîne des contractures typiques. Cette paralysie est facile à reconnaître. Habituellement, un bras est plaqué contre le corps et plié au niveau du coude, la main et les doigts le sont également. La jambe est tendue, seul le pied est fléchi et l'orteil est pointé vers l'intérieur.
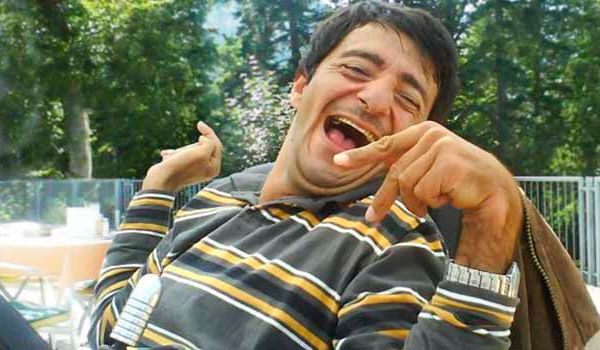
L'hyperréflexie est un autre signe d'hyperactivité médullaire. La fonction réflexe des tendons est fortement augmentée, ce qui se manifeste par la moindre irritation: la zone réflexe s'élargit, le réflexe étant déclenché à la fois par la zone habituelle et par les zones adjacentes. Les réflexes tendineux et cutanés, en revanche, s'affaiblissent, voire disparaissent complètement.
Des mouvements associés (également appelés syncinésies) peuvent survenir involontairement dans les bras et les jambes affectés, par exemple lors de la contraction de muscles sains. Ce phénomène s'explique par la tendance des impulsions de la moelle épinière à se propager aux segments voisins, normalement limités par le travail du cortex cérébral. Dans la paralysie spastique, les impulsions se propagent avec une force accrue, ce qui entraîne l'apparition de contractions involontaires supplémentaires dans les muscles affectés.
Les réflexes pathologiques sont les symptômes clés et permanents de la paralysie cérébrale spastique. Les réflexes du pied sont particulièrement importants dans la paralysie spastique des jambes: les symptômes de Babinski, Rossolimo et Bekhterev sont fréquents. D'autres réflexes pathologiques du pied sont moins fréquents. Ces phénomènes ne sont pas aussi prononcés sur les bras paralysés et, par conséquent, il n'existe aucune donnée à leur sujet. Les réflexes pathologiques des muscles faciaux indiquent une lésion bilatérale du cortex, du tronc cérébral ou de la région sous-corticale.
Diagnostics paralysie spastique
Dans le diagnostic différentiel de la paralysie spastique, les symptômes et les résultats des tests et des études sont pris en compte.
Lors de la consultation, le neurologue examine le patient: il est attentif à la position du corps, aux fonctions motrices, à la tension musculaire et vérifie les réflexes.
Pour exclure d’autres affections présentant les mêmes symptômes – une tumeur cérébrale ou une dystrophie musculaire – des études sont réalisées à l’aide de diagnostics instrumentaux et de laboratoire:
- Analyses de sang;
- Radiographie du crâne;
- Tomodensitométrie de la tête et de la colonne vertébrale;
- Imagerie par résonance magnétique du cerveau et de la colonne vertébrale;
- Neurosonographie.
Traitement paralysie spastique
Les myorelaxants éliminent l'hypertonie musculaire. Selon leur mécanisme d'action, on distingue les myorelaxants centraux et périphériques. La pratique montre que l'utilisation de myorelaxants entraîne souvent des effets indésirables et des complications. Parmi les myorelaxants qui agissent sur le système nerveux central et sont souvent utilisés pour soulager les symptômes de la paralysie spastique, on trouve le baclofène, le sirdalud et le diazépam.
Le baclofène est similaire à l'acide gamma-aminobutyrique, impliqué dans l'inhibition présynaptique des signaux. Ce médicament supprime les réflexes synaptiques et la fonction des récepteurs efférents gamma. Il franchit facilement la barrière hémato-encéphalique. Son efficacité est optimale dans les formes spinales de spasticité: il élimine non seulement l'hypertonie et les spasmes des muscles moteurs, mais a également un effet bénéfique sur le fonctionnement des organes pelviens. En cas de troubles cérébraux, le baclofène peut affecter la capacité de concentration et de mémorisation. Chez l'adulte, la posologie est de 10 à 15 mg par jour, divisée en 2 ou 3 prises. La posologie est ensuite augmentée progressivement de 5 à 15 mg jusqu'à l'obtention de l'effet souhaité. La posologie varie généralement de 30 à 60 mg par jour. Les effets secondaires possibles du baclofène (perte de force, hypotension artérielle, ataxie) disparaissent avec la réduction de la posologie. La posologie doit être réduite progressivement: un sevrage brutal peut provoquer des convulsions et des hallucinations. Il n’existe aucune étude sur la sécurité de l’utilisation du baclofène pour traiter la paralysie infantile, il est donc prescrit aux enfants avec une extrême prudence.
Le sirdalud (tizanidine) agit sélectivement sur les voies polysynaptiques de la moelle épinière. Il réduit la production d'acides aminés excitateurs, diminuant ainsi la fréquence des signaux excitateurs transmis aux neurones de la moelle épinière. En termes d'efficacité antihypertonique, le sirdalud est similaire au baclofène, mais il est bien mieux toléré et donne des résultats dans le traitement de la paralysie spastique centrale et de la paralysie spinale. Chez l'adulte, une dose maximale de 2 mg par jour (divisée en 2 à 3 prises) est prescrite, avec une augmentation supplémentaire à 12-14 mg (divisée en 3 à 4 prises). Des effets secondaires peuvent survenir pendant le traitement par sirdalud: légère baisse de la tension artérielle, perte de force, troubles du sommeil.
Le diazépam (ou Valium) atténue les effets de l'acide gamma-aminobutyrique, responsable de l'inhibition présynaptique des signaux et de la suppression des réflexes spinaux. La principale raison pour laquelle le diazépam n'est pas largement utilisé est son effet sédatif notable et son impact négatif sur les fonctions cognitives. Son utilisation commence par une dose de 2 mg par jour, puis augmente progressivement jusqu'à 60 mg par jour, répartis en 3 à 4 prises.
Le dantrolène est un relaxant musculaire efficace dans le traitement de la spasticité d'origine spinale. Ce médicament agit sur le complexe actine-myosine, responsable de la contraction musculaire. Comme le dantrolène réduit la libération de calcium par le réticulum sarcoplasmique, la contractilité du tissu musculaire est réduite. Le dantrolène n'interfère pas avec les mécanismes spinaux qui régulent la tension musculaire. Son effet est plus marqué sur les fibres musculaires, atténuant les réflexes phasiques et les réflexes toniques.
Il donne les meilleurs résultats dans le traitement de la spasticité d'origine cérébrale (paralysie après un accident vasculaire cérébral, paralysie cérébrale) et a peu d'effet sur les fonctions cognitives. Le médicament est administré à faible dose – 25 à 50 mg par jour – puis augmenté à 100 à 125 mg. Les conséquences et complications liées à la prise de dantrolène sont: perte de force, vertiges et nausées, troubles digestifs. Dans 1 cas sur 100, les patients présentent des signes d'atteinte hépatique; le dantrolène ne doit donc pas être pris en cas d'hépatopathie chronique. Ce médicament est également contre-indiqué en cas d'insuffisance cardiaque.
Le choix du médicament pour le traitement de la paralysie spastique est déterminé par l'origine de la maladie, le degré d'hypertonie musculaire et le mécanisme d'action spécifique de chaque médicament.
En plus des médicaments décrits, il est également recommandé de prendre des médicaments renforçants généraux: vitamines B, médicaments métaboliques et médicaments qui activent la circulation sanguine.
Traitement de physiothérapie
Les méthodes physiothérapeutiques courantes incluent l'application locale de froid ou, au contraire, de chaud, ainsi que la stimulation électrique des nerfs périphériques.
L'application locale de froid contribue à réduire les réflexes tendineux hypertrophiés, à augmenter la mobilité articulaire et à améliorer le travail des muscles antagonistes. Une compresse froide réduit temporairement l'hypertonie, probablement en raison d'une diminution temporaire de la sensibilité des récepteurs cutanés et d'un ralentissement de la conduction nerveuse. Un résultat similaire est obtenu avec des anesthésiques locaux. Pour un effet optimal, des applications de glace sont appliquées pendant 20 minutes ou plus. Le traitement comprend 15 à 20 séances.
L'application locale de chaleur vise également à réduire l'hypertonie musculaire. Pour ce faire, on utilise de la paraffine ou de l'ozokérite, appliquées sous forme de larges bandes, de gants ou de chaussettes. Le patient doit alors adopter une position permettant d'étirer au maximum le muscle affecté. La température de l'ozokérite ou de la paraffine doit être comprise entre 48 et 50 degrés, et la durée d'application est de 15 à 20 minutes. La durée du traitement est de 15 à 20 applications. Lors d'applications chaudes chez des patients sujets à l'hypertension artérielle, la tension artérielle doit être surveillée.
La stimulation électrique a été utilisée pour la première fois pour traiter la spasticité il y a environ 150 ans. Aujourd'hui, l'application superficielle, sous-cutanée, épidurale d'électrodes, voire l'implantation, sont utilisées pour soulager l'hypertonie musculaire. La stimulation électrique des nerfs périphériques est généralement utilisée pour la paralysie spastique des jambes en position debout, à la marche et pendant l'activité physique. La stimulation électrique superficielle est efficace dans le traitement des patients paralysés suite à un accident vasculaire cérébral.
Le mécanisme de la stimulation électrique s'explique par la modulation des neurotransmetteurs au niveau de certaines zones. Le tonus diminue pendant une courte période, littéralement plusieurs heures. Les paramètres de stimulation électrique sont sélectionnés en fonction des causes, de la localisation de la lésion et du stade de la paralysie. En cas de spasticité, l'électrogymnastique des muscles antagonistes est recommandée: l'impact sur les muscles spastiques peut entraîner un tonus encore plus fort. La stimulation électrique est généralement réalisée à l'aide de courants à haute fréquence: les courants à basse fréquence irritent fortement la peau et peuvent être douloureux, ce qui augmente également l'hypertonicité.
Massage
Le massage spécial pour la paralysie spastique vise à détendre les muscles au maximum grâce à une hypertonicité. Par conséquent, les techniques de massage se limitent à des effleurages, des secousses et un échauffement doux et lent. Les techniques aiguës, douloureuses, au contraire, augmentent le tonus. Outre le massage classique, des techniques de massage par points sont utilisées. La technique de freinage de ce type de massage consiste à augmenter progressivement la pression des doigts sur certains points. Lorsque la pression optimale est atteinte, le doigt est maintenu un certain temps, puis la pression est progressivement réduite jusqu'à l'arrêt complet. Le travail sur chaque point dure de 30 à 90 secondes.
Physiothérapie
La kinésithérapie pour la paralysie spastique consiste en des exercices visant à détendre les muscles, à supprimer la syncinésie pathologique et à développer l'extensibilité des muscles affectés. Des étirements musculaires modérés contribuent à réduire temporairement l'hypertonie et à améliorer la mobilité articulaire. Le mécanisme de cet effet de ces exercices n'a pas été entièrement étudié. Il est probable que ces exercices affectent les caractéristiques mécaniques de l'appareil musculo-tendineux et la modulation de la transmission synaptique. Le tonus diminue temporairement; le kinésithérapeute s'efforce donc d'exploiter au maximum cette période pour travailler les mouvements limités par la spasticité.
La physiothérapie pour la paralysie spastique a ses propres caractéristiques:
- la séance doit être suspendue si le tonus musculaire augmente au-dessus du niveau initial;
- pour éviter la syncinésie, le travail sur les mouvements combinés, où plus d'une articulation est impliquée, n'est effectué que lorsque des mouvements clairs dans une articulation distincte ont été obtenus (il est d'abord développé dans une direction et un plan, à l'étape suivante - dans des directions différentes);
- mise en œuvre de la règle des volumes «partiels» - le travail sur le muscle au stade initial est effectué dans la zone de petites amplitudes, et ce n'est que lorsque le muscle est suffisamment fort que l'amplitude est augmentée au niveau physiologique;
- la transition la plus précoce possible du développement musculaire « abstrait » au développement des compétences nécessaires à la vie quotidienne;
- Pendant les exercices, la respiration est surveillée: elle doit être régulière, sans difficulté ni essoufflement.
Si vous enseignez au patient des exercices d’entraînement autogène et introduisez ces éléments dans une séance d’exercices thérapeutiques, vous obtiendrez le meilleur résultat.
Homéopathie
Il est conseillé d'utiliser des préparations homéopathiques pendant la période de convalescence. Elles contribueront à rétablir la conduction nerveuse et le fonctionnement des organes pelviens. Les préparations sont sélectionnées par l'homéopathe en tenant compte de l'état du patient, de l'étendue des lésions et des maladies concomitantes.
Les médicaments les plus couramment utilisés sont:
- Lachesis active la circulation sanguine cérébrale. Ce médicament est particulièrement efficace dans les accidents vasculaires cérébraux (AVC) avec manifestations du côté gauche.
- Bothrops active également la circulation cérébrale, combat les caillots sanguins et est efficace en cas de paralysie du côté droit.
- Lathyrus sativus est indiqué en cas de démarche spastique, lorsque les genoux se heurtent en marchant et qu'il n'est pas possible d'adopter une position avec les jambes croisées ou, au contraire, étendues en position assise.
- Nux vomica améliore la conduction des impulsions cérébrales et montre des résultats notables en cas de paralysie spastique des jambes. Il a également un effet bénéfique sur le fonctionnement des organes pelviens.
Traitement chirurgical
Si les autres traitements se révèlent inefficaces, la possibilité d'améliorer les fonctions motrices du patient par chirurgie est envisagée. Plusieurs facteurs sont pris en compte dans la décision d'intervention chirurgicale:
- Depuis combien de temps le système nerveux est-il affecté? Le traitement chirurgical n'est envisagé que si toutes les méthodes de restauration des fonctions motrices ont été épuisées (au plus tôt six mois après un AVC et un ou deux ans après une lésion cérébrale).
- La spasticité peut être de deux types: dynamique ou statique. Dans la spasticité dynamique, le tonus musculaire augmente lors des mouvements (par exemple, le croisement des jambes lors de la marche chez les personnes atteintes de paralysie cérébrale). La spasticité statique résulte d'une augmentation prolongée du tonus musculaire, entraînant la formation de contractures, aussi prononcées au repos qu'en mouvement. Parfois, pour déterminer la nature de la spasticité, il est nécessaire de recourir à des blocages nerveux anesthésiques.
- Sensibilité du membre, degré de déformation. Une opération du bras ou de la jambe peut être inefficace si le patient présente des troubles évidents de la capacité à effectuer des mouvements intentionnels.
- Lésions du système musculo-squelettique (fractures, luxations, arthrite). Si ces affections ne sont pas prises en compte, le pronostic favorable d'une intervention chirurgicale peut être compromis.
Remèdes populaires
La médecine traditionnelle dispose de ses propres moyens pour traiter la spasticité:
- Une cuillère à café de racines de pivoine broyées est infusée dans un verre d'eau bouillante. Au bout d'une heure, la décoction est prête. Filtrez-la et buvez-en une cuillère à soupe jusqu'à 5 fois par jour.
- Huile de laurier. Pour la préparer, versez 30 g de feuilles de laurier dans 200 g d'huile de tournesol et laissez infuser dans un endroit chaud pendant 55 à 60 jours. Filtrez ensuite l'huile et portez-la à ébullition. Appliquez cette huile quotidiennement sur les zones concernées.
- Le thé vert, s’il est infusé correctement, aide à récupérer d’une paralysie due à un accident vasculaire cérébral.
- Une décoction de racines de cynorhodon est préparée pour les bains. Une cure complète comprend 20 à 30 bains.
Les muscles paralysés sont traités avec une pommade volatile. Sa préparation est très simple: un mélange d'alcool et d'huile de tournesol dans un rapport de 1:2. L'éther peut également être utilisé pour la préparation, mais il faut savoir qu'il s'enflamme facilement.
 [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ]
[ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ]
Traitement à base de plantes
- L'infusion est préparée à partir de fleurs de camomille (2 parts), de mélisse (1 part), de cônes de houblon (1 part) et de racine d'absinthe (1 part). Boire 100 ml d'infusion trois fois par jour, une demi-heure avant les repas.
- Infusion de fleurs d'arnica des montagnes. Pour cela, versez 1 cuillère à café de fleurs dans un verre d'eau bouillante, laissez infuser et filtrez. Buvez 1 cuillère à soupe d'infusion 3 fois par jour. L'arnica réduit l'excitabilité et soulage la douleur et les crampes.
- Les fleurs d'acacia blanc sont utilisées pour préparer une teinture alcoolisée. On en frictionne les muscles affectés. Pour préparer la teinture, il vous faudra 4 cuillères à soupe de fleurs et 200 ml de vodka. Au bout d'une semaine, filtrez la teinture et buvez 1 cuillère à café 3 fois par jour.
L'inclusion de remèdes populaires dans le traitement n'est possible qu'avec l'accord du médecin traitant. Il est déconseillé de prendre des décisions personnelles: la paralysie spastique est une maladie grave qui nécessite une approche thérapeutique globale pour restaurer les fonctions motrices. Si les médecins, les proches et le patient lui-même mettent tout en œuvre, une guérison complète ou une restauration partielle des fonctions perdues est souvent possible.
La prévention
La principale mesure de prévention de la paralysie spastique est la prévention des maladies entraînant de telles conséquences et complications. Il s'agit en premier lieu des maladies cardiovasculaires: la paralysie consécutive à un accident vasculaire cérébral est le cas le plus fréquent.

