Expert médical de l'article
Nouvelles publications
Syndrome de sevrage du phénazépam.
Dernière revue: 07.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.
Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.
Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.
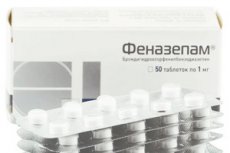
Le phénazépam est l'un des tranquillisants les plus populaires, souvent prescrit par les médecins pour les troubles anxieux et les crises de panique. Un médicament aussi nécessaire pour calmer l'agitation nerveuse peut-il provoquer le processus inverse et une grave détérioration de la santé? En cas de prise régulière, rien de grave ne se produit, mais une utilisation prolongée ou un dépassement de dose peut entraîner une dépendance, et l'arrêt du traitement provoque un phénomène très désagréable et douloureux: le syndrome de sevrage du phénazépam. Ce syndrome ressemble à bien des égards aux symptômes de sevrage observés chez les toxicomanes à l'arrêt de la consommation, car les tranquillisants appartiennent à la catégorie des psychotropes, avec tous les effets secondaires caractéristiques de ce groupe.
Essayons de comprendre s'il est toujours nécessaire de prendre du phénazépam et d'autres tranquillisants pour les troubles neuropsychiatriques. Si le médicament est prescrit par un médecin, comment le prendre correctement pour ne pas se nuire et ne pas provoquer de dépendance? Que faire si la dépendance aux tranquillisants est déjà installée et que le refus d'un médicament dangereux menace de problèmes de santé, réels ou imaginaires?
Sevrage des tranquillisants
En ces temps troublés, rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir les nerfs solides. Une écologie défaillante, un rythme de vie effréné, le désir de réussir professionnellement par tous les moyens entraînent, avec le temps, l'apparition de symptômes de mal-être: fatigue physique et émotionnelle, même insuffisamment soulagée par le sommeil, insomnie, nervosité, maux de tête et vertiges, fluctuations de la tension artérielle, anxiété et peur de l'avenir.
Tout cela entraîne une diminution de la capacité de travail et la recherche d'une solution pour la restaurer. Conscients qu'il est avant tout nécessaire de calmer les nerfs, nombreux sont ceux qui cherchent à se calmer grâce aux médicaments, les plus populaires étant les sédatifs et les antidépresseurs. Viennent ensuite les tranquillisants, dont l'effet est complexe: leur prise est plus forte que celle des autres sédatifs.
Peu de gens savent que les tranquillisants sont des médicaments dont l'utilisation n'est recommandée que dans les cas graves, lorsque les autres sédatifs et neuroleptiques ne sont pas efficaces. Cependant, la durée du traitement avec ces médicaments est strictement limitée à 3-4 semaines (sur prescription médicale, maximum 2 mois dans les situations particulièrement graves), mais dans la plupart des cas, ils sont prescrits à titre symptomatique pour soulager l'anxiété et la peur de la mort.
Que sont les tranquillisants, et plus particulièrement le phénazépam? Ce sont des psychotropes dont l'effet bénéfique repose sur leur action sur les centres nerveux du cerveau. Les tranquillisants ont un effet inhibiteur sur le système nerveux central, favorisant la relaxation neuromusculaire. Résultat: une sensation de calme et de sérénité, des émotions qui passent au second plan, et une somnolence et une apathie qui apparaissent. Ces effets contribuent à atténuer l'impact négatif du stress, à réduire l'anxiété et l'irritabilité, à rétablir le calme émotionnel et à favoriser un sommeil réparateur.
Les tranquillisants ont les effets bénéfiques suivants:
- anxiolytique, c'est-à-dire réduction de l'anxiété, de la peur, de la tension émotionnelle,
- sédatif (calme les nerfs et réduit également l'anxiété et l'agitation),
- somnifère (l'insomnie disparaît et le processus d'endormissement s'améliore, rétablissant une nuit de repos complète),
- anticonvulsivant (empêche la propagation des impulsions convulsives),
- relaxant musculaire (favorise la relaxation des muscles lisses, inhibe les réactions des nerfs moteurs).
Malgré tous les bienfaits des tranquillisants, ces médicaments présentent de nombreux effets secondaires et contre-indications. Prenons l'exemple du phénazépam.
Le phénazépam étant considéré comme un psychotrope inhibant les processus mentaux du système nerveux, il est le premier à en souffrir. Les patients peuvent ressentir de la somnolence, des troubles de la concentration et de la coordination des mouvements, des maux de tête, de la faiblesse, de la fatigue, une altération de la prononciation des sons et des mots due à un affaiblissement de la régulation nerveuse de l'appareil articulaire (dysarthrie), des pertes de mémoire, etc. De plus, les symptômes existants d'anxiété, d'irritabilité et d'insomnie peuvent parfois s'intensifier, et des hallucinations et des envies suicidaires peuvent apparaître.
Les tranquillisants peuvent modifier la composition sanguine, se manifestant par une faiblesse, de la fièvre, une coloration de la peau, des maux de tête, etc. Ils peuvent perturber la fonction hépatique et altérer le système digestif, provoquer une incontinence urinaire ou une rétention urinaire, perturber la fonction rénale et affecter la libido. Les femmes peuvent ressentir des douleurs menstruelles lors de la prise de phénazépam.
D’autres effets secondaires incluent une diminution de la pression artérielle (hypotension), une augmentation du rythme cardiaque (tachycardie), une vision double (diplopie), etc.
Tous les symptômes mentionnés ci-dessus peuvent survenir à une fréquence variable et il est impossible de prédire leur apparition. Leur probabilité d'apparition peut être réduite en respectant les doses recommandées (elles peuvent varier selon les troubles, une consultation médicale est donc indispensable) et en respectant la durée du traitement. Ces mêmes mesures contribueront à prévenir une situation plus désagréable et dangereuse: le syndrome de sevrage du phénazépam, également caractéristique d'autres tranquillisants. Ce syndrome survient à l'arrêt de la prise des psychotropes mentionnés ci-dessus. À la reprise du traitement, les symptômes du syndrome de sevrage disparaissent. Cependant, une utilisation prolongée de tranquillisants peut avoir des effets négatifs sur l'état physique et mental, entraînant des changements de personnalité, une altération des capacités cognitives (attention, mémoire, etc.), une perte de contrôle sur son comportement et une inadaptation sociale, des troubles du sommeil, l'apparition de phobies, une baisse de performance, des pensées suicidaires, etc.
Existe-t-il une alternative?
Lorsque l'état psycho-émotionnel et physique commence à affecter négativement les relations familiales, amicales et professionnelles, devient un obstacle aux études et au travail, et empêche d'atteindre ses objectifs, une personne souhaite par tous les moyens retrouver sa capacité de travail et sa santé. On ne peut pas lui en vouloir, mais il faut choisir judicieusement les médicaments pour rétablir un état psycho-physique normal.
Les tranquillisants sont des médicaments puissants, et leur prise n'est pas toujours nécessaire. Les sédatifs et les antidépresseurs peuvent calmer les nerfs autant que les tranquillisants, et les neuroleptiques sont excellents pour corriger les troubles végétatifs et les fonctions cognitives. Parallèlement, les médicaments mentionnés ci-dessus ont un effet thérapeutique, tandis que de nombreux médecins classent les tranquillisants comme des médicaments symptomatiques qui ne traitent pas, mais soulagent seulement les symptômes désagréables.
Les antidépresseurs et les neuroleptiques sont-ils sûrs? Soyons honnêtes, il ne faut pas négliger les groupes de médicaments mentionnés ci-dessus. Prenons l'exemple des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, l'un des antidépresseurs les plus sûrs et présentant un minimum d'effets secondaires. Examinons leurs effets sur l'homme, en nous basant sur le Cipralex.
Ce médicament augmente la concentration de l'« hormone du bonheur », l'un des principaux neurotransmetteurs (sérotonine), ce qui permet de soulager l'anxiété et l'irritabilité, d'améliorer l'humeur et le sommeil, etc. Cependant, l'utilisation prolongée de ces médicaments (surtout lorsque les doses recommandées sont dépassées) peut avoir l'effet inverse ou empêcher l'organisme de produire lui-même le neurotransmetteur indispensable au maintien de l'équilibre psychoémotionnel, ce qui peut entraîner une dépendance. À l'arrêt de l'antidépresseur, le patient ressentira un syndrome de sevrage similaire à celui observé après l'arrêt des tranquillisants.
Concernant les neuroleptiques, ces médicaments antipsychotiques (par exemple, le chlorprothixène) bloquent les récepteurs de la dopamine. Par conséquent, la production de dopamine, un neurotransmetteur responsable du désir sexuel et de l'amour, affecte la motivation et l'attention, et favorise la réalisation d'objectifs. Tous ces moments sont associés à certaines expériences, à la tension nerveuse et au manque de sommeil. Réduire la production de dopamine permet de retrouver calme, équilibre et de se reposer et de se détendre normalement.
Certains troubles mentaux (schizophrénie, trouble bipolaire) sont associés à des taux élevés de dopamine. Par conséquent, pour stabiliser ces patients, il est essentiel de réduire la production de ce neurotransmetteur. En cas de dépression, de sevrage, d'épilepsie, de retard mental, d'états anxieux et de crises de panique, ces médicaments sont prescrits avec la plus grande prudence, car une baisse du taux de dopamine dans ces situations ne peut qu'aggraver l'état du patient. Par conséquent, ils sont prescrits de manière symptomatique (une seule fois) ou en cure courte.
Lorsqu'on parle d'antidépresseurs et de neuroleptiques, on parle de médicaments puissants destinés au traitement de maladies graves (dépression, psychose, troubles autonomes et paniques, syndrome de sevrage, épilepsie et oligophrénie associées à des troubles mentaux, etc.). Cette liste inclut les troubles autonomes, dont le plus fréquent est le dysfonctionnement autonome somatoforme du système nerveux, plus connu sous le nom de dystonie végétative-vasculaire (DVV).
VSD – qu'est-ce que c'est? Les médecins peuvent poser ce diagnostic chez plus de 80 % de la population de notre pays, mais tout le monde ne sait pas ce qu'est ce trouble de santé ni comment le traiter.
Le syndrome de VSD est considéré comme l'une des maladies humaines les plus étranges et les plus ambiguës, avec de multiples symptômes réels et imaginaires. Il est important de comprendre que le complexe symptomatique associé au syndrome de VSD est une manifestation secondaire de maladies mentales ou somatiques préexistantes, de lésions cérébrales organiques et de troubles hormonaux (souvent observés chez les adolescents). Ainsi, le syndrome de VSD est une conséquence de maladies préexistantes, ce qui explique la diversité de ses symptômes.
L'anxiété et la tension nerveuse qu'elle provoque sont parmi les manifestations les plus fréquentes de la dystonie végétative-vasculaire. Par conséquent, ces patients ont tendance à inventer des maladies et leurs manifestations inexistantes, en plus des symptômes existants, ce qui complique le diagnostic et conduit souvent à prescrire un traitement inadéquat. Parallèlement, la multiplicité des manifestations de la dystonie végétative-vasculaire nécessite la prescription d'une multitude de médicaments aux propriétés sédatives, vitamines, stabilisateurs végétatifs, antioxydants, antihypoxiques, somnifères et nootropes. Une telle liste de médicaments engendre des coûts financiers considérables et ne donne pas toujours de bons résultats thérapeutiques.
Les patients atteints de troubles viscérals, constatant l'inefficacité des médicaments prescrits, font preuve de capacités cognitives et d'une curiosité particulières, cherchant un médicament qui les aiderait à se débarrasser rapidement de tous leurs symptômes. Et ils trouvent ce remède face aux tranquillisants, sans réfléchir aux conséquences de leur prise.
L'utilisation à doses aléatoires et prolongée de phénazépam, de diazépam et d'autres psychotropes entraîne l'organisme à s'habituer à ces auxiliaires insidieux et à ne plus vouloir s'en passer. Mais si une personne prenait des tranquillisants de manière symptomatique, uniquement en cas d'anxiété accrue et de crises de panique, rien de tel ne se produirait.
Les neuroleptiques et les antidépresseurs peuvent être considérés comme une alternative aux tranquillisants, mais ils peuvent également entraîner une dépendance, ce qui nécessite une prudence particulière lors de leur utilisation. Les plus sûrs et les plus économiques seront les sédatifs et calmants à base de plantes (teinture d'agripaume, de menthe, de mélisse, Corvalol, Barboval), ainsi que les vasodilatateurs naturels les plus simples, qui ont un effet positif sur le système cardiovasculaire (Validol). Si ces médicaments relativement sûrs, en termes d'effet sur l'organisme, et leur sevrage, ne sont pas efficaces, il est nécessaire de consulter un médecin pour obtenir une prescription de médicaments plus puissants.
Pathogénèse
Mais revenons aux tranquillisants et essayons de comprendre pourquoi le syndrome de sevrage du phénazépam (ou d'autres médicaments de ce groupe) survient. Qu'est-ce qui provoque une dépendance aussi forte et l'apparition de multiples symptômes qui réduisent considérablement la qualité de vie?
Il existe dans la nature diverses substances pouvant entraîner une dépendance chez l'homme: stupéfiants, psychotropes, alcool et nicotine. Cependant, la dépendance à chaque substance évolue différemment. L'individu s'habitue très rapidement aux drogues et aux psychotropes, qui perturbent considérablement le fonctionnement du cerveau, provoquant des états d'euphorie, de relaxation et de calme.
Il existe une croyance populaire selon laquelle on s'habitue rapidement aux bonnes choses. Il est clair que pour le système nerveux central, un sentiment de calme et de paix est préférable à l'anxiété et à la tension. Il n'est donc pas surprenant qu'après l'arrêt des tranquillisants et des antidépresseurs, pour tenter de retrouver la paix, le corps manifeste une sorte de protestation et réclame une aide médicale.
Mais l'homme est un être rationnel et ne peut pas obéir aveuglément aux seuls signaux de son corps, c'est pourquoi de nombreux médecins dans la pathogenèse de la dépendance aux benzodiazépines, dans le contexte de laquelle se produit le syndrome de sevrage du phénazépam, l'une des benzodiazépines populaires, attribuent un rôle important aux caractéristiques personnelles d'une personne et aux particularités de sa psyché.
Le phénazépam est un médicament qui exerce un effet inhibiteur sur le système nerveux central en raison de son action sur les récepteurs du neurotransmetteur acide gamma-aminobutyrique (GABA), ce qui réduit l'excitabilité des neurones cérébraux. Ceci explique l'effet sédatif, anxiolytique et parfois hypnotique de ce tranquillisant.
Mais lorsqu'on prend des tranquillisants pour se sentir mal, on s'attend à une amélioration, c'est-à-dire qu'on s'attend à un résultat positif, et le soulagement, lorsqu'il survient, est perçu comme une euphorie. Cependant, l'effet du médicament s'estompe et on craint une réapparition des symptômes, car, comme nous l'avons déjà mentionné, les tranquillisants sont davantage une « ambulance » que des médicaments à part entière. Il est clair qu'en l'absence d'effet thérapeutique, les symptômes de VSD ou d'autres pathologies, pour lesquels les médecins peuvent prescrire du phénazépam, réapparaîtront rapidement et la personne se tournera, bon gré mal gré, vers le comprimé tant convoité.
Des recherches ont montré que tous les patients ne développent pas de dépendance aux tranquillisants (les indicateurs varient de 0,5 % à 7 %). La plupart des patients atteints du syndrome de sevrage présentent des traits de personnalité passifs-dépendants ou des troubles mentaux, ce qui les rend plus influençables et plus anxieux. Ces patients pensent que les tranquillisants, et en particulier le phénazépam, sont le seul traitement efficace. Ils tirent cette conclusion uniquement du fait que le médicament a rapidement soulagé les manifestations existantes de problèmes de santé, y compris les symptômes imaginaires.
Les patients dépendants aux benzodiazépines ont tendance à se focaliser sur les symptômes physiques, voire à les provoquer spontanément, dans l'espoir d'obtenir un médicament qui leur procurera une sensation d'euphorie. Mais certains patients, conscients de la puissance du phénazépam, se préparent au pire à l'arrêt de son traitement: ils inventent des symptômes inexistants, exagèrent les manifestations existantes et paniquent à l'avance. Finalement, tous deux préfèrent continuer à prendre des tranquillisants.
Ce comportement est associé à une anxiété accrue, qui peut donner l'impression qu'un seul comprimé ne suffit pas et qu'il est nécessaire d'augmenter la dose, ce que certains font. Une fois l'effet souhaité obtenu, le patient ne souhaite plus réduire la dose, ce qui ne fait qu'aggraver la dépendance. Parallèlement, l'anxiété et la peur s'ajoutent aux symptômes déjà présents, systématiquement présents lors de l'arrêt des psychotropes, ce qui stimule l'apparition d'une obsession pour un comprimé salvateur et d'un désir irrésistible de l'obtenir.
Prenons l'exemple des patients atteints de CIV. Les médecins peuvent poser ce diagnostic chez 80 % ou plus de la population, mais tout le monde ne consulte pas pour des symptômes graves: pics de pression, maux de tête et vertiges constants, nervosité, peurs inexpliquées, problèmes cardiaques, respiratoires, urinaires, etc. Nombreux sont ceux qui ne prêtent tout simplement pas attention à ces symptômes et ne voient pas l'intérêt de se gaver de médicaments, tandis que d'autres sont tellement obsédés par leurs sensations physiques qu'ils ne voient d'autre solution que de demander au médecin de prescrire des médicaments puissants.
Les symptômes de sevrage à l'arrêt du phénazépam surviennent dans un contexte d'augmentation des manifestations de troubles ventriculaires (VSD) déjà présentes. Tous ces symptômes étaient présents auparavant, mais moins prononcés. Les substances qui affectent le système nerveux, organe de contrôle de nombreux autres organes et systèmes de l'organisme, ne peuvent que perturber leur fonctionnement. Ceci, ainsi que l'anxiété accrue due à la crainte d'une réapparition des symptômes sans le médicament, explique l'augmentation de multiples symptômes de malaise local et général.
Symptômes Syndrome de sevrage du phénazépam
Ceux qui ont déjà été confrontés au problème du refus de prendre des tranquillisants savent à quel point les patients qui n'ont pas appris à gérer le stress et l'inconfort qui en résulte par des moyens non médicamenteux peuvent être confrontés. Mais ceux qui cherchent encore la solution miracle devraient se demander s'il existe vraiment des raisons valables de prescrire des médicaments puissants qui, bien que très efficaces et soulagent rapidement les symptômes désagréables, n'ont qu'un effet temporaire et peuvent entraîner une dépendance. À quoi faut-il se préparer après la fin du traitement?
La dépendance est un état où une personne n'a pas la volonté (ou la perd) de résister à la force qui l'a soumise. Dans le cas du syndrome de sevrage du phénazépam, cette force est le médicament, qui procure un soulagement temporaire, un calme et une euphorie. Les personnes qui savent se maîtriser et qui comprennent la gravité de la situation ne prendront de tranquillisants qu'en cas d'absolue nécessité. Les personnes sujettes à des faiblesses régulières peuvent, après un certain temps, ressentir les symptômes d'un sevrage brutal du phénazépam lorsqu'elles tentent d'arrêter de prendre des tranquillisants:
- l'anxiété et l'irritabilité réapparaissent et s'intensifient même,
- les maux de tête et les étourdissements reviennent,
- une personne commence à se sentir fatiguée, il y a un sentiment de manque de force pour vivre, qui est souvent accompagné de pensées de suicide ou d'un autre extrême - la peur de la mort si une pilule n'est pas prise,
- des difficultés à s'endormir réapparaissent, ce qui est en grande partie associé à des pensées sur le soulagement souhaité sous la forme d'une pilule tranquillisante; la nuit, une personne peut être tourmentée par des cauchemars et des réveils précoces,
- les patients se caractérisent par une instabilité de l'état émotionnel, des sautes d'humeur fréquentes, des accès de colère ou d'agressivité, des crises hystériques,
Parmi les symptômes physiques, il convient également de souligner: l'hyperhidrose, l'apparition d'épisodes similaires à des bouffées de chaleur, une sensation de chaleur puis de froid, une sensation de difficulté à respirer ou d'étouffement. Les patients peuvent se plaindre de nausées, de spasmes douloureux des organes internes et d'une accélération du rythme cardiaque. Des symptômes pseudo-grippaux apparaissent souvent: température subfébrile, congestion nasale, sensation de corps étranger dans la gorge, douleurs musculaires et articulaires.
Il convient de noter que les symptômes varient légèrement d'une personne à l'autre selon le diagnostic pour lequel le médicament a été prescrit. Cela confirme une fois de plus que le syndrome de sevrage n'est pas un trouble de santé distinct, mais la conséquence d'un traitement inadéquat d'une maladie existante.
La gravité des symptômes du syndrome de sevrage du phénazépam dépend non seulement des caractéristiques personnelles et mentales du patient, mais aussi de la posologie et de la durée du traitement. Les benzodiazépines se caractérisent par la nécessité d'augmenter progressivement la dose pour obtenir l'effet souhaité. Plus la dose est élevée, plus la dépendance est forte et plus il est difficile de refuser le traitement.
Les médecins recommandent de ne pas abuser du médicament et de ne pas le prendre plus d'un mois, expliquant qu'une utilisation prolongée peut entraîner une dépendance. Cet avis est confirmé par le fait que la question de savoir comment arrêter de prendre du phénazépem est le plus souvent posée par les personnes ayant pris le médicament régulièrement à la dose habituelle pendant trois mois ou plus. Si la dose était supérieure à celle prescrite, une dépendance peut se développer même après un mois et demi à deux mois.
Comment savoir si une personne a développé une dépendance aux tranquillisants? Les premiers signes d'une telle dépendance sont la réapparition des symptômes d'une maladie existante (mais sous une forme plus prononcée), associée à des pensées obsessionnelles sur les bienfaits du médicament en cas d'oubli d'une dose. L'apparition rapide des premiers symptômes de malaise est due à l'élimination active de la dose principale du médicament dès la première semaine suivant son arrêt. C'est durant ces jours que les personnes sous tranquillisants depuis longtemps doivent faire face à l'apparition de symptômes pseudo-grippaux, que tout le monde n'associe pas au syndrome de sevrage.
À mesure que la substance active est éliminée de l'organisme, le malaise s'intensifie et son tableau clinique s'amplifie. Le moment le plus difficile pour se retenir se situe entre une semaine et demie et trois semaines après la prise du dernier comprimé, car, à en juger par les patients eux-mêmes, ils sombrent pendant cette période dans un véritable enfer, comparable au syndrome de sevrage lié à l'alcool.
À cet égard, une attention particulière doit être portée aux troubles végétatifs observés chez la plupart des personnes ayant pris des tranquillisants pendant plus de deux mois. Il s'agit de crises végétatives, autrefois appelées attaques de panique. Cet état survient de manière inattendue et dure environ 10 minutes, au cours desquelles le patient peut ressentir plusieurs des symptômes suivants:
- augmentation du rythme cardiaque et sensation que le cœur est sur le point de sortir de la poitrine,
- pouls rapide (tachycardie), associé à une pulsation notable des vaisseaux sanguins,
- hyperhidrose (augmentation de la transpiration) sans raison apparente,
- des frissons qui apparaissent quelle que soit la température ambiante, une sensation de tremblement non seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur,
- difficulté à respirer, comme si la personne ne recevait pas assez d'air,
- essoufflement qui survient même au repos,
- gêne derrière le sternum dans la région du cœur, douleur au cœur,
- sensations désagréables dans l'estomac, une personne peut même ressentir des nausées,
- vertiges soudains, sensation de légèreté et d'apesanteur, irréalité de ce qui se passe, état proche de l'évanouissement,
- paresthésie des extrémités (sensation de perte de sensibilité, d'engourdissement ou de picotements dans les bras et les jambes),
- les bouffées de chaleur, caractérisées par une alternance d'épisodes de chaleur et de froid intenses,
- l'apparition de la peur de la mort (le patient a le sentiment que s'il ne prend pas le médicament maintenant, il risque de mourir des symptômes apparus).
Les manifestations des crises végétatives s'apparentent à un état de peur intense, mais sans raison apparente, c'est-à-dire qu'elles apparaissent de manière inattendue. Les patients peuvent présenter tout ou partie des symptômes mentionnés. Cependant, la sensibilité de chacun à ces symptômes est différente. Certaines personnes endurent leur état si durement qu'elles développent une peur de devenir folles.
Dans les cas graves de syndrome de sevrage après l'arrêt des tranquillisants, la sphère cognitive peut être altérée (détérioration de la mémoire et de l'attention), des problèmes de communication et une tendance au comportement antisocial peuvent apparaître. Lorsque des crises végétatives provoquent une altération du comportement, on parle de trouble panique sévère, nécessitant une prise en charge par un spécialiste (psychologue ou psychiatre).
Il est impossible de répondre clairement à la question de la durée du syndrome de sevrage du phénazépam. Les narcologues préconisent une période d'abstinence de deux à trois semaines, mais cela dépend en grande partie des caractéristiques du système excréteur, de l'état de santé du patient et de son attitude subjective face à sa maladie. Cependant, même après trois semaines, de nombreux patients souffrent encore d'un état que les médecins diagnostiquent comme une dépression, nécessitant un traitement antidépresseur.
À quel point cette condition est-elle dangereuse?
Le syndrome de sevrage du phénazépam, malgré ces symptômes « terribles », n'est qu'une réaction de l'organisme. On observe un phénomène similaire lorsqu'un petit enfant est privé de son jouet préféré: il devient capricieux, a du mal à s'endormir, se plaint d'une maladie inexistante suite à une perte aussi importante, exige la restitution de ses biens, etc., mais il ne se fera jamais de mal ni à sa santé pour une raison vraiment insignifiante. C'est notre corps. Il n'y a pas lieu de craindre un arrêt cardiaque ou un accident vasculaire cérébral suite au sevrage des tranquillisants.
La conséquence la plus dangereuse du syndrome de sevrage peut être la dépersonnalisation de la personnalité, lorsqu'une personne semble s'observer de l'extérieur et se sentir incapable de contrôler ses pensées et ses actions. Or, ce trouble de la personnalité est généralement caractéristique des personnes qui souffraient de troubles mentaux avant même la prescription de médicaments, et surtout si elles avaient déjà eu des épisodes de comportement antisocial.
Certes, les tranquillisants aident le patient à se détendre et même à s'affranchir de certaines conventions sociales, ce qui le rend plus libre, voire décomplexé, dans sa communication et son comportement. Mais lorsque leur effet cesse, la personne retrouve la capacité de contrôler pleinement ses pensées et ses actions. L'apparition de symptômes désagréables du syndrome de sevrage des tranquillisants peut donc difficilement expliquer la perte de maîtrise de soi.
Quant aux symptômes physiques tels que palpitations, hypertension artérielle, douleur soudaine du côté gauche de la poitrine lors d'attaques de panique, ils n'ont généralement aucun fondement médical, surtout chez les jeunes. La personne est en bonne santé physique, mais son état psycho-émotionnel (tension du système nerveux) provoque l'apparition de symptômes végétatifs sans rapport avec l'état réel du corps.
Le syndrome de sevrage du phénazépam peut être qualifié de complication non mortelle après une utilisation prolongée du médicament. Malgré toutes les difficultés, avec la volonté et le désir, on peut y survivre et l'oublier comme un cauchemar. La situation est bien pire si la personne ne résiste pas à la tentation et endure deux à trois semaines difficiles, au point de recommencer à prendre le médicament.
Avec le temps, son corps ne sera plus capable de gérer seul le stress, et la dépendance deviendra encore plus forte. Certaines personnes, même sous tranquillisants, développent une dépression profonde, des peurs inexpliquées ou de l'agressivité. Leur comportement se dégrade, ce qui crée des problèmes de communication et de relations. Rappelons que l'on observe un phénomène similaire chez les toxicomanes: un garçon ou une fille normal(e) finit par se transformer en une personne aux tendances antisociales.
L'une des caractéristiques des benzodiazépines est la nécessité d'augmenter progressivement la dose pour obtenir l'effet souhaité. Si ces médicaments sont pris pendant une longue période et que la dose est augmentée régulièrement, même quelques comprimés finissent par ne plus être efficaces et la personne commence à chercher d'autres moyens de se détendre, car sans eux, elle ne peut plus imaginer une vie normale. Faute de pouvoir se procurer ce médicament en pharmacie, un patient toxicomane peut décider de voler, de cambrioler ou, pire encore, de vouloir se séparer de la vie. Il s'avère que ce qu'une personne a fui, c'est ce à quoi elle est retournée. Sans l'aide d'un psychologue ou d'un psychiatre, il sera très difficile pour ces personnes de se réinsérer dans la société, de retrouver leur respect et leur désir de vivre une vie normale.
Malheureusement, tout le monde ne parvient pas à gérer seul les symptômes du syndrome de sevrage des tranquillisants. Certains patients reprennent leur traitement précédent, d'autres tentent de gérer seuls une panique inexplicable, même s'ils n'y parviennent pas toujours correctement.
Les peurs qui apparaissent dans le contexte de l'abstinence peuvent être de nature différente: certaines personnes ont peur de mourir, d'autres d'une crise cardiaque, d'autres encore ont peur d'être seules dans leur appartement, d'autres encore commencent à avoir peur des transports, d'autres encore craignent de ne pas communiquer de manière optimale, estimant qu'elles ont peu de contrôle sur elles-mêmes. Et cette liste est loin d'être exhaustive.
Une mauvaise façon de les gérer est d'éviter les situations liées à ces expériences, par exemple refuser de voyager, cesser de communiquer, etc. La personne se replie sur elle-même, perd ses capacités de communication, ses pensées tournent autour de ses propres peurs, ce qui peut conduire à la dépression ou, pire, à de graves troubles mentaux. On pourrait croire qu'une personne a réussi à se débarrasser d'une dépendance nocive, mais elle a développé un nouveau problème qui nécessite la prise d'autres substances psychoactives, comme les antidépresseurs, qui peuvent également entraîner une dépendance.
Il s'agit d'un cercle vicieux que seul un spécialiste peut briser. Un diagnostic précoce du syndrome de sevrage et un traitement adapté permettent d'éviter les symptômes désagréables du sevrage et les conséquences et complications décrites ci-dessus sur la socialisation, lui permettant ainsi de devenir un membre à part entière de la société.
Diagnostics Syndrome de sevrage du phénazépam
Malgré les histoires effrayantes que l'on entend dans la rue ou chez les médecins, dans la réalité, la dépendance aux benzodiazépines est rare. Même une utilisation prolongée de ces médicaments à doses thérapeutiques entraîne de telles complications dans des cas isolés. Il s'agit généralement de patients présentant une sensibilité accrue aux substances psychoactives, souvent liée à une consommation excessive d'alcool, d'antidépresseurs, d'opioïdes, etc., ou présentant une prédisposition héréditaire à de telles réactions aux tranquillisants.
Pour le reste, l'expérience montre que l'apparition d'une dépendance physique et d'un syndrome de sevrage est prévisible en cas de prise prolongée (plus de 2 à 3 mois) de phénazépam ou de toute autre benzodiazépine à une dose deux, voire trois fois supérieure à celle recommandée. L'arrêt brutal du médicament entraîne la réapparition des symptômes d'anxiété précédemment diagnostiqués, entraînant l'apparition et l'intensification de symptômes végétatifs, souvent invraisemblables.
Pour comprendre qu'une personne a développé une dépendance aux tranquillisants, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste. Les symptômes de la dépendance aux benzodiazépines sont généralement similaires à ceux du sevrage dû à l'abus d'alcool ou à une intoxication aux barbituriques. Le sommeil est perturbé, une anxiété et une agitation inexpliquée apparaissent, la sensibilité aux sons forts et à la lumière vive augmente, la transpiration augmente, des nausées et des douleurs abdominales peuvent survenir sans lien avec l'alimentation, la température augmente et des symptômes pseudo-grippaux apparaissent.
On entend souvent des plaintes concernant un rythme cardiaque élevé, un pouls rapide et palpable, des douleurs cardiaques et des maux de tête. Dans les situations graves, une excitation excessive ou, au contraire, une apathie, des accès d'agressivité, des pensées suicidaires, un syndrome convulsif, une faiblesse musculaire et des douleurs peuvent apparaître. Selon certains auteurs, la dépendance aux benzodiazépines et le syndrome de sevrage de ce type de médicaments se caractérisent par des contractions musculaires (crises myocloniques), une perception sonore inhabituellement aiguë et des difficultés à uriner (incontinence urinaire à l'état de veille, c'est-à-dire pendant la journée).
Lors d'une consultation médicale présentant de tels symptômes, il est conseillé de clarifier immédiatement la durée et la posologie des tranquillisants, et de vérifier si l'apparition des symptômes douloureux est liée à l'arrêt du traitement (les premiers signes apparaissent généralement le surlendemain de la prise du dernier comprimé, puis de nouveaux symptômes apparaissent progressivement à mesure que le médicament est éliminé de l'organisme). Le patient est généralement conscient et capable d'expliquer seul les raisons de son altération de l'état de santé, mais dans d'autres cas, ses proches peuvent en parler. Dans les cas extrêmes, les informations relatives à la prescription de tranquillisants figurent dans le dossier médical du patient.
Lors du diagnostic d'un syndrome de sevrage dû à l'arrêt des tranquillisants, aucun examen n'est généralement nécessaire. Un diagnostic différentiel est généralement nécessaire lorsque le médecin ne peut obtenir les informations nécessaires auprès des sources susmentionnées, ce qui se produit souvent lorsque le patient prend des médicaments sans ordonnance et les dissimule.
Le tableau clinique du syndrome de sevrage du phénazépam ressemble généralement à celui de l'alcoolisme et de l'intoxication aux barbituriques, et aux manifestations du syndrome de sevrage des antidépresseurs et autres substances psychotropes. Dans ce cas, il est essentiel de déterminer la substance à l'origine des symptômes douloureux, ce qui peut être réalisé en laboratoire, car l'élimination de ces substances de l'organisme prend un certain temps. Plus tôt une personne consulte, plus il lui sera facile d'y parvenir.
Il est erroné de se fier uniquement aux symptômes existants, car le tableau clinique du sevrage dépend de nombreux facteurs: la substance prise, la durée de son utilisation, le dosage, les caractéristiques psychophysiques du corps du patient, l'âge, la combinaison avec d'autres substances psychoactives (par exemple, avec de l'alcool), etc. Néanmoins, il est nécessaire de déterminer la raison du sevrage, car la nomination d'un traitement efficace en dépend, ce qui contribuera à soulager l'état du patient.
Traitement Syndrome de sevrage du phénazépam
Pour éviter le développement d'un syndrome de sevrage au phénazépam et aux autres tranquillisants, il est essentiel de savoir comment arrêter correctement le phénazépam afin de minimiser les symptômes. Les médecins insistent sur la nécessité d'une interruption progressive sur plusieurs semaines, une fois tous les 2 à 3 jours, en réduisant la dose de 10 à 15 fois, et en l'absence de malaise sévère, de 20 %.
Si, après l'arrêt des tranquillisants, le patient commence à ressentir une augmentation des symptômes de la maladie précédemment diagnostiquée pour laquelle le médicament a été prescrit, il est logique de revenir à la posologie habituelle et, à partir de ce moment, de commencer une réduction progressive de la posologie du tranquillisant.
Les médecins étudient également d'autres solutions pour soulager le syndrome de sevrage du phénazépam. Après tout, il s'agit d'un médicament dont la notice indique qu'il n'est pas recommandé pour une utilisation à long terme. La deuxième option consiste à remplacer le phénazépam par un autre tranquillisant permettant une utilisation à long terme (par exemple, le prazépam). Cependant, même dans ce cas, il est nécessaire de réduire progressivement la dose du médicament.
La troisième option consiste à remplacer les benzodiazépines par des barbituriques, qui ont également un effet sédatif et hypnotique. Dans la plupart des cas, il s'agit de médicaments à action prolongée, permettant d'utiliser des doses plus faibles. Cependant, les barbituriques sont également des substances psychoactives et peuvent donc entraîner une dépendance; il est donc déconseillé d'en abuser. Progressivement, il faudra abandonner ces médicaments et privilégier les méthodes psychothérapeutiques, les techniques de relaxation, le yoga, etc.
Les tranquillisants peuvent également être remplacés par d'autres médicaments à action anxiolytique dans le traitement du sevrage. Ainsi, l'« Atarax », à base de dichlorhydrate d'hydroxyle, n'appartient pas à la catégorie des psychotropes puissants et ne provoque pas de dépendance. Par conséquent, en l'absence de contre-indications, il est utilisé avec succès dans le syndrome de sevrage du phénazépam. Il contribue à soulager l'agitation psychomotrice, caractéristique du sevrage, à réduire l'irritabilité et l'anxiété, ainsi que les tensions internes causées par des troubles mentaux ou somatiques.
Certains symptômes de sevrage, comme la douleur physique ou l'anxiété accrue, peuvent être soulagés par des médicaments plus sûrs. Dans le premier cas, des analgésiques ou des AINS peuvent être prescrits, dans le second, des bêtabloquants, des antidépresseurs ou des sédatifs à base de plantes. Dans tous les cas, le médecin doit prescrire un plan de traitement personnalisé, en fonction de la maladie sous-jacente, des prescriptions et associations médicamenteuses antérieures, de l'état psycho-émotionnel du patient et, bien sûr, de la symptomatologie existante.
Très souvent, le passage à d'autres drogues s'accompagne d'un sentiment d'inefficacité et d'un désir de revenir aux tranquillisants, qui soulageront rapidement et complètement tous les symptômes désagréables. Dans ce cas, l'attitude de la personne et sa connaissance des autres méthodes permettant d'atteindre la relaxation et le calme sont essentielles.
Si un médecin généraliste peut prescrire des médicaments pour le sevrage, et dans les situations difficiles, un narcologue, seul un spécialiste en psychologie et en psychothérapie peut apporter au patient des connaissances sur les méthodes de relaxation et une assistance psychologique professionnelle. La psychothérapie est particulièrement importante pour les patients souffrant de troubles mentaux, les personnes ayant des tendances suicidaires et une faible volonté.
Le succès du traitement dépend en grande partie de la volonté du patient de se débarrasser de sa dépendance malsaine aux tranquillisants, de sa patience, de sa volonté et de l'aide de sa famille et de ses amis. Il a été constaté que si, pendant cette période, le patient bénéficie du soutien de ses proches, il supporte beaucoup plus facilement les difficultés liées au syndrome de sevrage du phénazépam. Le soutien des proches est particulièrement important pour les personnes ayant des pensées suicidaires, car qui peut mieux protéger un proche d'un acte irréfléchi?
En règle générale, les patients atteints du syndrome de sevrage du phénazépam sont traités en ambulatoire. Si nécessaire, ils devront suivre des séances de psychothérapie et consulter régulièrement leur médecin jusqu'à la stabilisation complète de leur état mental et physique. Les patients souffrant de troubles mentaux, ainsi que ceux dont l'environnement ne facilite pas le sevrage des psychotropes, nécessitent une hospitalisation, suivie d'un traitement ambulatoire de longue durée.
La prévention
Rares sont ceux qui, ayant vécu toutes les épreuves du syndrome de sevrage, souhaitent revivre cette expérience. Pour éviter cela, il est essentiel d'apprendre à se détendre grâce à la méditation et aux techniques de relaxation, et de suivre scrupuleusement les prescriptions du médecin.
Le phénazépam est souvent prescrit pour la dystonie vasculaire, bien que dans la plupart des cas, une telle prescription ne soit pas nécessaire. Après tout, la dystonie vasculaire est un trouble qui survient dans le contexte d'autres maladies, et il suffit d'y prêter attention et de prescrire un traitement approprié pour que les symptômes de la dystonie végétative-vasculaire disparaissent d'eux-mêmes.
Le diagnostic de VSD est complexe et ambigu, et tous les médecins ne sont pas prêts à se gaver de multiples examens pour en déterminer la véritable cause. C'est là que les prescriptions erronées sont mises en évidence, car les tranquillisants peuvent en réalité soulager presque tous les symptômes de VSD, même au prix d'une dépendance.
En revanche, la dépendance ne se produit pas si le médicament est pris aux doses recommandées. Ainsi, le respect de la dose prise et de la dose recommandée constitue une forme de prévention de la dépendance aux tranquillisants. Il est toutefois préférable de renoncer aux médicaments puissants et de privilégier les sédatifs à base de plantes et les techniques de relaxation psychothérapeutiques.
En prenant soin de votre santé et des prescriptions de votre médecin, vous pourrez éviter non seulement le syndrome de sevrage du phénazépam, mais aussi de nombreux autres problèmes de santé physique et mentale. Il est important de toujours garder à l'esprit que notre santé est entre nos mains.
Prévoir
Le syndrome de sevrage du phénazépam est la conséquence logique d'une prescription ou d'une administration incorrecte d'un médicament de la famille des tranquillisants. Le résultat ne dépend pas de la responsabilité du médecin ou du patient. Au lieu de chercher un coupable, il est donc essentiel de prendre des mesures pour soulager au plus vite ce trouble désagréable et douloureux. Et cela ne peut se faire que grâce aux efforts conjoints d'un psychologue, d'un médecin et du patient.
Il est vrai que le pronostic du traitement de la dépendance aux tranquillisants n'est pas toujours favorable. Certains patients s'effondrent ensuite et recommencent à prendre des psychotropes, même s'ils n'en ont plus besoin. Pour consolider les résultats du traitement, il est essentiel de créer les conditions nécessaires pour que le patient ne subisse pas l'impact des facteurs de stress et se sente soutenu par ses proches.
 [ 14 ]
[ 14 ]

