Expert médical de l'article
Nouvelles publications
Virus oncogènes (oncovirus)
Dernière revue: 08.07.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.
Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.
Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.
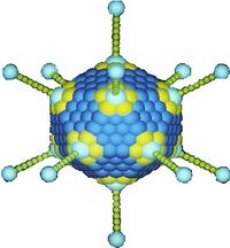
Pour expliquer la nature du cancer, deux théories dominantes ont été proposées: la théorie des mutations et la théorie virale. Selon la première, le cancer résulte de mutations successives de plusieurs gènes dans une cellule, c'est-à-dire qu'il repose sur des changements intervenant au niveau génétique. Cette théorie a été formulée dans sa forme définitive en 1974 par F. Burnet: une tumeur cancéreuse est monoclonale; elle provient d'une cellule somatique initiale, dont les mutations sont causées par des agents chimiques, physiques et des virus qui endommagent l'ADN. Dans la population de ces cellules mutantes, des mutations supplémentaires s'accumulent, augmentant la capacité des cellules à se reproduire sans limite. Cependant, l'accumulation de mutations nécessite un certain temps; le cancer se développe donc progressivement et la probabilité de développer la maladie dépend de l'âge.
La théorie viro-génétique du cancer a été formulée avec la plus grande clarté par le scientifique russe L.A. Zilber: le cancer est causé par des virus oncogènes qui s'intègrent au chromosome cellulaire et créent un phénotype cancéreux. Pendant un certain temps, la pleine reconnaissance de cette théorie a été entravée par le fait que de nombreux virus oncogènes possèdent un génome à ARN; le mode d'intégration au chromosome cellulaire était donc difficile à comprendre. Après la découverte de la transcriptase inverse chez ces virus, capable de reproduire l'ADN provirus à partir de l'ARN du virion, cet obstacle a été levé et la théorie viro-génétique a été reconnue, tout comme la théorie de la mutation.
Une contribution décisive à la compréhension de la nature du cancer a été apportée par la découverte d’un gène de malignité, l’oncogène, dans les virus oncogènes, et de son précurseur, présent dans les cellules des humains, des mammifères et des oiseaux, le proto-oncogène.
Les proto-oncogènes sont une famille de gènes qui assurent des fonctions vitales dans une cellule normale. Ils sont nécessaires à la régulation de sa croissance et de sa reproduction. Les produits des proto-oncogènes sont diverses protéines kinases qui phosphorylent les protéines de signalisation cellulaire, ainsi que des facteurs de transcription. Ces derniers sont des protéines produites par les proto-oncogènes c-myc, c-fos, c-jun, c-myh et des gènes suppresseurs de cellules.
Il existe deux types d’oncovirus:
- Virus contenant un oncogène (virus one+).
- Virus qui ne contiennent pas d'oncogène (un virus).
- Les virus One+ peuvent perdre l'oncogène, mais cela ne perturbe pas leur fonctionnement normal. Autrement dit, le virus lui-même n'a pas besoin de l'oncogène.
La principale différence entre les virus one+ et one" est la suivante: le virus one+, ayant pénétré la cellule, ne provoque pas sa transformation en cancer ou la provoque très rarement. Les virus one", ayant pénétré le noyau de la cellule, la transforment en cancer.
Ainsi, la transformation d'une cellule normale en cellule tumorale se produit lorsqu'un oncogène, introduit dans le chromosome cellulaire, lui confère une nouvelle propriété lui permettant de se reproduire de manière incontrôlable dans l'organisme, formant ainsi un clone de cellule cancéreuse. Ce mécanisme de transformation d'une cellule normale en cellule cancéreuse ressemble à la transduction bactérienne, où un phage tempéré, s'intégrant au chromosome d'une bactérie, lui confère de nouvelles propriétés. Ceci est d'autant plus plausible que les virus oncogènes se comportent comme des transposons: ils peuvent s'intégrer à un chromosome, se déplacer d'une région à une autre ou d'un chromosome à un autre. La question fondamentale est la suivante: comment un proto-oncogène se transforme-t-il en oncogène lorsqu'il interagit avec un virus? Tout d'abord, il est important de noter que chez les virus, en raison de leur taux de reproduction élevé, les promoteurs sont beaucoup plus actifs que dans les cellules eucaryotes. Ainsi, lorsqu'un virus oncogène s'intègre au chromosome d'une cellule à côté d'un proto-oncogène, il subordonne le fonctionnement de ce gène à son promoteur. En quittant le chromosome, le génome viral s'empare du proto-oncogène, qui devient un composant du génome viral et se transforme en oncogène, et le virus passe de l'un à l'autre en un virus oncogène. En s'intégrant au chromosome d'une autre cellule, un tel virus oncogène y transduit simultanément l'oncogène, avec toutes les conséquences que cela implique. Il s'agit du mécanisme le plus courant de formation des virus oncogènes (oncogènes) et du début de la transformation d'une cellule normale en cellule tumorale. D'autres mécanismes de transformation d'un proto-oncogène en oncogène sont également possibles:
- translocation de proto-oncogène, qui fait que le proto-oncogène est adjacent à un promoteur viral puissant, qui en prend le contrôle;
- amplification d'un proto-oncogène, à la suite de laquelle le nombre de ses copies augmente, ainsi que la quantité du produit synthétisé;
- La transformation d’un proto-oncogène en oncogène se produit à la suite de mutations causées par des mutagènes physiques et chimiques.
Ainsi, les principales raisons de la transformation d’un proto-oncogène en oncogène sont les suivantes:
- Inclusion d'un proto-oncogène dans le génome viral et transformation de ce dernier en un virus one+.
- L'entrée d'un proto-oncogène sous le contrôle d'un promoteur fort soit à la suite d'une intégration virale, soit à la suite d'une translocation d'un bloc de gènes dans le chromosome.
- Mutations ponctuelles dans le proto-oncogène.
Amplification des proto-oncogènes. Les conséquences de tous ces événements peuvent être:
- un changement dans la spécificité ou l'activité du produit protéique de l'oncogène, d'autant plus que très souvent l'inclusion d'un proto-oncogène dans le génome viral s'accompagne de mutations du proto-oncogène;
- perte de la régulation cellulaire spécifique et temporelle de ce produit;
- une augmentation de la quantité de produit protéique synthétisé de l'oncogène.
Les produits oncogènes sont également des protéines kinases et des facteurs de transcription. Par conséquent, les perturbations de l'activité et de la spécificité des protéines kinases sont considérées comme les déclencheurs initiaux de la transformation d'une cellule normale en cellule tumorale. La famille des proto-oncogènes comprenant 20 à 30 gènes, elle ne comprend évidemment pas plus de trois douzaines de variants.
Cependant, la malignité de ces cellules ne dépend pas seulement de mutations de proto-oncogènes, mais aussi de modifications de l'influence de l'environnement génétique sur le fonctionnement des gènes dans leur ensemble, caractéristiques d'une cellule normale. C'est la théorie génétique moderne du cancer.
Ainsi, la principale cause de la transformation d'une cellule normale en cellule maligne est la mutation d'un proto-oncogène ou son passage sous le contrôle d'un puissant promoteur viral. Divers facteurs externes induisant la formation de tumeurs (produits chimiques, rayonnements ionisants, rayonnement UV, virus, etc.) agissent sur la même cible: les proto-oncogènes. Ces derniers sont présents dans les chromosomes des cellules de chaque individu. Sous l'influence de ces facteurs, un mécanisme génétique est activé, ce qui entraîne une modification de la fonction du proto-oncogène, ce qui, à son tour, entraîne la dégénérescence d'une cellule normale en cellule maligne.
Une cellule cancéreuse est porteuse de protéines virales étrangères ou de ses propres protéines modifiées. Elle est reconnue par les lymphocytes T cytotoxiques et détruite grâce à d'autres mécanismes du système immunitaire. Outre les lymphocytes T cytotoxiques, les cellules cancéreuses sont reconnues et détruites par d'autres cellules tueuses: les cellules NK, les cellules Pit, les cellules B tueuses et les cellules K, dont l'activité cytotoxique dépend des anticorps. Les leucocytes polynucléaires; les macrophages; les monocytes; les plaquettes; les cellules mononucléaires du tissu lymphoïde dépourvues de marqueurs des lymphocytes T et B; les lymphocytes T dotés de récepteurs Fc pour les IgM peuvent fonctionner comme des cellules K.
Les interférons et certains autres composés biologiquement actifs formés par les cellules immunocompétentes ont un effet antitumoral. En particulier, les cellules cancéreuses sont reconnues et détruites par un certain nombre de cytokines, notamment le facteur de nécrose tumorale et la lymphotoxine. Ce sont des protéines apparentées possédant une large gamme d'activités biologiques. Le facteur de nécrose tumorale (TNF) est l'un des principaux médiateurs des réponses inflammatoires et immunitaires dans l'organisme. Il est synthétisé par diverses cellules du système immunitaire, principalement les macrophages, les lymphocytes T et les cellules de Kupffer du foie. Le TNFa a été découvert en 1975 par E. Carswell et ses collègues; c'est un polypeptide de poids moléculaire de 17 kD. Il a un effet pléiotrope complexe: il induit l'expression des molécules du CMH de classe II dans les cellules immunocompétentes, stimule la production d'interleukines IL-1 et IL-6, de prostaglandine PGE2 (il sert de régulateur négatif du mécanisme de sécrétion du TNF); Il a un effet chimiotactique sur les lymphocytes T matures, etc. Le rôle physiologique le plus important du TNF est la modulation de la croissance cellulaire dans l'organisme (fonctions de régulation de la croissance et de cytodifférenciation). De plus, il inhibe sélectivement la croissance des cellules malignes et provoque leur lyse. On suppose que l'activité modulatrice de la croissance du TNF peut être utilisée en sens inverse, à savoir stimuler la croissance des cellules normales et inhiber celle des cellules malignes.
La lymphotoxine, ou TNF-bêta, est une protéine d'un poids moléculaire d'environ 80 kDa, synthétisée par certaines sous-populations de lymphocytes T. Elle possède également la capacité de lyser les cellules cibles porteuses d'antigènes étrangers. D'autres peptides, notamment des fragments d'IgG, comme la tuftéine (un polypeptide cytophile isolé du domaine CH2), les fragments Fab et Fc, etc., ont également la capacité d'activer les fonctions des cellules NK, des cellules K, des macrophages et des leucocytes neutrophiles. L'immunité antitumorale n'est assurée que par l'interaction constante de tous les systèmes immunocompétents.
La plupart des personnes ne développent pas de cancer, non pas parce qu'elles ne développent pas de cellules cancéreuses mutantes, mais parce que ces dernières, une fois développées, sont rapidement reconnues et détruites par les lymphocytes T cytotoxiques et d'autres composants du système immunitaire avant d'avoir le temps de produire une descendance maligne. Chez ces personnes, l'immunité antitumorale est efficace. À l'inverse, chez les patients cancéreux, les cellules mutantes ne sont ni reconnues ni détruites rapidement par le système immunitaire, mais se multiplient librement et de manière incontrôlée. Le cancer est donc une conséquence de l'immunodéficience. Il est nécessaire de déterminer quel composant du système immunitaire est atteint afin de définir des moyens plus efficaces de lutter contre la maladie. À cet égard, une attention particulière est accordée au développement de méthodes de biothérapie du cancer basées sur l'utilisation complexe et cohérente de modulateurs de la réactivité biologique et immunologique, c'est-à-dire de substances chimiques synthétisées par des cellules immunocompétentes capables de modifier les réactions d'interaction de l'organisme avec les cellules tumorales et de fournir une immunité antitumorale. Grâce à ces modificateurs de la réactivité immunologique, il devient possible d'influencer le système immunitaire dans son ensemble et, de manière sélective, ses mécanismes individuels, notamment ceux contrôlant la formation de facteurs d'activation, la prolifération, la différenciation, la synthèse d'interleukines, de facteurs de nécrose tumorale, de lymphotoxines, d'interférons, etc., afin d'éliminer l'état d'immunodéficience cancéreuse et d'accroître l'efficacité de son traitement. Des cas de guérison du myélome humain par des lymphokines tueuses activées et l'interleukine-2 ont déjà été décrits. Les orientations suivantes ont été décrites en immunothérapie anticancéreuse expérimentale et clinique.
- Introduction de cellules du système immunitaire activées dans le tissu tumoral.
- Utilisation de lympho- ou (et) monokines.
- L'utilisation d'immunomodulateurs d'origine bactérienne (les plus efficaces sont les dérivés du LPS et du peptidoglycane) et des produits induits par ceux-ci, notamment le TNF.
- Utilisation d'anticorps antitumoraux, y compris monoclonaux.
- Utilisation combinée de différentes directions, par exemple la première et la deuxième.
Les perspectives d’utilisation de modulateurs de la réactivité immunologique pour la biothérapie du cancer sont extrêmement vastes.


 [
[