Nouvelles publications
« Microbe troyen »: les bactéries cachent le virus oncolytique du système immunitaire et le lancent directement dans les tumeurs
Dernière revue: 23.08.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.
Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.
Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.
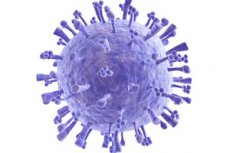
Les virus oncolytiques peuvent tuer les cellules cancéreuses, mais sont souvent impuissants face à… notre système immunitaire: des anticorps neutralisants interceptent les virus dans le sang, les empêchant d'atteindre la tumeur. Une équipe de Columbia Engineering a proposé une solution astucieuse: cacher le virus dans une bactérie qui, elle-même, détecte et colonise la tumeur. Dans Nature Biomedical Engineering, ils ont présenté la plateforme CAPPSID – « Activité coordonnée des procaryotes et des picornavirus pour une administration intracellulaire sûre ». La bactérie Salmonella typhimurium produit l'ARN du virus oncolytique Senecavirus A (SVA) et le libère à l'intérieur de la cellule tumorale, d'où le virus décolle et se propage, restant invisible aux anticorps circulants. Chez des souris immunocompétentes, un tel « défaut » a inhibé la croissance tumorale et a fonctionné même avec l'immunité antivirale existante.
Contexte de l'étude
Les virus oncolytiques ont longtemps été considérés comme des « médicaments auto-réplicatifs »: ils sélectionnent les cellules cancéreuses, s'y répliquent et déclenchent une réponse immunitaire contre la tumeur. Cependant, cette approche présente une barrière systémique persistante: l'administration. Administrés par voie intraveineuse, les virus sont rapidement interceptés par des anticorps neutralisants et des éléments du système immunitaire inné. Certaines particules « collent » au foie et à la rate, et seule une faible proportion atteint une tumeur dense et mal perfusée. Par conséquent, de nombreux protocoles cliniques sont contraints de se limiter aux injections intratumorales, ce qui réduit le champ des indications et complique le traitement de foyers multiples.
Parallèlement aux virus, une autre branche d'agents antitumoraux « vivants » a été développée: les bactéries génétiquement modifiées. Des souches affaiblies de Salmonella, E. coli, Listeria, etc. présentent un tumorotropisme: elles peuplent facilement les zones tumorales hypoxiques et peuvent servir de vecteurs pour l'administration locale de cytotoxines, de cytokines ou de cassettes génétiques. Cependant, la thérapie bactérienne agit localement et est limitée par l'ampleur de la colonisation: il est difficile d'atteindre les cellules situées en dehors des « nids bactériens », et la sécurité et la contrôlabilité sont toujours sous le contrôle étroit des autorités de réglementation.
Dans ce contexte, l'idée de combiner les atouts des deux mondes paraît logique. Auparavant, on tentait de protéger les virus avec des polymères, de les dissimuler dans des cellules porteuses (par exemple, des cellules souches mésenchymateuses) ou d'utiliser des exosomes; toutes ces approches contournent partiellement les anticorps, mais compliquent leur production et leur contrôle. Les bactéries sont capables de détecter une tumeur de manière autonome et de transporter leur « charge » en profondeur dans les tissus; si on leur apprend à lancer le virus directement à l'intérieur de la cellule tumorale, il est possible de contourner le « parapluie anti-air » du système immunitaire et d'étendre simultanément la zone affectée au-delà de la colonie, favorisant ainsi la propagation virale.
La clé de la traduction réside dans le contrôle de sécurité. Un virus oncolytique nu dans une bactérie pourrait théoriquement « se déchaîner ». C'est pourquoi les plateformes modernes construisent des fusibles à plusieurs niveaux: l'ARN viral est synthétisé et libéré uniquement dans la cellule tumorale, et l'assemblage complet des virions dépend de la « clé » – une protéase spécifique ou un autre facteur fourni uniquement par la bactérie. Par conséquent, le virus reste un « passager aveugle » jusqu'à ce qu'il atteigne sa cible; le système immunitaire ne le détecte pas dans la circulation sanguine; il est lancé de manière ciblée, ce qui réduit le risque de dispersion incontrôlée. C'est la stratégie développée par ces nouveaux travaux, démontrant qu'une « bactérie messager » peut délivrer de manière fiable un picornovirus oncolytique à une tumeur et l'activer là où il est réellement nécessaire.
Comment ça marche
- Détecteur de bactéries. S. typhimurium, par ingénierie génétique, atteint naturellement la tumeur et est capable de pénétrer les cellules cancéreuses. À l'intérieur, il transcrit l'ARN viral (y compris le génome complet de SVA) grâce à des promoteurs spécifiques.
- Déclencheur autolytique. La bactérie est programmée pour se lyser dans le cytoplasme de la cellule tumorale et libère simultanément de l'ARN viral et une enzyme auxiliaire. Le virus entame un cycle de réplication et infecte les cellules voisines.
- Contrôle de sécurité. Le virus est encore modifié: pour assembler des virions matures, il a besoin d'une protéase « clé » (par exemple, la protéase TEV), fournie uniquement par la bactérie. Cela limite la propagation incontrôlée.
- Protection contre les anticorps. Bien que l'ARN viral soit « condensé » dans la bactérie, les anticorps neutralisants présents dans le sang ne le détectent pas, ce qui facilite son acheminement vers la tumeur.
Ce que les expériences ont montré
- En culture: CAPPSID a déclenché une infection SVA à part entière et une dissémination du virus parmi les cellules non infectées par la bactérie (y compris sur les lignées de cancer du poumon neuroendocrinien H446).
- Chez la souris, l'administration intratumorale et intraveineuse de CAPPSID a inhibé la croissance tumorale et permis une réplication virale robuste; dans certains modèles, les tumeurs SCLC sous-cutanées ont été complètement éradiquées.
- Immunité « contre le bruit »: le système fonctionnait même en présence d’anticorps neutralisants contre le SVA: les bactéries livraient le génome à la tumeur et le virus était lancé « derrière la ligne de défense ».
- Contrôle de la propagation: la dépendance conditionnelle du virus à une protéase bactérienne lui a permis de limiter le nombre de cycles d'infection en dehors de la cellule d'origine - une couche supplémentaire de contrôle de sécurité.
Pourquoi c'est important (et en quoi cela diffère des approches conventionnelles)
Les virus oncolytiques classiques présentent deux problèmes: les anticorps les interceptent dans le sang, et leur propagation systémique comporte des risques de toxicité. Les bactéries génétiquement modifiées, au contraire, adorent les tumeurs, mais agissent localement et peinent à atteindre la périphérie du néoplasme. CAPPSID combine les atouts de ces deux approches:
- administration par des bactéries → plus grande chance d’atteindre la tumeur, en contournant les anticorps;
- virus à l’intérieur → infecte les cellules voisines et étend sa zone d’action au-delà de la colonie bactérienne;
- Un « fusible » intégré sous la forme d’un virus nécessitant une protéase bactérienne réduit le risque de dissémination incontrôlée.
Détails techniques
- Chez Salmonella, les promoteurs des îlots de pathogénicité SPI-1/SPI-2 ont été recrutés pour activer précisément la transcription de l'ARN viral et des protéines de lyse (HlyE, φX174 E) au bon moment et au bon endroit.
- Ils ont testé à la fois des réplicons (ARN auto-amplifiant mais non étalé) et du SVA pleine longueur, qui était plus efficace pour étendre la lésion par réinfection.
- La protéase TEV a été utilisée comme « clé externe » pour l’assemblage des virions: sans elle, le virus « ne mûrit pas ».
Limitations et questions pour référence future
- Pour l'instant, il s'agit d'un stade préclinique: cellules, souris immunocompétentes, un ensemble limité de modèles tumoraux; les modèles orthotopiques et la toxicologie GLP sont à venir.
- Une évaluation approfondie de la sécurité des bactéries lors de l’administration systémique et de la résistance du « fusible » à l’échappement mutationnel du virus est nécessaire (les auteurs établissent déjà le choix des sites d’incision qui réduisent le risque de réversion).
- Une véritable clinique nécessitera des souches dont la sécurité est prouvée (par exemple des dérivés de Salmonella atténués humains) et une combinaison bien pensée avec l'immunothérapie.
Qu'est-ce que cela pourrait signifier demain?
- Nouveaux « médicaments vivants » pour les tumeurs solides où l’administration est le principal goulot d’étranglement.
- Personnalisation de la cible virale: SVA démontre un tropisme pour les tumeurs neuroendocrines; théoriquement, la plateforme pourrait être réutilisée pour d'autres picornavirus ou réplicons oncolytiques.
- Réduction de la consommation de particules virales et du risque d’effets secondaires systémiques dus au lancement local au site de l’infection.
Conclusion
Les ingénieurs ont transformé la bactérie en une « capside vivante » qui dissimule le virus aux anticorps, le transporte jusqu'à la tumeur et fournit la clé pour l'introduire en toute sécurité. Chez la souris, cela freine la croissance tumorale et contourne l'immunité antivirale. La prochaine étape consiste à confirmer la sécurité et la personnalisation de la plateforme en vue des essais cliniques.
Source: Singer ZS, Pabón J., Huang H., et al. Des bactéries modifiées lancent et contrôlent un virus oncolytique. Nature Biomedical Engineering (en ligne le 15 août 2025). doi: 10.1038/s41551-025-01476-8.
