Nouvelles publications
Les hommes primitifs ne vivaient pas en harmonie avec la nature, selon les scientifiques
Dernière revue: 30.06.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.
Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.
Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.
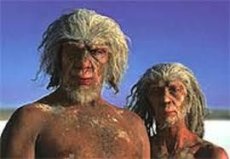
Une étude des restes de nourriture provenant de sites antiques situés le long du cours inférieur de la rivière Ica au Pérou a confirmé des suggestions antérieures selon lesquelles même les premiers humains ne vivaient pas en harmonie avec la nature.
Des chercheurs de l'Université de Cambridge (Royaume-Uni) et leurs collègues ont analysé les déchets alimentaires couvrant la période allant de 750 avant J.-C. à 900 après J.-C. et ont découvert qu'en moins de deux mille ans, les habitants de la vallée sont passés par trois étapes: d'abord ils étaient des cueilleurs, puis ils se sont consacrés à l'agriculture, après quoi ils sont redevenus partiellement des cueilleurs.
Cela étaye l'hypothèse selon laquelle, en supprimant une trop grande partie de la végétation naturelle pour faire place aux cultures, les anciens agriculteurs ont involontairement contribué aux inondations et à l'érosion, ce qui a finalement entraîné une pénurie de terres cultivables. « Les agriculteurs avaient franchi par inadvertance un seuil où les changements écologiques sont devenus irréversibles », explique David Beresford-Jones, auteur de l'étude.
Aujourd'hui, c'est un désert aride, mais les vestiges d'arbres huarango et les parcelles de sol meuble suggèrent que cela n'a pas toujours été le cas. Des travaux antérieurs de la même équipe ont déjà montré que cette zone était autrefois une zone d'agriculture très développée.
Les scientifiques ont prélevé des échantillons de dépotoirs et lessivé les sédiments, laissant derrière eux un mélange de restes végétaux et animaux. Les plus anciens ne présentent aucune trace de cultures domestiquées. Les populations se nourrissaient d'escargots, d'oursins et de moules pêchés sur la côte Pacifique, à huit heures de marche à l'ouest. Des échantillons des derniers siècles avant notre ère commencent à révéler des graines de citrouille, des tubercules de manioc et des épis de maïs. Quelques siècles plus tard, on trouve des traces d'agriculture, avec une grande variété de cultures, dont le maïs, les haricots, les courges, les arachides et les poivrons. Mais 500 ans plus tard, la situation est revenue à la normale: les dépotoirs regorgent à nouveau d'escargots marins et terrestres, mêlés à des plantes sauvages.
L'agriculture ici n'aurait pas été possible sans la forêt de huarango, qui formait une barrière physique entre l'océan et la vallée et maintenait la fertilité du sol en fixant l'azote et l'eau. Mais à mesure que les terres cultivables augmentaient, la forêt a été détruite, jusqu'à la rupture définitive de l'équilibre. La vallée a été exposée au phénomène El Niño, aux inondations et à l'érosion. Les canaux d'irrigation ont été détruits et des vents violents ont soufflé.
Un témoin indirect de cette triste histoire est l'indigotier, qui produit une teinture d'un bleu intense. On trouve fréquemment des graines de cette plante dans les premiers peuplements Nazca (100-400 apr. J.-C.). Les textiles de cette époque sont facilement reconnaissables à leur utilisation généreuse de cette teinture caractéristique. Plus tard, la carence en teinture devient évidente. L'indigotier poussant à l'ombre des forêts le long des cours d'eau, la disparition de l'indigotier suggère que la même chose est arrivée à la forêt.

 [
[