Nouvelles publications
Ang mga Aprikano ay hindi gaanong madaling kapitan ng HIV
Dernière revue: 29.06.2025

Tout le contenu iLive fait l'objet d'un examen médical ou d'une vérification des faits pour assurer autant que possible l'exactitude factuelle.
Nous appliquons des directives strictes en matière d’approvisionnement et ne proposons que des liens vers des sites de médias réputés, des instituts de recherche universitaires et, dans la mesure du possible, des études évaluées par des pairs sur le plan médical. Notez que les nombres entre parenthèses ([1], [2], etc.) sont des liens cliquables vers ces études.
Si vous estimez qu'un contenu quelconque de notre contenu est inexact, obsolète ou discutable, veuillez le sélectionner et appuyer sur Ctrl + Entrée.
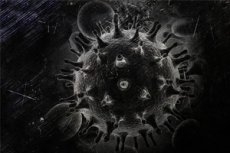
Le développement de l’infection par le VIH est bloqué par certains types de protéines spécialisées dans le « déroulement » de l’hélice d’ADN double brin.
L'immunité contre une maladie particulière est souvent transmise génétiquement, y compris les pathologies infectieuses. Depuis de nombreuses années, on rapporte que certaines personnes sont totalement résistantes au VIH grâce à la présence d'une mutation du gène CCR5, codant pour un récepteur des lymphocytes T. Grâce à ce récepteur, le virus pénètre dans la cellule. Des spécialistes ont même mené des expériences dans lesquelles des cellules souches ordinaires ont été remplacées par des cellules porteuses d'une mutation du gène CCR5 chez des patients atteints du VIH. Il convient toutefois de noter que cette mutation est rare: elle ne touche pas plus de 1 % de la population. Par conséquent, le don de moelle osseuse contenant des cellules souches n'est pas envisagé. Bien sûr, le recours au génie génétique est envisageable, mais cette question est encore à l'étude.
Les scientifiques ont constaté que la mutation susmentionnée n'était pas la seule à pouvoir bloquer le développement de l'infection par le VIH. Des représentants de l'Université du Manitoba, de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, de l'Institut Sanger et d'autres institutions scientifiques ont mené une étude sur un autre gène capable de prévenir le développement de l'infection: le gène CHD1L. Il a été constaté que, chez l'homme, ce gène peut se présenter sous plusieurs variantes, ce qui affecte également le processus infectieux.
Ce type de gène a été découvert après une étude approfondie de près de quatre mille génomes humains de patients atteints du VIH. Il est intéressant de noter que tous les génomes porteurs du gène CHD1L ont été trouvés chez des personnes d'origine africaine ou leurs descendants. Après son introduction dans l'organisme, le virus de l'immunodéficience humaine porteur du gène CHD1L commence sa reproduction active, mais au stade maximal, son activité diminue (appelé point de contrôle), indiquant la capacité de l'organisme à contrer l'infection sans intervention thérapeutique. Ce phénomène permet de déterminer le degré de développement du processus infectieux, la probabilité d'infection par un porteur du virus, etc. Le point de référence varie d'une personne à l'autre: cet indicateur est individuel et dépend directement des caractéristiques génétiques de l'organisme. Il convient de noter que de telles expériences ont déjà été menées, mais que les génomes de personnes originaires de pays européens ont été principalement étudiés.
Quant aux personnes d’origine africaine, c’est chez elles que la corrélation entre l’activité infectieuse et les variations du gène CHD1L a été révélée: certaines de ses variantes étaient particulièrement résistantes au développement du VIH.
CHD1L code une enzyme permettant la réparation de l'ADN endommagé. Cette enzyme est capable de déplier l'hélice d'ADN double brin, permettant ainsi à d'autres protéines directement impliquées dans la « réparation ». Des études sur les structures des cellules immunitaires ont démontré que CHD1L empêche le virus de créer de nouvelles copies de son génome. Cependant, à ce jour, le mécanisme complet de ce processus n'a pas été entièrement élucidé. On peut supposer que, dans un avenir proche, les scientifiques seront en mesure de créer un médicament ayant un effet similaire à celui de CHD1L.
Le texte intégral de l'article de recherche est disponible sur la page de la revue Nature à l'adresse.
